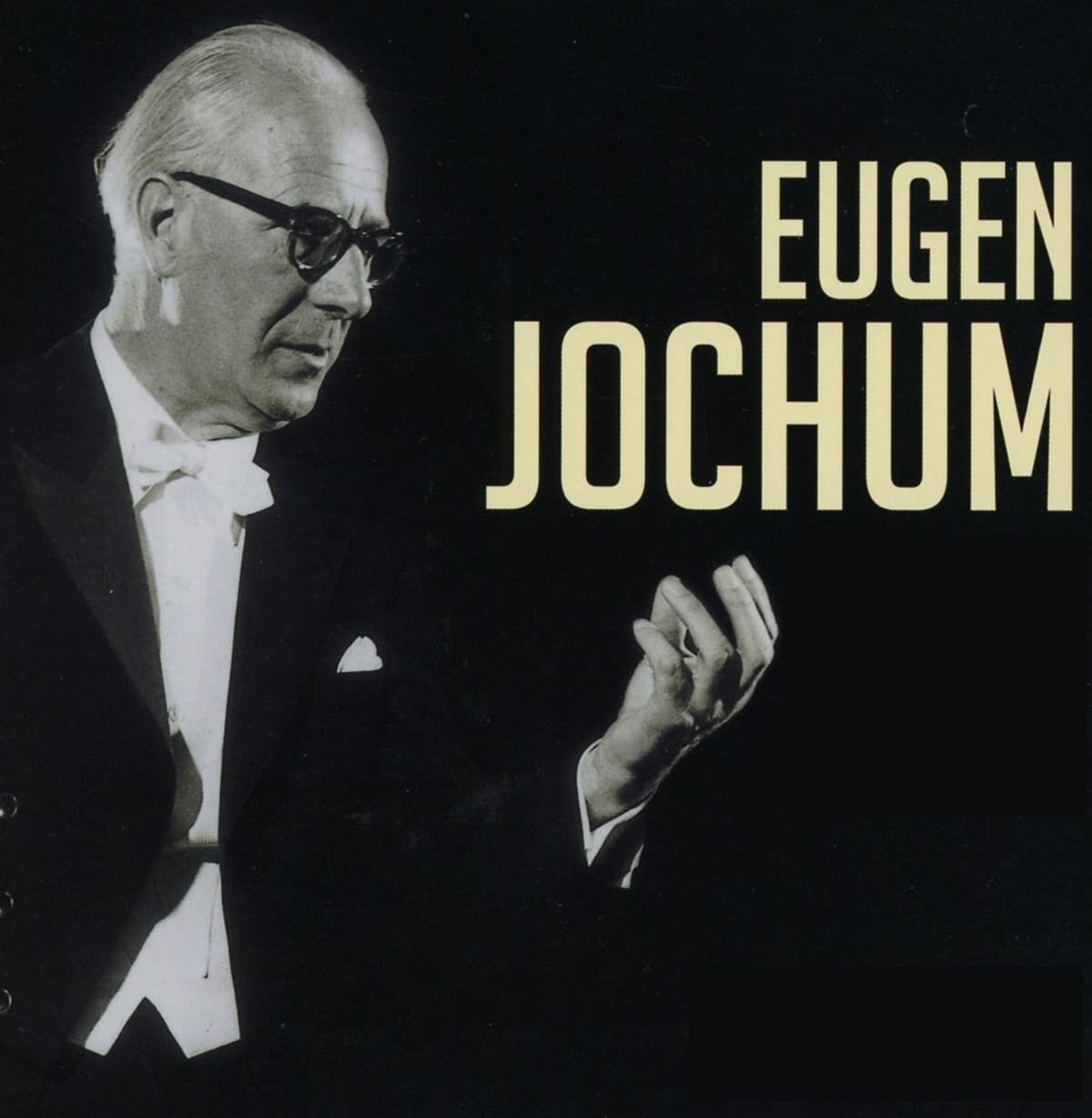
Agrandissement : Illustration 1
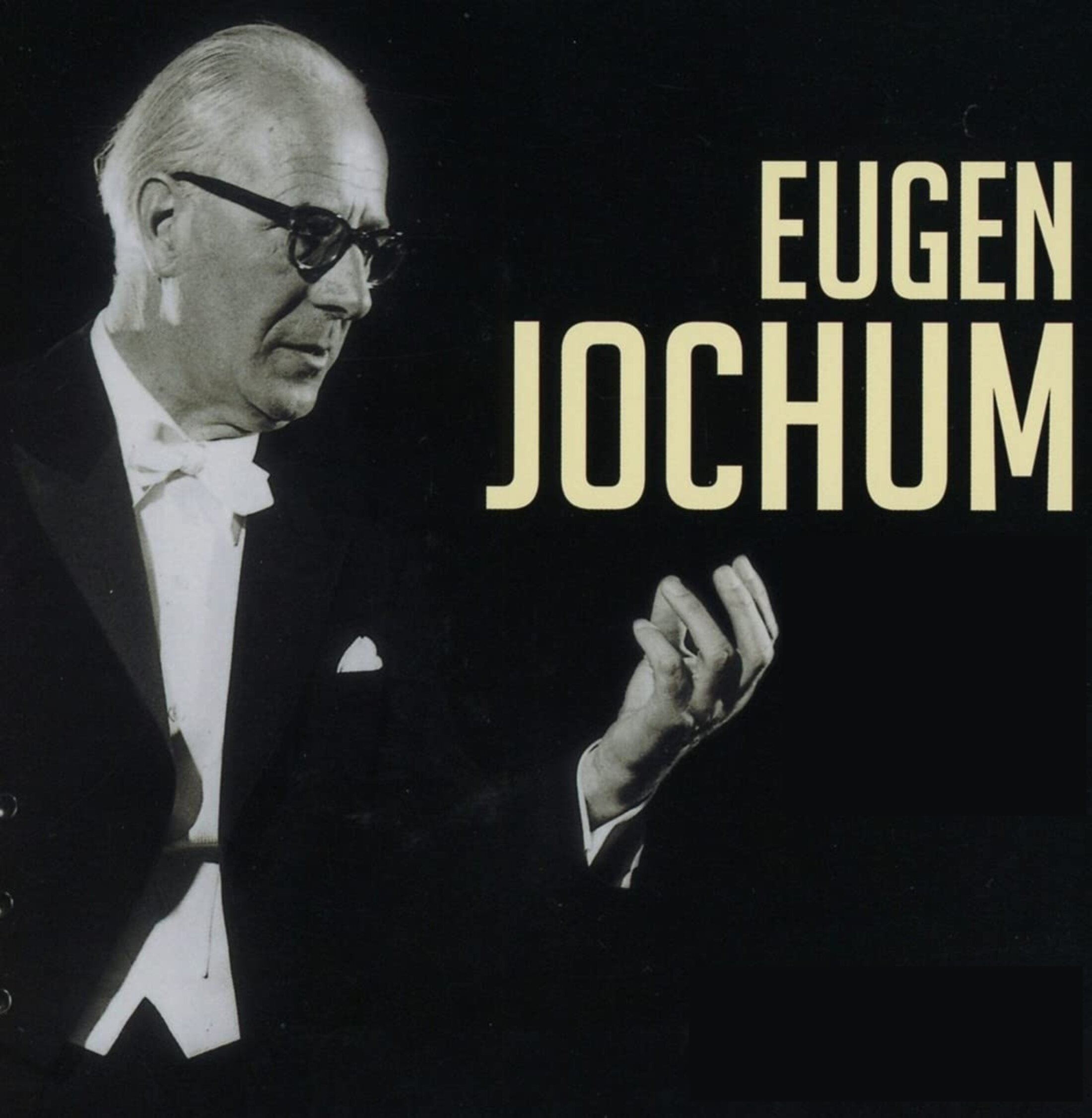
Si vous voulez être littéralement cloué sur place par des enregistrements dont vous oublierez très vite qu'ils sont en mono (donc vieux enregistrements, pour sûr), écoutez l'intégrale des symphonies de Brahms enregistrée par Eugen Jochum avec le Philharmonique de Berlin, l'orchestre de la radio bavaroise et l'orchestre de Hambourg (ici, intégrale doublée de la première des deux intégrales mythiques des symphonies de Beethoven par Jochum et Berlin, dans l'excellente collection de rééditions des « Milestones of a legend », sans livret néanmoins). Ici, Eugen Jochum est en quelque sorte le père de la version énergique et expressive de Brahms par Karajan, et l'autre grande référence brahmsienne de cette époque (années 50/60) avec Otto Klemperer à la tête du Philharmonia.
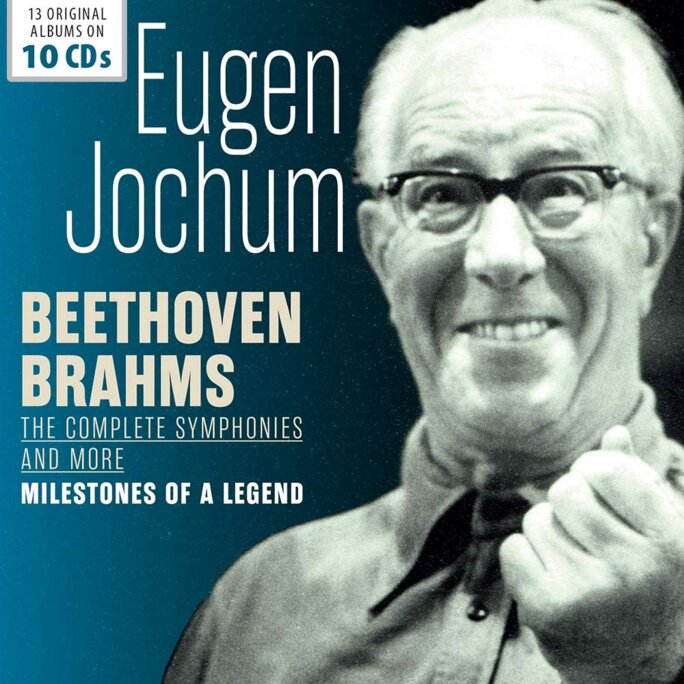
Agrandissement : Illustration 2
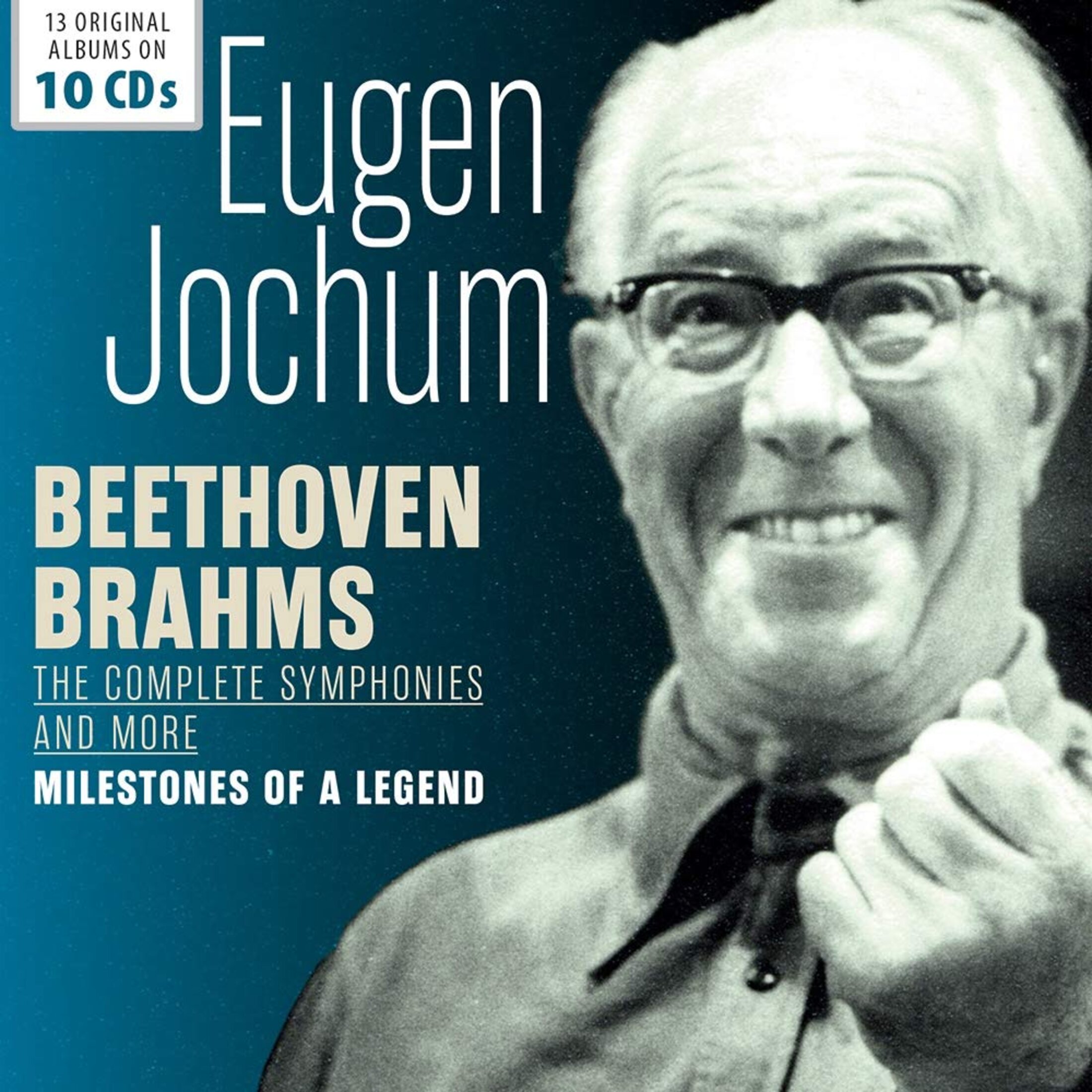
L'intégrale sur YouTube, avec le Philharmonique de Berlin (enregistrements des années 50) :
L'énergie demeure le maître-mot de cette version dynamique et acérée de Brahms, celle qui convient à cette musique. Jochum, Klemperer, Karajan mais aussi Bernstein (nettement plus pathétique et qui en fait parfois un tout petit trop) demeurent selon moi les meilleurs dans les intégrales des symphonies de Brahms (et j'y ajoute Abbado, mais dans une moindre mesure cependant). Ici, le sens de la phrase brahmsienne qui rebondit en harmonie et dans ses contrastes devient évident, comme s'il s'agissait de restituer à cette musique son relief initial et sa puissance intrinsèque. C'est ce à quoi est parvenu également Jochum dans Beethoven et évidemment dans Bruckner, où il est difficilement égalable (sauf par Karajan, qui approche de cette perfection dans Bruckner). Eugen Jochum est l'un des plus grands chefs du XXe siècle, mais à mon sens cette évidence est incontestable dans ces trois cas, faisant de lui un maître incontesté de l'ampleur orchestrale dans les répertoires classique, romantique et post-romantique : Beethoven, Brahms, Bruckner. De sorte que pour Brahms, je considère cette intégrale comme l'une des plus marquantes, avec celles de Walter, Klemperer et de Karajan. En un sens, pour apprécier les apports des trois autres, je dirais qu'il faut commencer par cette intégrale, pour accéder directement à la quintessence de ce Brahms épuré de toutes les scories pâteuses que lui ont accolé pas mal de chefs.
La Première est pour cela même d'une puissance et d'une ampleur singulières, que l'on retrouvera encore plus massive chez Karajan. Jochum ici découpe dans les phrasés une clarté, une limpidité où l'on retrouve le Brahms chambriste, sans pour autant oublier la masse orchestrale totalement maîtrisée. L'orchestre est réellement ici l'instrument de Jochum : écoutez le finale de cette Première pour vous en rendre compte ; ici, on est en territoire de précision, de clarté et de puissance crue, je veux dire non surjouée par je ne sais quel pathos. Brahms à son état de jaillissement et de diamant brillant et tranchant après Beethoven dans la symphonie (je précise que tout cela s’applique à la version du Philharmonique de Berlin, celle donnée en bonus sur le 3e cd, version live avec l’orch. de la radio bavaroise est difficilement audible du point de vue de la prise de son).
Sautez vers la Troisième, vous comprendrez alors la comparaison que j’établis avec Karajan : le pont y est encore plus manifeste, avec une similarité de tempo dynamique et là encore destiné à souligner l’énergie de cette écriture habitée par ses propres tensions et par la volonté de lutter contre ses tensions. Et point commun avec Klemperer : l’éminente précision du phrasé et du traitement de l’orchestration, alliance entre la masse et la singularité instrumentale. Et toujours, suprême rigueur de la battue. Ces chefs (Klemperer, Jochum, Karajan) étaient des sportifs de l’orchestre (comme Furtwängler) et c’est sans doute ce qui fonde leur impressionnant savoir-faire, donnant l’impression quand ils dirigent qu’ils sont à la tête d’un bolide dont ils connaissent les moindres rouages, et c’est pourquoi ils se permettent de le conduire sur les chapeaux de roue. L’esprit même de la symphonie romantique requiert cette capacité de débauche d’énergie alliée à une maîtrise consommée et à une rigueur exemplaire, et sur ce point ces trois chefs tiennent là leurs dénominateurs communs. Cette Troisième Symphonie est acérée comme jamais (chez le grand Bernstein elle est sirupeuse, sauf dans son célèbre scherzo où il excelle mais derrière les tensions vives de Karajan). L’esprit de tension est ici non pas dans l’expression, mais dans le son lui-même : il s’agit d’une tension organique inhérente à la masse orchestrale qui se produit comme les vagues de l’océan. Sans cela, l’andante de la Troisième peut devenir bien morne, or écoutez-le ici, il n’est que reliefs, courbes et droites. Jochum sculpte le son, comme il le fait dans Beethoven et Brahms. Le scherzo, justement, est poignant comme jamais mais par cela-même qui se nome maîtrise des tensions, et non pas jeu de théâtre. Jochum ressemble tant ici encore à Karajan, quand ils réussissent tous les deux en ce haut lieu de l’expressivité brahmsienne, à jouer des étirements et des retenues sonores dans une savante économie des moyens déployés. Le pôle de ces tensions chez Brahms (« frei aber fröh ») reçoit ici une perfection absolue : la distribution des rôles entre les vents et les cordes, comme chez le maître Beethoven, suffit à ces tensions constitutives. Au gré des réexpositions du thème principal du scherzo, le drame se déploie, mais dans le son, sans autre insertion : tout vient de l’intérieur de la musique. Alors quand intervient l’allegro final, on ne sera pas surpris de la poursuite logique de l’énergie initiale, dans cette musique qui « avance » comme celle de Beethoven, dans son mouvement propre et implacable. Et ça, Jochum vous le fera sentir, comme Klemperer et surtout Karajan. Ce qui le lie aux deux autres, c’est encore le sens inné de l’architecture de ces grandes œuvres. Et c’est certainement pourquoi il est important d’écouter Beethoven et Brahms par ces chefs : c’est la cohérence même de ces grandes symphonies qui apparaît d’un bout à l’autre des interprétations. Ce finale de la Troisième est agité, eh bien on n’évitera pas l’agitation les sursauts, les soubresauts, la poussée en avant haletante où Brahms sculpte le rythme comme une matière meuble se cristallisant sous nos yeux, avant l’évanescente conclusion de cette symphonie.
La Quatrième est au rendez-vous de cette excellence des étirements, elle qui s’ouvre sur ces intervalles océaniques à souhait, unités progressivement déployées puis redéployées avec génie. La musique induit sa respiration, et là encore Jochum parvient à donner toute sa puissance à cette merveille. Ici, Eugen Jochum à la tête du Philharmonique parvient incontestablement à rejoindre l’autre interprétation mythique de la Quatrième, celle de Carlos Kleiber à la tête du Philharmonique de Vienne. L’éminent lyrisme de Kleiber rejoint mystérieusement ce à quoi parvient ici Jochum par la puissance et la rigueur. C’est ainsi qu’il faut écouter Brahms : dans le relief et la projection. Eugen Jochum est un champion des accents et des sections limpides de l’orchestre. La Quatrième est sans aucun doute la symphonie la plus concentrée et celle où l’intensité tragique atteint son sommet. Elle est aussi réputée pour être la symphonie dont l’écriture est la plus subtile et la plus accomplie. La fin de l’allegro initial vous plongera en tout cas dans le flot de l’énergie brahmsienne, irrésistible par la magie de Jochum. L’andante, tout en retenue, vous l’entendrez come tout le reste, dans la clarté, le son ciselé, chaque note détachée (différence avec Karajan, chercheur du legato surtout dans ses dernières années) comme un diamant, pierre d’un édifice où l’on pénètre progressivement, un paysage qui se découvre graduellement. Le caractère enjoué et légèrement hystérique de l’allegro qui suit (Mahler n’est pas loin, dans cette sorte de fête forcée et menacée) est ici exprimé comme il le faut par Jochum, c’est-à-dire à l’abri de toute légèreté niaise : on est ici dans une dialectique des formes qui constitue organiquement cette Quatrième. Car ce qui succède est sans doute l’accomplissement tragique le plus impressionnant de l’art symphonique de Brahms. On retrouvera ici le modèle expressif suivi plus tard par Karajan. Jochum fait ressortir une construction architecturale qui relève du combat beethovenien, dans sa progression et son développement sans cesse menacé, mais qui avance dans l’inconnu par une force organique irréductible. Les sursauts ne manqueront pas, mais ici encore ils proviennent de l’intérieur, et pas d’une intention plaquée sur la musique. Eugen Jochum dans ce mouvement final de la Quatrième, réussit comme à son habitude, à vous faire pénétrer l’écriture musicale de Brahms, pour ne pas surjouer la musique romantique en dehors de sa propre logique. C’est ainsi que savent également procéder les bons interprètes du baroque, et de Bach en particulier. Ce final de la Quatrième est dialectique et résolution de conflits. On est effectivement dans le mouvement le plus « beethovenien » de Brahms, et pourtant éminemment chez Brahms. Et Jochum est son messager.



