
Agrandissement : Illustration 1

Frédéric Thiriez a remis au Premier ministre son rapport sur la réforme de l'ENA (18/02/2020), pardon: sur la réforme de la haute fonction publique. Les mesures en ont été détaillées par la presse (voir par exemple: Benoît Floc'h, «Réforme de la haute fonction publique : ce que contient le rapport de Frédéric Thiriez», LeMonde.fr, 17/02/20). Mais le même journaliste s'avérait dubitatif dans un autre article publié le même jour: «Réforme de la haute fonction publique : une formidable opération de dupes».
Du rapport (sera-t-il publié?), il est inutile d'aller sans doute au-delà des commentaires factuels qu'il suscite. La question est de savoir ce qu'en retiendra le Gouvernement et, surtout, le président de la République qui garde la main sur le dossier. ⇒ Voir en fin de billet: «dernière minute».
Une pincée de diversité (avec un concours spécial fondé sur les ressources de la famille) ne changerait pas le système. Comme dans le cas du concours spécifique de l'inspection des finances sous la IIIe République, les transfuges seront «aspirés» par leur nouveau statut. Au reste, il faudrait que ce concours censitaire — même s'il s'agit, si je puis dire, d'un concours à contre-cens — passe le cap de la censure du Juge administratif voire du Juge constitutionnel via une QPC.
Quant au changement de nom, il est symbolique (ce qui n'est pas rien), mais ne modifie pas l'approche de la manière dont se recrute et se construit la haute fonction publique. Que le concours de sortie soit maintenu ou non, l'accès de l'accès aux «grands corps», ceux de la «botte» (Conseil d'État, inspection des finances, Cour des comptes), reste posé. Qu'il intervienne immédiatement après la scolarité ou après, peu importe. Même la suppression de l'inspection des finances (dont on parle, pour l'instant) n'y changerait rien: nul doute que la direction du Trésor de Bercy s'y substituerait.
Glissons sur la scolarité dans l'ENA-qui-ne-serait-plus-l'ENA. Un rapport n'est que de l'encre jetée sur le papier et, antipathique ou sympathique, les mots n'y ont d'effet que lorsqu'ils sont traduits en décisions officielles. Toute la question est dans ce qui n'est pas dans le rapport et dans ce qui ne sera pas dans les décisions. Or c'est l'essentiel.

Agrandissement : Illustration 2

Haro sur l'ENA et les énarques! Soit. Mais de quels énarques parle-t-on? De la grande masse des administrateurs civils, ceux qui font «tourner la boutique» et (sinon dans quelques sphères privilégiées de Bercy) ne pantouflent pas? des conseillers de tribunaux administratifs ou des chambres régionales des comptes qui sont des garanties au quotidien de l'État de droit?
La hiérarchie des grands corps, quelques aménagements qu'elle connaisse, ne changera pas. Et cela serait bien difficile dans la mesure même où le Conseil d'État comme la Cour des comptes ont une fonction juridictionnelle.
Et, en tout état de cause, les logiques des élites sociales restent les mêmes, mais aussi leur capacité à contourner ou détourner les obstacles qu'on peut tenter de dresser sur leur chemin. Alain Garrigou (Les élites contre la République. Science Po et l'ENA, La Découverte, 2001) a ainsi analysé la manière dont «Science po Paris» a su jouer à la Libération pour maintenir son statut de fait malgré la création de l'ENA et d'autres instituts d'études politiques (ordonnance du 9 octobre 1945: version d'origine sur Gallica.bnf.fr: version résiduelle sur Legifrance.gouv.fr)... et même dont Maurice Thorez, alors vice-président du Conseil chargé de la Fonction publique, a sauvé l'inspection des finances menacée.
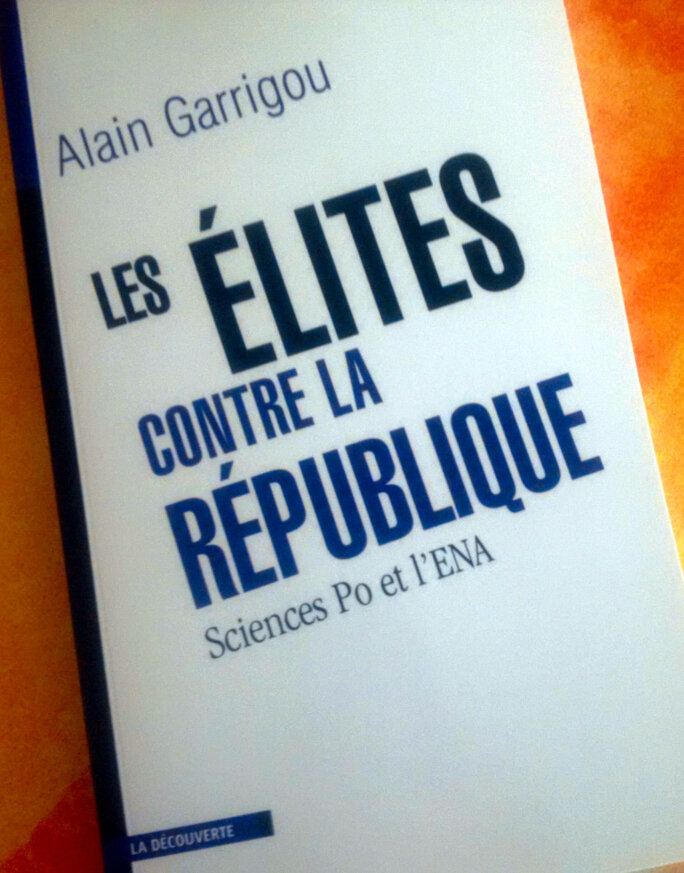
Agrandissement : Illustration 3
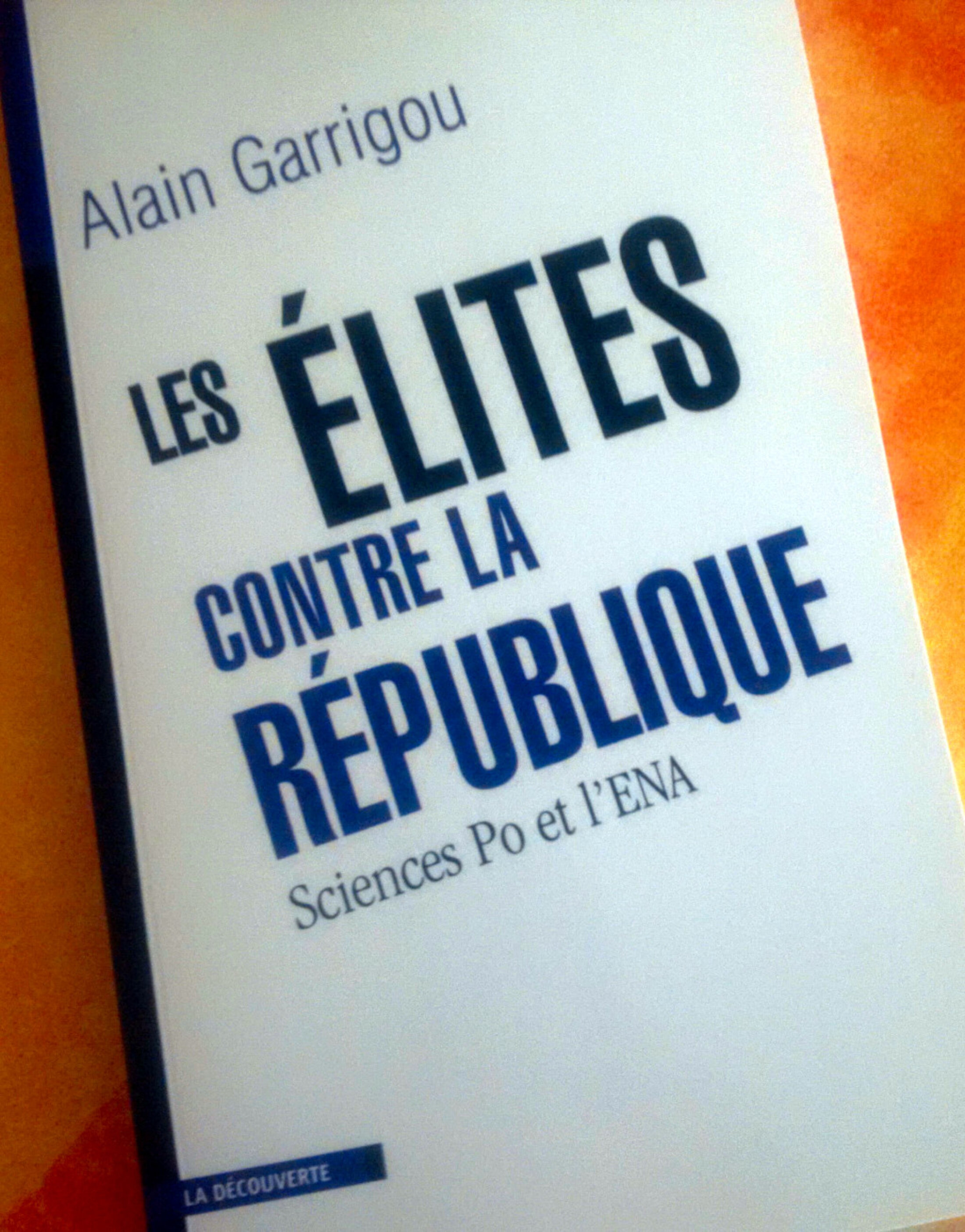
Sauf à rayer d'un trait de plume les «grandes écoles» et ce qu'elles représentent à tout point de vue (ce qui est plus facile à dire qu'à réaliser), on n'échappera pas au recrutement précoce d'une partie des hauts fonctionnaires. Par précoce, j'entends: à la sortie de cursus de formation prestigieux ayant sélectionné eux-mêmes des «élites», quand bien même ces élites intellectuelles sont aussi le produit de réalités sociales inégalitaires, issus de manière écrasante de milieux privilégiés dont quelques rescapés des basses couches sociales sont à la fois les faire-valoir et les masques d'un système de reproduction programmé. C'est vrai pour l'ENA comme pour les grands corps techniques (pensons aux X-mines, par exemple). Il y a une fabrique des élites, avec de sucroît des éléments implicites de reconnaissance (ou d'assimilation possible) dont les connaissances culturelles (lato sensu) ont longtemps été illustrées par le modèle du «grand oral» de Sciences po (Paris) puis de l'ENA qui en fut somme toute le décalque.
Or la question de la diversité des trajectoires, loin d'un moule unique réducteur quel que soit ce moule, n'est assurément pas pensée, hormis les respirations limitées des «tours extérieurs». L'écart d'un centième de point à vingt-cinq ou trente ans va conditionner durablement le devenir de cohortes, indépendamment de ce que ceux qui étaient du mauvais côté de la barre initiale ont pu réaliser, compte tenu aussi de ce que leur position (position dans une configuration au sens de Norbert Elias) leur aura permis ou non de réaliser. Cette question-là est aussi, en termes de ressources humaines (terme à la mode), un gâchis de compétences.
Dans la Fonction publique républicaine, il y a les voies royales, celles de chats «bottés», et les autres, ces tiers qui aimeraient bien, pour reprendre la formule de Siéyès, pouvoir «devenir quelque chose». De ce point de vue, force est de constater que le concours interne d'accès à l'ENA a rapidement connu ses limites, quand il n'a pas été détourné de sa finalité pour permettre à quelques ulmiens particulièrement brillants de convertir leur capital universitaire en capital administratif. C'est un premier problème mais, par les temps qui courent, ce n'est sans doute pas le plus important qu'esquive ce qu'on sait du rapport Thiriez.

Agrandissement : Illustration 4
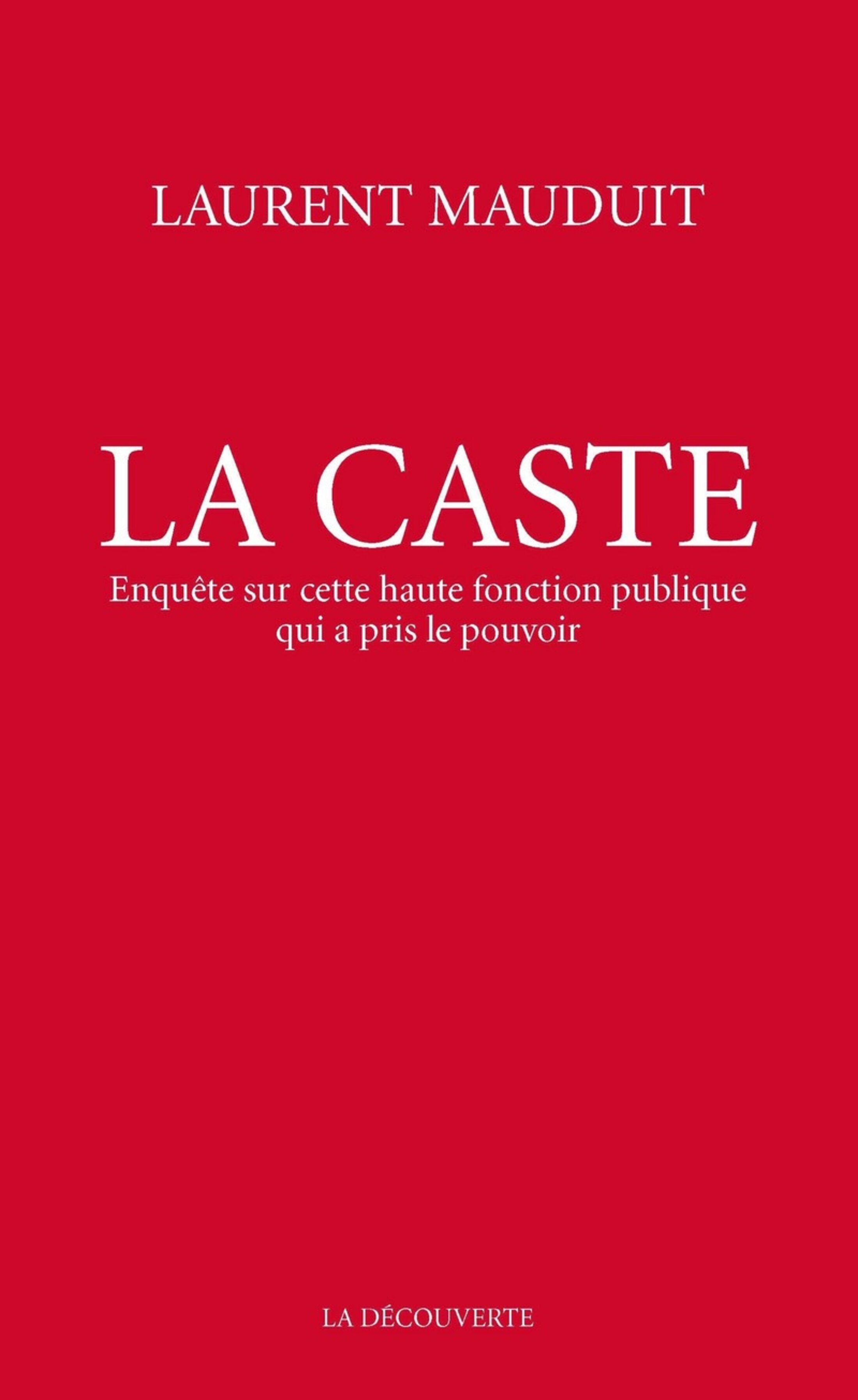
«Le projet de Macron de supprimer l’ENA relève de l’embrouille. Son but n’est pas de renouer avec l’ambition démocratique originelle de l’école ni de combattre le système oligarchique. Pour cela, il ne faudrait pas avoir HEC pour modèle». Ainsi écrivait Laurent Mauduit, auteur de La caste, dans un article de Mediapart du 28 avril 2019.
Nous ne sommes plus dans la situation qui a prévalu après guerre, celle de la reconstruction et des «élites modernisatrices» incarnées par des «établis marginaux» issus tout à la fois d'institutions élitaires et de la France libre. Nous ne sommes pas davantage à l'ère où les technocrates, au nom de l'intérêt général pensé par eux, s'inscrivaient dans le projet national symbolisé à la fois par de Gaulle et Michel Debré au début de la Ve République. Le cadre purement hexagonal, qu'on le déplore, qu'on s'en réjouisse ou, tout simplement, qu'on constate les effets de l'histoire, a explosé. Les conséquences en ont été tirées, avec retard, lors de la disparition du commissariat du Plan en 2006 (ce qui, au passage, n'interdirait pas qu'on s'y intéressât à nouveau, même dans un contexte différent).
Le problème posé aujourd'hui n'est plus seulement celui du pantouflage. Il est celui de la porosité permanente entre les fonctions de haute responsabilité administrative et le secteur privé (plutôt CAC 40 que TPE, si vous voyez ce que je veux dire). Ces allers-retours constant sont illustrés par le terme «rétropantouflage» qui va bien au-delà de l'idée de mobilité (tant il est vrai que des respirations peuvent être utiles). Mais on ne se situe plus dans une carrière longue de service public avec une éventuelle expérience différente; il s'agit de la construction de parcours personnels que l'enrichissement (d'abord) des carnets d'adresse permet de faire fructifier.
On n'est même plus dans les logiques de «seconde carrière» qui correspondaient au pantouflage traditionnel — ou pour les hauts fonctionnaires des Finances, dans les grandes entreprises nationalisées du secteur bancaire ou assurantiel, ce qui était une autre manière d'œuvrer aussi pour la collectivité. Et l'on applique désormais, dans les deux champs, les recettes court-termistes qui défont plus qu'elles ne font les politiques publiques.

Agrandissement : Illustration 5

On a pu dire qu'à la Libération la Fonction publique avait d'abord été construite par le haut (création de l'ENA et du corps des administrateurs civils) avant de l'être par le bas (statut «Thorez» des fonctionnaires du 19/10/1946). Est-on en train d'assister à une double déconstruction de celle-ci? Par la loi Darmanin-Dussopt du 26/10/2019 d'abord, qui régresse vers une logique discrétionnaire et la promotion du «contrat» sur le «statut» ? (Voir sur ce blog: «Fonction publique: quand un point de détail révèle toute la logique d'une réforme», 07/09/2019.) Par une «réforme» de l'ENA ensuite qui pourrait accroître la dilution de la haute fonction publique sans remettre en cause les logiques fondamentales de reproduction sociale?
Ce serait un beau sujet pour les gauches (et ce que j'y incorpore dans leur diversité) que de penser au contraire de ce qui se développe (ou semble se développer, si l'on veut mettre un peu de nuance) les conséquences à tirer dans le monde d'aujourd'hui (et non avec un rétroviseur braqué sur 1950) de cet engagement de longue durée dans le service public qui est historiquement à l'origine de la Fonction publique de carrière: non pas seulement celle où l'on «fait carrière», mais celle où l'on consacre dans la durée sa carrière à la Fonction publique. Sans doute d'ailleurs faut-il tenir compte du fait que la Fonction publique peut attirer tout autant en seconde carrière que les fonctionnaires, en théorie au moins, pourraient être intéressés par un changement de carrière à moment donné. Mais ces embranchements-là ne sont pas des allers-retours constants servant à accumuler un capital d'expériences convertibles à usage individuel.
Pierre Bourdieu, en 1989, avait évoqué la noblesse d'État. Du moins avait-elle, comme l'autre, certains principes au moins en théorie, comme la notion d'intérêt général ou celle de continuité de l'État. On n'en est plus là et, décidément, il sied qu'on se méfie des illusoires poudres qu'on voudrait nous jeter aux yeux.
Luc Bentz
Pour aller plus loin...
Je conseille les deux ouvrages dont l'article mentionne les liens: La caste, de Laurent Mauduit, ouvrage plus récent et documenté avec l'approche qui est celle d'un journaliste; Les élites contre la République d'Alain Garrigou, ouvrage plus ancien, mais qui permet de retracer les évolutions dans l'histoire longue, par un universitaire politiste particulièrement versé dans l'histoire sociale et politique.
Voir sur Mediapart: Laurent Mauduit, «Haute fonction publique: la pantalonnade du rapport Thiriez» (18/02/2020).
Voir le rapport Thiriez «Mission haute fonction publique. Propositions» (18/02/2020).
Dernière minute
Axes de travail du Gouvernement

18/02/2020, 18 h 34. — Après la remise du rapport Thiriez, le Premier ministre a communiqué sur les «axes de travail» de différents ministres. On en retrouvera ici les éléments sur le site officiel du Gouvernement: https://www.gouvernement.fr/partage/11391-remise-du-rapport-de-m-frederic-thiriez-sur-la-reforme-de-la-haute-fonction-publique.
On y voit déjà que l'ENA sera transformée en école du management public. Tout un symbole (en même temps qu'un anglicisme lourd de sens dont l'administration publique — qui est tout autre chose — pourrait aisément se passer.
(Voir aussi: Benoît Floc'h et Camille Stromboni, «Suppression de l’ENA et réforme de la haute fonction publique : Matignon dévoile “cinq axes de travail”», LeMonde.fr, 19/02/2020).



