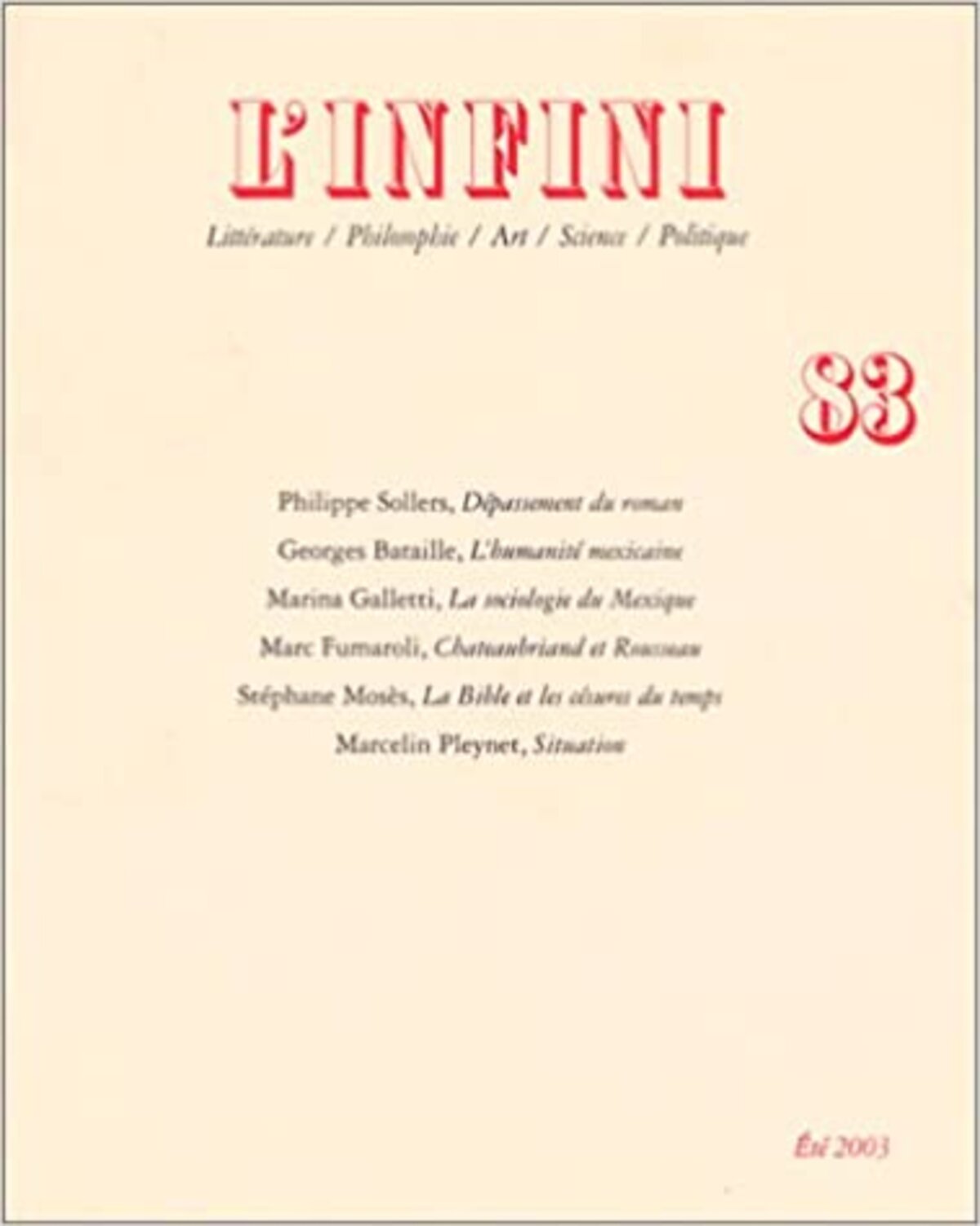
.
Extrait de « Philippe Sollers et le dépassement du roman », entretien avec Irène Salas paru dans la revue L’Infini numéro 83, Gallimard, été 2003, repris dans Le Roman français au tournant du XXIe siècle (collectif), Presses de la Sorbonne-Nouvelle, 2004, puis dans Discours parfait, sous le titre « Technique », Philippe Sollers, Gallimard, 2010 [1].
.
.
––––––––
.
Irène Salas : Depuis l’évolution des outils informatiques et des techniques d’écriture, les chercheurs s’intéressent de plus en plus à ce qu’on appelle la « génétique textuelle ». Vous-même écrivez essentiellement à la plume et tapez ensuite vos textes à la machine, pour percevoir le bruit, le rythme des touches. Or, votre écriture est tellement orale et spontanée qu’elle semble innée, comme prise directement sur le vif. Cette écriture orale est-elle le fruit d’un long travail ?
Philippe Sollers : Il y a une phrase de Mallarmé que j’aime beaucoup et qui dit : « Penser est écrire sans accessoires ». La question de la technique ou de la rédaction est importante, bien sûr, mais secondairement. Le plus important, c’est la concentration mentale permanente, la rumination interne, l’attention à la façon dont le langage se formule intérieurement, et là est le travail constant sur soi. Par conséquent, je prends des notes sur un carnet lorsqu’un mot, une expression, un raccourci se présente où je sais qu’il y a un développement possible. Puis, il y a l’acte de rédaction qui s’enchaîne, mais à la plume. Il faut absolument qu’il y ait le contact de la main et du papier… C’est comme un fluide, un liquide qui sort du corps. Évidemment, il y a beaucoup de trouvailles qui se passent au moment même où l’on commence à écrire. Je pars d’un mot, d’un choc de mots, d’une scène, d’une « épiphanie », comme dit Joyce, ou bien d’un rêve particulièrement intéressant que j’ai eu… Et voilà. Ensuite, c’est la mise au propre, avec des variations qui peuvent arriver en tapant à la machine. Mais déjà, l’essentiel est écrit… L’écran me gênerait beaucoup. On n’est pas là pour déchiffrer, comme on déchiffre un écran, pour le recevoir un peu comme si on était à la télévision. Donc, c’est une activité qui la plupart du temps est très aveugle et très orale, en effet. Très vocale, plus exactement, c’est une activité d’écoute.
I. S. : Vous ne vous enregistrez jamais ?
P. S. : Je l’ai fait, mais il y a très longtemps, et pour vérifier. Maintenant, je ne le fais plus du tout. J’ai fait cela au moment de Lois, en 1972, où j’avais besoin du retour du son pour voir où j’en étais avec la rythmique, parce que c’étaient des sortes de versifications intégrées. Il m’est également arrivé de faire des enregistrements divers, notamment plusieurs pour Paradis, mais sans toucher au texte. Tout cela est intérieur. L’oralité est intérieure, l’écriture est intérieure et sans accessoire. L’essentiel, c’est cela.
I. S. : Pour vous, l’oralité, les sons, le souffle, la mise en éveil des sens, sont primordiaux, et à eux seuls permettent une approche sensitive et corporelle du texte : est-ce là que réside le pas essentiel vers ce « royaume », ce « paradis », si j’ose dire, dont vous parlez si souvent ? Est-ce uniquement par le corps et notamment l’érotisme, central dans votre œuvre et toujours associé au langage, que l’on touche au plus près à l’intimité de l’homme, et donc à sa vérité ? Dans une expression concernant Paradis, vous définissez l’écriture en ces termes : vous dites qu’il s’agit de susciter cet état chez le lecteur où « l’œil s’efface dans ce dont se souvient l’oreille » [Théorie des exceptions]. Ainsi, lorsqu’on vous lit, tout semble partir du corps. Ou bien, existe-t-il encore une autre dimension ?
P. S. : Eh bien, une autre dimension à part celle du corps, je ne vois pas vraiment laquelle ce serait. Sauf que le corps est beaucoup plus complexe qu’on ne le dit. Le problème consiste à vérifier le peu d’utilisation que la plupart des gens font de leur corps. Ils restent à la surface de leur corps. Ils ne savent pas très bien comment l’employer. Ce qui se voit évidemment et mieux dans l’érotisme. Il y a en général un embarras, des inhibitions… Ce n’est pas vécu, disons, avec aisance. Cela dépend des périodes dans la civilisation. Il est certain qu’il y a des périodes plus ou moins fastes pour une certaine liberté…
I. S. : Comme le XVIIIe siècle, par exemple ?
P. S. : Bien sûr. Enfin, une certaine partie du XVIIIe siècle… Le point central, c’est quand même toujours le rapport au langage. L’érotisme, sans le « dire », n’est rien. D’ailleurs, les films pornographiques sont en général d’une idiotie auditive totale. Et cela désigne quelque chose. Mais je pourrais faire le contraire, c’est-à-dire lire le Marquis de Sade ou un texte violemment érotique avec des images extrêmement chastes, ou alors faire L’Éthique de Spinoza avec des images pornographiques, comme un traité. Donc, c’est là que je pose une interrogation, sur ce système d’oblitération du champ par l’image… C’est à contre-courant de toute la façon dont l’industrie du spectacle fonctionne. Là, c’est le « dire » lui-même qui tient, à mon avis, le réel. Le « dire » ou le « musical »… C’est-à-dire que lorsqu’on parle maintenant de cette histoire de corps, de ce corps que je respecte un peu, (la plupart me paraissant très endommagés ou très mécaniques, le sport qui est mangé par l’argent – cela ne veut pas dire que je n’aime pas certains sportifs), ce sont les musiciens, les musiciennes.
I. S. : Et les danseurs, aussi ?
P. S. : Moins… Parce que maintenant, c’est quand même plus simple… Je veux dire qu’il y a une formation technique, mais on peut à la limite tricher la danse. C’est de la mécanique. On peut tricher ça… En général, c’est sur des musiques qui n’ont pas beaucoup d’intérêt : Le Lac des Cygnes pour la énième fois en musique classique. En revanche, le fait d’avoir à sa disposition un instrument, ou alors la voix, qui en est un, je trouve que cela rapproche de la vérité… La poésie étant aussi ce qui rapproche de la vérité.
I. S. : Puisque votre écriture est avant tout musicale, si vous deviez définir un son, quel serait celui que vous choisiriez pour illustrer votre œuvre ? Un éclat de rire, par exemple ?...
P. S. : Fait par qui ? Il faudrait que ce soit un éclat de rire qui me plaise ! Le rire… très important, le rire ! Le rire qui est lié à l’érotisme… Il y a une scène fameuse, vous savez, chez Proust avec Mademoiselle Vinteuil. C’est une scène tout à fait importante, parce qu’on a le son. Il y a deux exemples. Le premier, c’est lorsqu’il surprend Charlus et Jupien dans la cour des Guermantes. Là, il n’est pas voyeur, il ne voit pas ce qui se passe, mais il entend des cris, enfin bon, ils sont en train d’avoir une relation homosexuelle. Et la deuxième, c’est la révélation qu’il a dans un buisson. Il voit par la fenêtre Mademoiselle Vinteuil et Albertine qui ont aussi une relation homosexuelle. Mais ce qui le frappe le plus, c’est que, tout à coup, elle disparaît dans le fond de la chambre, et là Albertine – et ça le rend jaloux – a une sorte de rire… Ou bien la jouissance sexuelle fait rire, ou bien pas… Donc, si c’est plutôt réussi, ça fait rire ! C’est très évident dans les réactions féminines, c’est absolument audible. Donc, le rire ici est un rire de jouissance, de satisfaction… Mais pas seulement… Il faut qu’il y ait le rire, mais il faut qu’il y ait aussi un certain silence contemplatif, plus intérieur… Une syllabe. On peut travailler sur la syllabe sacrée, indienne, — j’ai écouté beaucoup de musique indienne quand j’écrivais Paradis, c’est-à-dire, vous savez, ce qu’on appelle le Om… Alors, peut-être ce son, qui est censé vous conduire à une sorte d’extase… Mais le rire aussi est bien. Et comme le dit Céline : « les muses ne rient bien que branlées ».
I. S. : C’est une question que vous soulevez souvent : où en est le corps, dans le roman ? Plus précisément le corps français, le corps dans la littérature française ? Aurions-nous peur de notre corps ?
P. S. : Il faut poser les questions en termes historiques… Là, pour l’instant, on est en pleine dépression. Cela ne va pas. Mais il y a au contraire des moments explosifs, des moments de grande libération. Cela dépend du moment.
I. S. : Croyez-vous qu’il y ait une sclérose particulière en France ?
P. S. : C’est plus étonnant, plus surprenant en France. On peut mieux, plus exactement, le mesurer en France. Parce que, tout simplement, il y a eu des sommets du contraire, comme la galanterie française au XVIIIe siècle… Aucun autre pays en Europe n’a connu cela… Mais il n’y a pas seulement le XVIIIe. Aujourd’hui, par exemple, je lis un livre sur Renoir : je vois tout ce courant extraordinaire des Impressionnistes, à partir de 1860. Ils ont été refusés tout le temps par les salons, mais il y avait des artistes extraordinaires comme Manet, Degas, Renoir et plus tard Rodin… C’est une énorme explosion. Évidemment, tous ces artistes sont dans la sensation, dans l’impression de vivre en plein paradis qu’ils se donnent à eux-mêmes. Mais la société n’aime pas cela du tout… C’était une époque… Il y a aussi l’indice féminin. C’est toujours un très bon repère. Où en sont les femmes à tel ou tel moment ? C’est presque une question de nature. En ce moment, je trouve qu’il y a une insécurité, une crise identitaire, quelque chose qui se passe et qui ne va pas. Du coup, évidemment, les hommes sont déprimés, ils ne vont pas bien, ils n’ont pas de satisfaction… C’est un problème de crise de civilisation profonde. C’est pour cela qu’on peut comprendre quelqu’un comme Houellebecq qui trouve que, finalement, l’homme occidental ne fait rien et va vers des prestations prostitutionnelles en Thaïlande. Il parle ainsi de la prostitution de façon provocatrice, comme quelque chose qui pourrait remplir un vide… Cela dit, on ne peut pas savoir combien de temps cela va durer, mais pour l’instant, c’est quand même plutôt négatif. Et évidemment, je fais le contraire. De ce point de vue là, je suis très à contrecourant… Et puis, ce ne sont pas uniquement des questions d’ordre sexuel, mais des questions de perception, qui sont en cause. La sexualité, après tout, on en fait tout un plat, mais c’est le corps au sens large, avec ses sens : savoir voir, savoir écouter, savoir goûter, savoir toucher, savoir respirer…
I. S. : Si l’on parle d’érotisme, c’est du langage surtout dont on parle véritablement…
P. S. : Voilà. Vous voyez les couleurs ou vous ne les voyez pas, les odeurs, les parfums, les sons se répondent… « La Nature est un temple […] de vivants piliers… », etc., Les Correspondances…
.
.

Agrandissement : Illustration 2

.
.
I. S. : On pourrait maintenant parler de vos « expériences spirituelles » au sens large…
P. S. : Mais, c’est la même chose. Le corps est aussi spirituel. Et l’esprit est corporel.
I. S. : Que vous a apporté l’écriture de Drame, que vous qualifiez, dans Vision à New York, d’« exercices spirituels », soit cette pleine immersion du sujet dans le langage, et même du sujet surgissant du langage ? Cette dissolution du sujet correspond-elle à la période des avant-gardes et du groupe Tel Quel que vous avez ensuite quitté, désireux de vous affirmer en tant qu’autorité propre avec un moi davantage consolidé dans les romans qui suivent ?
P. S. : Forcément, cela correspond à une période de ma vie. J’ai écrit Drame en 1963-1964, donc j’avais 27-28 ans. C’est un livre auquel je tiens beaucoup parce que je crois que c’est là où je commence vraiment à dire les choses. Le Parc, c’est encore un peu une aquarelle. Or là, phénoménologiquement, j’en suis assez content. C’est-à-dire, que je m’intéresse aux choses mêmes. Et je l’ai écrit en même temps que j’ai écrit mon premier texte sur Dante. Il y a déjà la pensée indienne, certainement, il y a l’Inde, il doit y avoir la Chine… Et l’exergue d’Empédocle, si je me souviens bien : « Le sang qui baigne le cœur est pensée. » Les exergues sont très importants. Je n’ai pas mis l’auteur exprès, pour montrer qu’il n’y a aucun nom, que c’est déjà un acte d’appropriation, pour montrer que tout cela marche ensemble, sans que cela ait besoin même d’être classé. C’est la définition de ce que l’on pouvait faire, dans Paradis, en mélangeant aussi les noms, mais sans majuscules. C’est-à-dire que tout cela c’est un même tissu, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a pu se dire, c’est un unique tissu. Tout est déjà écrit ou à réécrire sans arrêt. C’est pour montrer que la vie, ce qu’on appelle la vie en fait, c’est cela. Rien d’autre. Cela aussi, encore, est très à contre-courant, parce que ce n’est pas la story, le film, la bande dessinée, le roman… Donc, c’est une expérience très radicale avec vraiment une structure, la scène du jeu, etc.
I. S. : C’est une expérience ascétique, proche d’une certaine méditation en accord avec tous les éléments ?
P. S. : Écoutez, vous prenez les premières pages et il doit y avoir tous les éléments pour montrer ce qui se passe. C’est-à-dire le ciel, une vision, un rêve — très important le rêve. Souvent, je commence mes livres par un rêve fort, et puis surtout c’est la phrase qui vient. Si j’ai le début, j’ai tout le livre. Mais alors, il faut que le début soit le début, d’où tout le problème du commencement. Chez moi, c’est capital.
I. S. : Puis, il y a les années 1980, avec la montée de l’individualisme. Et dans votre œuvre, on assiste également très nettement à cette transition d’un sujet pluriel vers un retour au moi…
P. S. : Ce n’est pas un retour au moi. Le moi est un jeu. Le moi, le moi… : c’est une entité fictive, c’est à travailler. Portrait du Joueur : ce n’est pas « d’un » joueur, c’est « du » joueur. C’est venu avec Femmes, qui paraît avant.
I. S. : Et aussi avec Paradis ?
P. S. : Paradis, c’est encore autre chose. Paradis, c’est l’ouverture à toutes les sources qui doivent confluer, c’est un énorme fleuve. Mais, après cela, je me suis rendu compte qu’il fallait introduire l’histoire, précise : c’est-à-dire, pas seulement le moi. Ce moi, évidemment, il est là, c’est la « mythobiographie », il est comme ça, mais il est dans l’histoire.
I. S. : Pourquoi, « il fallait introduire l’histoire » ?
P. S. : Pour éviter d’être pris pour un abstrait. Je ne suis pas un abstrait. Je peux figurer ce que je veux, quand je veux. J’emploie toujours la comparaison avec Picasso : ainsi, je comprends très bien pourquoi Picasso, à un moment donné, a pu sortir du cubisme. Cela a beaucoup choqué ses amis qui sont restés dans le cubisme… J’ai pensé que cela pouvait donner lieu à une interprétation puritaine qu’il fallait donc déjouer… Sinon, cela ne montrait pas le feu qui était derrière.
I. S. : Y avait-il aussi une volonté d’être plus « lisible », de ne plus être considéré comme un marginal et de conquérir un large public ?
P. S. : Non, mais bien préciser d’où cela vient, à quel moment cela se fait, par qui. À travers quelles expériences pratiques. Ce sont des démonstrations pratiques. Dans Portrait du Joueur, il y a beaucoup d’éléments, mais enfin il y a quand même l’auteur et, au centre, cette démonstration pratique. Sophie, dans Portrait du Joueur, c’est Sophie, ce n’est pas un personnage abstrait… Il y a des lettres, des dialogues, tout cela est très référentiel.
I. S. : Ce sont de vraies lettres ?
P. S. : Ah ! De vraies lettres, si l’on en est capable ! Ce n’est pas évident. Cela a beaucoup choqué à l’époque. Beaucoup de gens m’ont dit que je les avais inventées. Ce n’est pas vrai…
I. S. : On a probablement eu du mal à accepter l’idée que cela vienne d’une femme. La notion de désir féminin est encore très taboue.
P. S. : Voilà ce qu’il fallait démontrer…
I. S. : Vous êtes passé d’une forme romanesque, dite expérimentale, à une forme plus classique. La fameuse rupture des années 1980, dans votre œuvre en tout cas, provient-elle du déclin des avant-gardes, ou bien participe-t-elle de votre évolution personnelle ?
P. S. : C’est les deux. Je crois que tout cela est plein de malentendus. Il y a des périodes qui sont plus ou moins révolutionnaires et progressistes… Il est évident que les années 1960 s’acheminent nécessairement vers 68… Aujourd’hui, lorsqu’on parle de cela, on ne s’imagine pas ce qu’était le monde avant, avec la télé en noir et blanc, le peu de communication, etc. Tout change. Il y a le moment où je sens qu’il faut faire des choses radicales, donc j’écris Drame en 1965 et Nombres qui paraît en avril 1968. Cela paraît complètement décalé, mais pour moi, il était très important qu’il y ait des idéogrammes chinois dans Nombres, voilà… Les années 1970 sont, au contraire, des années de plombage, et c’est de là que je vais tirer, un jour, Femmes. Parce que Femmes raconte dix ans d’histoire, les dix ans des années 1970. Cela fait ce gros livre qui traverse un peu tout. Je suis en Italie, je suis aux États-Unis, le narrateur est américain soi-disant, bon, voilà… Mais en fait, si l’on regarde la période considérée, on s’aperçoit que je fais le portrait d’une époque. C’est une lutte entre quelqu’un qui est plus libre que les autres et qui trouve des obstacles. Alors, évidemment, les obstacles se présentent sous forme de femmes — négatives ou positives. C’est assez clair. C’est une démonstration. Là encore, je tire les leçons à travers une période historique. Même chose à travers les années 1980. Je multiplie les tentatives pour montrer l’organisation de ce que pourrait être une contre-société, une société de plaisir opposée à une société de contrôle… On y est. C’est le processus de sécurité : rentrez chez vous et soyez sages ! Ainsi, chacun de mes livres peut être daté très précisément selon la période considérée. C’est cela qu’il faut voir. Et, probablement, la gêne à mon sujet vient, beaucoup plus qu’on ne le dit parce que tout cela est recouvert par une sorte de propagande, de l’adéquation au moment historique. Ce que j’écris est adéquat au moment historique.
I. S. : Et c’est malvenu, aux yeux des critiques ?
P. S. : Eh oui, ils n’aiment pas ! Chaque fois, il faut éviter une récupération. Parce que, vous faites Tel Quel pendant vingt ans, et alors à ce moment-là vous avez des bureaux, des universitaires qui s’installent pour vous expliquer ce que c’est. Tout à coup, vous les réduisez au chômage… C’est pour cela que l’université me fait mourir en 1968, car je suis quelqu’un qui fait sauter la baraque… Ce qu’il faut voir, dans Portrait du Joueur que j’ai écrit en 1983-1984, c’est dans l’éventail d’expériences assez considérables, précisément, la version du contrat. Il faut insister sur ce point particulier. D’ailleurs, c’est la même chose dans Le Lys d’or que je fais un peu après : c’est le contrat féminin. J’expose quelque chose qui est en train de se renverser. Et l’on tient compte du fait que les rapports entre hommes et femmes sont à tel point en cours de changement, qu’on essaye de dépeindre la façon dont cela pourrait éventuellement remarcher : re-marcher… Aujourd’hui, cela ne marche pas. Les garçons et les filles se font des simulacres, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas… On revient à la séparation. C’est le grand thème debordiste : le monde de la séparation. La société veut contrôler les gens qui sont séparés et tout est employé pour ça : la famille, l’école, le marché… Donc j’invente, disais-je, à partir de là, un certain nombre de livres qui tous proposent des modèles de contre-société, ou d’expériences très singulières menées dans la clandestinité ou dans un coin du paysage. […] Voilà ce qu’ils aiment : voir des gens qui ne bougent pas. Si vous commencez à écrire des choses où le type qui se donne comme narrateur traverse plusieurs milieux, plusieurs expériences, qui va en haut et en bas, qui trace des diagonales, qui passe des frontières, qui revient, qui raconte ça, qui s’intéresse au dessous des cartes, qui est en train de dire qu’on ne dit pas la vérité mais que tout est manipulé… c’est ce que je fais, voilà ! Donc, je suis un écrivain très engagé. Finalement, ce qui choque, c’est l’engagement, alors évidemment, dans un sens très différent de Sartre. Mais Sartre, à partir du moment où il a eu la théorie de l’engagement, il n’a plus écrit de romans. Moi, je suis engagé dans mes romans, dans la vie comme roman.
I. S. : Est-ce le seul engagement qui vaille pour un auteur ? Et la politique ?...
P. S. : Mais je me moque de la politique.
I. S. : Pourtant, à l’époque, Tel Quel était une revue engagée, non ?
P. S. : Oui, mais en fait, c’était un jeu. Sans quoi, j’aurais été pétrifié ! Donc, c’est un jeu, et c’est très choquant parce que la vision politique du monde, c’est un clergé. Clergé universitaire, philosophique… Or, tout cela aboutit à des conséquences tout à fait visibles aujourd’hui, c’est que la politique est une mascarade. Comique ou sinistre. Ce n’est pas du tout ça qui est au pouvoir, en fait.
I. S. : Vous dites que l’écrivain doit être indépendant de tout système politique et institutionnel afin de ne pas se laisser localiser dans un groupe. Néanmoins, que vous a apporté la longue expérience du groupe Tel Quel ?
P. S. : Mais beaucoup de choses ! C’est l’expérience, justement, du contrôle, de l’aventure collective, qui implique des ruptures, des conflits. Maintenant, je n’ai plus besoin de m’inventer des conflits pour savoir ce que je vais faire, mais ce n’est pas mal comme expérience… Et des conflits qui ont parfois été extrêmement violents, des exclusions… Il y a très peu de gens que je revois de cette époque. On était sur un bateau sur une mer démontée, et il y a beaucoup de gens qui sont tombés à l’eau… Mais c’était très intéressant, parce qu’il y avait un but : reclasser toute la bibliothèque et surtout, montrer que les marginalités sont centrales : Artaud, Bataille, Dante, Joyce… C’est un gros travail qui nous sera reconnu un jour. Par exemple, il fallait traduire Dante enfin en français, ce qu’a fait Jacqueline Risset. Un jour, si vous voulez, au-delà des polémiques et du ressentiment universitaire, il y a un livre très facile à faire et que quelqu’un écrira où l’on reconnaîtra toutes ces valeurs, ce travail de reclassement des marginaux comme références littéraires… Mais ce déplacement des frontières a choqué aussi. Cela débouche très naturellement sur ce que j’ai fait dans des essais comme La Guerre du goût ou Éloge de l’infini, où je passe sans aucun problème de Pascal à Sade et de Sade à Artaud. On peut naviguer librement à travers les siècles. L’idée est encyclopédique. C’est un travail des Lumières.
I. S. : À la fois en marge et au cœur du monde, tel un « œil diamantaire », est-ce là la seule liberté que vous revendiquez ?
P. S : La vérité est paradoxale. Il faut se méfier, toujours, de l’absence de paradoxes. La vie est paradoxale : toujours dedans, dehors, dedans, dehors… Si j’arrivais à démontrer que toutes les classifications sont inertes, enfin, sont un désir de tuer… J’interroge le désir qui est là derrière. Le désir […] profond, humain, d’en finir avec l’art. « Je crois, dit Flaubert, à la haine inconsciente du style ». Donc, le point de vue, c’est que la société est mauvaise, quelle qu’elle soit. Il y en a de plus ou moins mauvaises, mais, la société, en tant que telle, est mensongère, mauvaise, avec un violent désir d’en finir avec l’art…
I. S : L’art n’est-il pas aussi un remède aux maux de la société ?
P. S. : Un « remède » ? Ah, non ! Je ne sais pas si je vous ai déjà cité ce mot de Durkheim, à savoir que depuis le XIXe, Dieu s’est transformé en société. Il y a eu Dieu, puis il est mort, c’est quand même un événement considérable… Il est mort, mais pas pour tout le monde, puisqu’il y a encore des gens qui essayent de le rejoindre en amont et qui se font exploser tous les jours en croyant aller au paradis… C’est ce qu’on appelle des kamikazes. Mais enfin, dans le monde occidental, planétaire maintenant, Dieu étant mort, la société prend la relève. Tout est social. Tout est défini comme étant social, c’est-à-dire que tout doit être le plus possible voué à la conformité du collectif, de la communauté, de la collectivité, de la nation ou de l’État… Or l’art, c’est l’individuation la plus radicale. C’est un individu qui « s’individue » de la façon la plus singulière. Et c’est imprévisible, imprévu, cela n’est pas souhaité, et cela crée des difficultés. Baudelaire vous dirait cela ainsi, dans Mon cœur mis à nu : « Les nations n’ont de grands hommes que malgré elles ». Par conséquent, le « grand homme », et cela vaut pour le grand artiste, est une force d’attaque comparable à la résistance de millions d’individus. Je crois que l’on peut dire vraiment, à partir d’une époque très précise, le début du XXe par exemple, qu’aucun chef-d’œuvre ou peinture n’est souhaité par la société. En plus, l’art renverse, montre le dessous des cartes, donc, personne n’en a envie, ni les familles, ni la société.
I. S. : Se placer en retrait du monde tout en en captant les moindres ondulations, à l’image de vos « œuvres-monde » ou encore de votre revue L’Infini qui agit comme un carrefour au croisement d’une profusion d’individualités et de tendances, est-ce pour vous la condition essentielle de l’artiste ?
P.S. : Oui, autant qu’on le peut on favorise des individualités très différentes, ce qui suppose qu’on a un certain don d’élan et qu’on peut aimer des choses très différentes, des personnes très différentes, des œuvres dans le passé très différentes les unes des autres… Et dans l’histoire concrète de tous les jours, des personnes qui ne pourraient peut-être pas se supporter les unes les autres, hommes ou femmes. Ce qui suppose qu’on fait attention à leur style et pas à leur personnalité apparente, c’est-à-dire sociale, puisque le moi social, comme dit Proust et très justement, est une construction des autres. C’est-à-dire, on me renvoie un Sollers qui n’est absolument pas moi. C’est d’ailleurs amusant, c’est excitant de voir la perception, les jugements, tomber à côté de la plaque…
I. S. : Vous semblez pessimiste à l’égard de la société… Croyez-vous que le « jouisseur », pour reprendre votre terme, soit une espèce en voie de disparition ?
P. S. : Pessimiste à l’égard de la société, forcément ! Toute société est mauvaise : plus ou moins, c’est tout. Moins, c’est évidemment par rapport à une société dite développée ou démocratique. Il n’empêche que c’est mauvais de toute façon pour l’artiste. Il y a une grande différence entre être exécuté, ou mis en prison, et le fait de pouvoir être tranquillement libre, enfin, de pouvoir s’arranger, quoi… […]
I. S. : Vous dites que vous ne voulez pas être pris pour un abstrait. Or, n’y a-t-il pas là une contradiction dans le fait d’introduire l’histoire tout en s’acharnant à éjecter la story ? Comment être figuratif tout en rejetant l’histoire elle-même ?
P. S. : Parce que ce qui gêne avec la story, c’est qu’elle est réductrice par rapport à l’« Histoire » (je mets un grand H) ! Vous prenez les livres, c’est évident… Vous avez un narrateur en situation : dans La Fête à Venise, il fait du trafic d’armes ; dans Femmes, il est soi-disant américain ; dans Passion fixe, il raconte une passion, mais il y a aussi beaucoup d’éléments qui sont liés à l’activité clandestine révolutionnaire de sa jeunesse… Si je fais simplement une histoire, je n’ouvre pas sur l’Histoire, ou alors c’est le roman historique, mais le roman historique, ce n’est pas intéressant non plus parce qu’il n’y a pas de vécu à la première personne. Donc, si vous voulez, là encore, pour tous ces mots : « histoire », « personnage »… il faut chaque fois produire un décalage. Vous avez un narrateur, il est là bien sûr dans une histoire donnée (il a des aventures, les femmes…), et en même temps son expérience ouvre sur des pans entiers de l’Histoire — sur l’intériorité, et aussi sur des époques différentes où il aurait pu exister et se comporter. C’est un peu comme dans le roman fantastique ou le roman métaphysique… Ainsi, dans Passion fixe, tout le monde se précipite sur des clés, mais personne n’a remarqué que tout repose sur la Chine… Qu’est-ce que cela vient faire là ? Eh bien, ce sont des rappels du passé pour les actualiser, justement. C’est étrange de voir quelqu’un qui se comporte brusquement comme s’il était taoïste, qui va en Chine au XXe siècle…
I. S. : C’est une « Histoire » détournée, en fin de compte ?
P. S. : C’est la manifestation de l’Histoire (avec un grand H) dans une situation historique (avec un petit h) donnée. C’est-à-dire qu’à la limite, le narrateur pourrait montrer qu’il vit là, mais qu’il pourrait aussi bien vivre a des époques très différentes. Il y a une sorte d’enchantement de l’Histoire… Si j’imagine que je vis un soir à Vienne et que je vois un concert avec un petit homme un peu pâle qui vient jouer du piano et qui s’appelle Mozart, évidemment, c’est fantastique… Supposons que j’étais là… Je crois que c’est dans Le Parc, déjà, où l’on a le « supposons que j’étais là à tel moment ». C’est une vision. C’est dans Paradis, beaucoup. Vous verrez dans l’édition critique de Paradis comme on peut montrer à quel point tout cela est codé. Par exemple, La Légende des siècles de Hugo… : « Le mur des siècles m’apparut ». Ce qui est embêtant avec la conception étroite du roman, c’est de manquer sa portée poétique. Or, ce que je cherche, c’est de ramener la poétique de tous les temps dans le roman, en situation.
.
.
.
.
I. S. : Vous confrontez donc sans cesse deux temporalités…
P. S. : Oui, c’est cela. Il y a une temporalité narrative et il y a en même temps le surgissement de pans entiers d’Histoire… Par exemple, dans ce que je viens d’écrire, il y a un narrateur et une femme, et puis tout à coup apparaît Antoine et Cléopâtre de Shakespeare… Dans Le Cœur absolu, c’est comme cela aussi. Tout corps doit être montré dans un énorme continuum de temps. Il ne doit pas être réduit à ses conditions sociale et temporelle d’existence. […]
I. S. : Tant sur le plan formel, avec vos romans des années 1960-70 qui heurtaient radicalement les formes traditionnelles, que sur le plan thématique, avec un roman comme Femmes, subversif par son aspect visionnaire (montée du féminisme, évolution scientifique et technologique, procréation artificielle, bioéthique, pouvoir des femmes…), votre œuvre est souvent perçue comme provocatrice…
P. S. : Mais il n’y a aucune provocation. Ce que la société appelle provocation, c’est quand on touche un point qu’elle ne veut pas voir.
I. S. : Vous cherchez à toucher ce point…
P. S. : On cherche la vérité, tout simplement. La « provocation », c’est le fait de dire la vérité. On a l’impression qu’il y a un mensonge, que tout le monde ment à propos de choses précises : on essaie de dire la vérité, c’est tout. Sartre, à propos de Genet, a dit « on pardonne bien plus une mauvaise action qu’une mauvaise parole », on essaie de dire la vérité là où on a l’impression que tout le monde ment. D’ailleurs, Femmes commence comme ça : « Le monde appartient aux femmes. C’est-à-dire à la mort. Là-dessus, tout le monde ment. »
I. S. : Vos premiers romans n’étaient donc que de purs terrains d’expérimentation ?
P. S. : Pour ce qui est des fondations : des textes de fondation, des pilotis, c’était un projet ; je me mets au travail et c’est l’expérimentation, cela vient avec la chose qui se fait. Parce que dès le début, j’insiste, et je crois être le seul à l’avoir fait à ce point, sur le fait que je suis en train de dire ce je fais : je suis en train d’écrire. C’est dans Drame : j’écris que je suis en train d’écrire…
I. S. : Que pensez-vous de la notion de baroque ? Trouvez-vous qu’elle puisse définir votre œuvre ?
P. S. : Oui, à condition de savoir ce que c’est… Parce que le mot baroque, c’est un adjectif que l’on emploie partout. Il faut le comprendre également dans une période historique très précise : le baroque en architecture, en musique, en peinture et en littérature a pu être une levée en masse de libertés à l’intérieur de controverses difficiles… Là, on commence à comprendre le baroque ! C’est lié à la Contre-Réforme, donc c’est une violente polémique religieuse. En musique, je vous le prouve avec Mystérieux Mozart ; dans la musique occidentale de l’époque, Mozart, c’est énorme.
I. S. : Le baroque surgit toujours lors de périodes de crises profondes…
P. S. : Absolument. Et si je vous dis que c’est l’art jésuite, alors cela va encore énerver la situation. Si l’on prend une carte du baroque, on se rend compte que c’est un phénomène européen, transnational : vous voyez que ce n’est pas national. À ce moment-là, on peut envisager que plus le concept de Nation sera fort, plus le baroque sera rejeté — ce qui est le cas des Français. Cela part de l’Italie, cela va en Autriche, en Pologne… Et les Français ont un problème avec la Nation : bleu-blanc-rouge ! La preuve, récemment ils passent du rose au bleu, c’est cocasse.
I. S. : C’est pour cet aspect contestataire que l’on peut qualifier votre œuvre de baroque, et votre écriture surtout ?
P. S. : Mais parce que personne ne sait de quoi il s’agit ! L’éducation française, laïque et républicaine, l’éducation « nationale » — elle s’appelle comme cela — est historiquement hostile au baroque. Je le montre dans Mystérieux Mozart. À cette époque, on ne peut pas faire d’opéra de Mozart en français. Il y en a en italien, en allemand, mais pas en français… Donc c’est une polémique intra-nationale. De ce point de vue-là, je suis atypique, puisque je me considère comme un européen d’origine française et que je déborde toutes les questions nationalistes. C’est gênant, quelqu’un qui bouge là où on voudrait que ça ne bouge pas.
I. S. : À travers vos nombreux essais et vos romans qui brassent des savoirs encyclopédiques, y a-t-il de votre part une volonté d’éduquer le lecteur, une certaine forme jubilatoire de didactisme ?
P. S. : Je crois que c’est Ezra Pound qui dit : « Tu es sadique, tu essaies de faire penser le lecteur !… » Donc, c’est du sadisme : joli, non ?
I. S. : Nous observons une vraie complémentarité entre vos œuvres fictionnelles et vos essais. Je pense particulièrement aux biographies que vous avez rédigées de Sade, Casanova, Mozart, Vivant Denon, et qui apparaissent indubitablement comme des autoportraits détournés de vous-même. Nous sommes très proches de ce que l’on a appelé l’« autofiction » ou encore, la « fictionnalisation du moi », caractéristiques du roman des années 1980. Par ailleurs c’est dans vos romans, bien sûr, que les références biographiques sont nettement plus explicites. J’en viens alors à me demander si la question du sujet intime, et plus largement de la biographie, ne serait pas centrale dans la littérature… Croyez-vous, en effet, que la littérature s’achemine naturellement vers le genre biographique ou autobiographique comme forme romanesque souveraine, dans la mesure où au fond chaque auteur, tout au long de son œuvre, ne fait que parler de lui-même ? La biographie, prise dans un sens très élargi, serait-elle aujourd’hui la question centrale des enjeux romanesques ?
P. S. : Oui, je crois, parce que de toute façon on voit, en lisant un livre, quelle est l’étendue de l’expérience d’un auteur, et s’il a une biographie intéressante. C’est quand même l’essentiel. J’ai inventé ce que j’ai appelé les IRM, c’est-à-dire les Identités Rapprochées Multiples. C’est aussi la question du multiple, de l’identité multiple, alors c’est très gênant pour quelqu’un qui veut avoir une identité figée [NB : Philippe Sollers précise dans un entretien pour la revue Regards : « Je est un autre qui peut être plusieurs autres. C’est ce que j’appelle avec ironie un système d’IRM, d’Identités Rapprochées Multiples. Je m’efforce de mettre en question “l’identité”. Notre identité est une convention sociale que j’essaie constamment de déjouer ».] Ce n’est pas de la biographie mais cela pourrait être de la mythobiographie… Je n’aime pas beaucoup le terme d’autofiction. « Auto » me gêne : il faudrait dire, au contraire, altérofiction ou hétérofiction, vous voyez. C’est autre chose. C’est-à-dire continuer à être le même dans des situations extraordinairement différentes, ou alors dans des personnages qui sont différents. On pourrait se balader dans toutes ces époques tout en restant le même sous des costumes différents. C’est une idée très ancrée, chez moi, qu’après tout il n’y aurait peut-être qu’un seul écrivain qui continuerait ses aventures à travers le monde… Le problème de la biographie est important en effet parce que l’on voit qui a, ou qui n’a pas, une biographie en acte ! Et finalement, c’est assez rare. Je crois que faire ma biographie va être quand même extraordinairement compliqué… Il faut mourir, pour cela ! Je m’arrange pour qu’elle soit extraordinairement compliquée à faire, c’est-à-dire qu’elle soit confirmée par les livres. On croit que tout ce qu’a fait Casanova, c’est de l’imagination car autrement il ne l’aurait pas écrit… Or tout cela est vrai. Alors, pourquoi a-t-on peur que ce soit vrai ?
I. S. : La peur du réel ?
P. S. : Il me semble.
I. S. : Le réel, c’est la mort ?
P. S. : Pas pour moi ! D’où vient l’idée que le réel, c’est la mort ? C’est religieux comme affirmation…
I. S. : La seule chose dont on ne peut pas douter, c’est bien de la mort, non ?
P. S : Je ne suis pas d’accord avec vous. Il faut douter de tout. Je ne crois à rien.
I. S. : Donc, vous n’avez peur de rien ?
P. S. : Non… Le coup de la mort, vous savez, pour faire tenir les gens tranquilles, c’est quand même très efficace ! Il faut tendre l’oreille à quelqu’un qui vous présente tout de suite la mort : en général, c’est un refoulement sexuel. Le sexe, c’est la mort. C’est religieux… Ce n’est pas la peur du réel, c’est la peur du sexuel. Il n’y a pas que le sexuel dans le réel. L’Origine du monde de Courbet n’est pas l’origine du monde, le monde n’est pas né d’un corps de femme. La mort est très survalorisée… Il y a une phrase de Raoul Vaneigem, qui a écrit le Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations au moment du situationnisme avec Debord, c’est un aphorisme excellent : « Le parti de la mort a un grand respect pour le malheur. » Il y aurait donc un parti de la mort… Donc, il y a le problème du masochisme, etc., de choses dont je parle ouvertement tout le temps. Je pique là, et de façon très précise.
I. S. : Le XXe siècle aura été, dans le domaine des arts, le siècle de la mort de la représentation. On a tout fait (peinture, littérature, cinéma, théâtre…) pour détruire le système mimétique qu’avait théorisé Aristote. Or, si l’on abolit la représentation, il ne reste que le réel, mais, il faudrait s’interroger, au fond, sur ce qu’est vraiment le réel. Question d’autant plus pertinente, qu’aujourd’hui, nous sommes entrés dans une ère de l’Image et du Virtuel…
P. S. : Le réel, ce n’est pas la réalité, voilà. Je m’appuie sur la représentation, mais pas du tout pour la supprimer : pour la mettre en abyme. Ce n’est pas la mort de la représentation, mais sa mise en abyme… Vous me dites « la mort » ; moi, je vous dis « la vie » : je défends la vie, sa mise en abyme pour mieux la mettre en perspective et la faire voir, pour mieux la faire encore exister. Par exemple, vous êtes devant un tableau de Cézanne, un des plus beaux : La Montagne Sainte-Victoire, et vous vous posez la question suivante : comment serais-je si je vivais dans le tableau ? Vous passez un jour dans un tableau — vous pouvez en prendre un autre, ce que vous voulez —, vous allez dans un musée et vous vous dites : voilà, aujourd’hui je vais vivre dans un tableau et que va-t-il m’arriver ? C’est amusant, parce qu’il y a beaucoup de choses à faire dans un tableau, s’il est très réussi.
I. S. : Vous inversez donc totalement le rapport…
P. S. : Exactement. Donc, pas de spectacle extérieur, mais entrer dedans, essayer d’éprouver ce que les personnages éprouvent. La Vénus de Titien : qu’est-ce qui lui arrive ? Ou l’Olympia de Manet : qu’est-ce qui se passe ? Pas de virtuel… Le réel, c’est l’acte. L’acte d’art réel. Le réel, c’est au bout du pinceau, au bout du stylo, du langage, au bout des doigts dans la musique. C’est cela le réel. Tout le reste, ce sont des images. La peinture n’est pas une image, ce n’est pas un écran de télévision — c’est un corps. Ce n’est pas platonicien. C’est pour cela que pour critiquer la représentation, la métaphysique, je vais m’appuyer sur différents secteurs qui vont essayer de déstabiliser cela, cette espèce de poids. Par exemple, je vais m’appuyer sur la Chine, et d’ailleurs en remarquant que la rencontre entre la Chine et l’Occident a eu lieu comme de juste au XVIIIe siècle. C’est à ce moment-là qu’il y a interpénétration. Alors là, on a un énorme continent qui surgit et qui interroge les autres, et pousse ainsi à ne pas rester comme cela, figé devant des images. Toute la « pieuseté » de la mise en image, de la représentation va être gênée par cette irruption, parce que la peinture est une chose violente. Rembrandt, c’est violent.
I. S. : Et selon vous, où va la littérature ?
P. S. : On évacue… La société vise à évacuer la littérature, le corps, et tout ce que cela implique. La littérature se défend comme elle peut, cela dépend du système nerveux, de la force de résistance des écrivains. On voit bien aujourd’hui la misère de la poésie, elle est terrifiante…
.
.
[1] Source https://books.openedition.org/psn/1636



