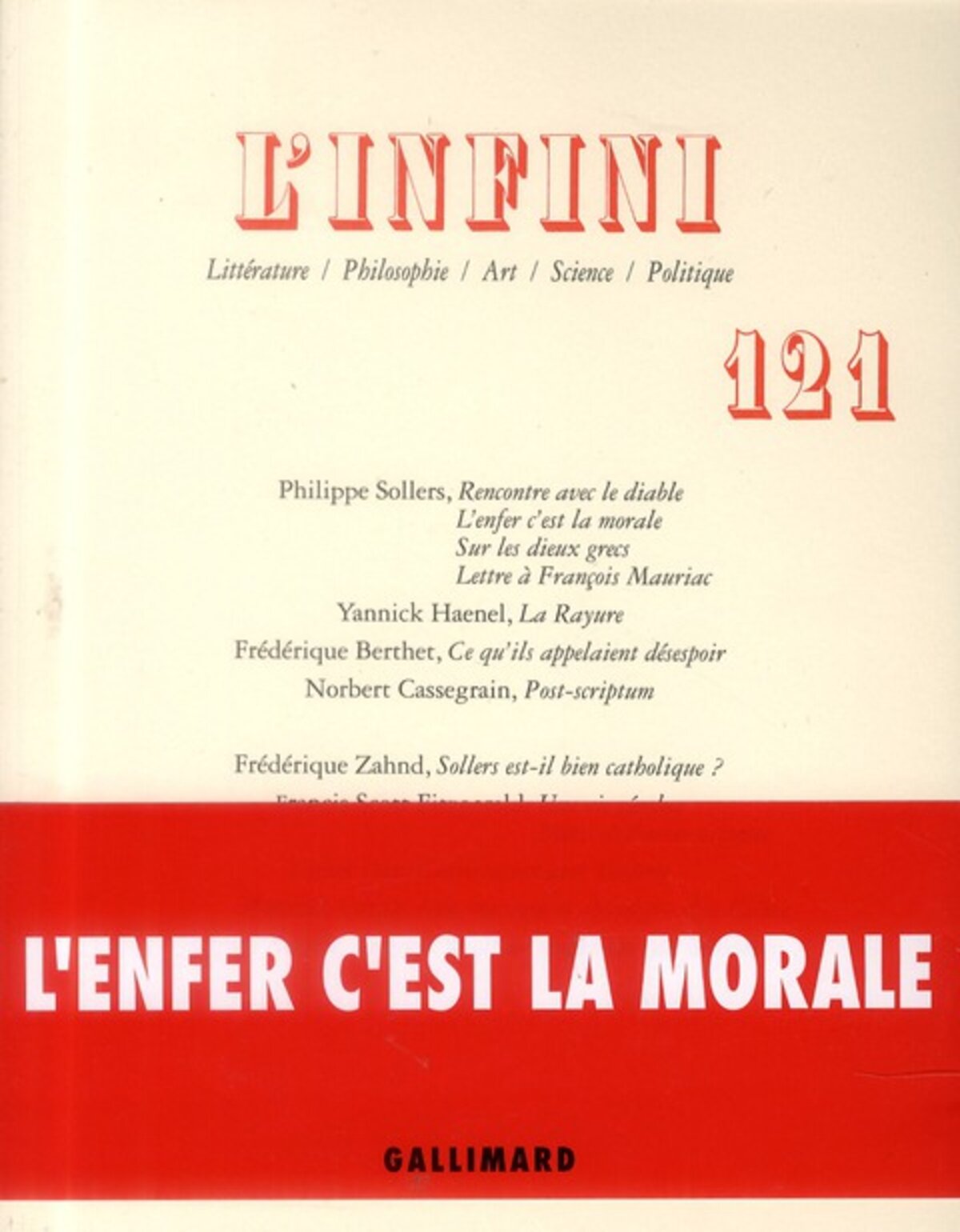
Agrandissement : Illustration 1
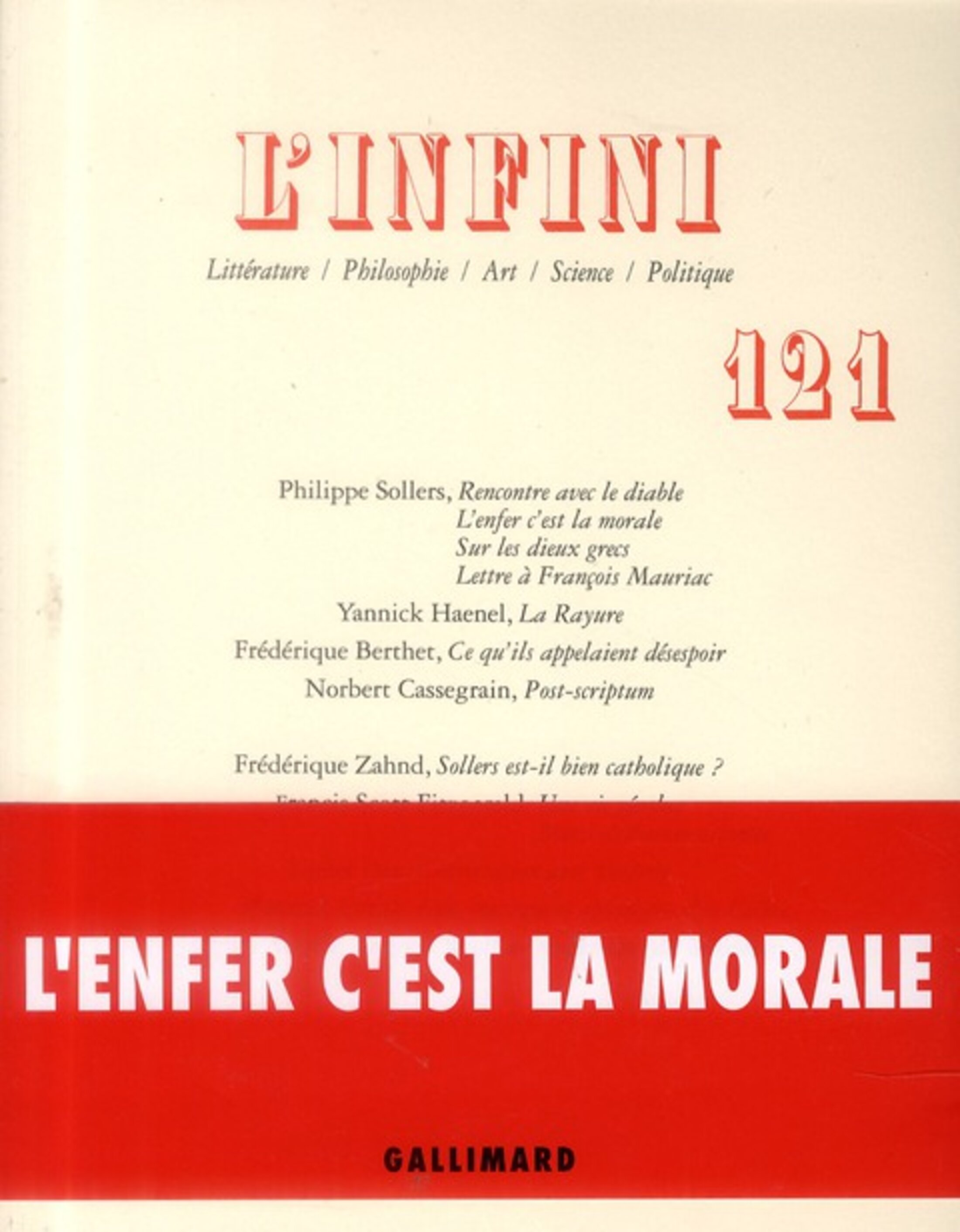
.
Extrait de « L’enfer, c’est la morale », entretien avec le philosophe et journaliste Aliocha Wald Lasowski, paru dans la revue L’Infini numéro 121, Gallimard, hiver 2012 [1].
.
.
––––––––
.
Aliocha Wald Lasowski : À travers les ruptures et les crises qui marquent l’histoire de la littérature, comment le déferlement du nihilisme croise-t-il le thème de l’enfer ou du déluge, qui va de Dante à Rimbaud ?
Philippe Sollers : Je suis en train de relire attentivement le Faust de Goethe et ses trois versions : Urfaust (Faust Primitif en 1775), Faust I de 1808, pièce dont la version est la plus connue, traduction par Nerval, et, enfin, le Faust II de 1832, texte le plus intéressant et le plus inspiré. Pourquoi Goethe a-t-il passé soixante ans de sa vie à tourner autour de ce personnage légendaire, héros populaire déjà connu dans les tragédies de Christopher Marlowe et qui prend avec Goethe une portée considérable, qui va faire de ce grand poème, car c’en est un, un mythe tout à fait prégnant ? Soixante ans. Il est mort là-dessus en quelque sorte, en 1832, à 83 ans. Pourquoi ? C’est l’époque charnière, entre Dante et Rimbaud justement. Ont eu lieu non seulement la crise religieuse de Luther, la Révolution française… et, enfin, ce qu’il faut bien appeler l’apparition, dont va se préoccuper Nietzsche, du personnage le plus inquiétant de tous : le nihilisme. On peut l’appeler Méphistophélès, voire Satan. Toutes ces composantes, qui partent dans tous les sens, dans Faust, ont lieu sous la voute de Dante. […] Dante est très méconnu, sauf « L’Enfer ». Qui s’occupe du « Purgatoire » et du « Paradis » ? Personne. Tout le XIXe siècle et le XXe siècle ont le nez collé sur « L’Enfer ». Nous sommes, sauf erreur, au début du XXIe siècle, dans un chaos planétaire très difficilement descriptible, mais il serait peut-être temps de faire un tri dans toute cette mythologie occidentale, d’autant que d’autres cultures frappent à la porte, avec d’autres paramètres et d’autres compositions, s’agissant du salut ou de la damnation, choses qui sont quand même des coordonnées à étudier. Si je m’installe en Chine, je vais trouver d’autres fonctions, d’autres descriptions, d’autres expériences.
A. W. L. : Que signifie cette nouvelle crise de la culture ? Que vise au juste le motif de la destruction ?
P. S. : « Je suis l’esprit qui toujours nie. » : Qu’est-ce que cette déclaration formidable qui résonne à travers tout le Faust de Goethe ? Première déclaration en bonne et due forme du nihilisme, à proprement parler. C’est une crise qui, dans le Faust, tourne autour de la hantise et de la volonté de puissance. Le diable est à son affaire dans le christianisme, puisque c’est le premier à être convoqué dans les Évangiles. Goethe tourne autour de ce problème qui hante encore la vision du monde et de l’humanité : l’amour.
Bien entendu, Freud a lu Goethe, l’Allemand indépassable de son temps, et a fait son possible pour débrouiller cette affaire. […] La fin du Faust II, à l’acte V, se déroule dans une très curieuse atmosphère, avec Dante et Shakespeare à l’horizon. Dans ce finale, le Diable se voit dépossédé de l’âme de Faust, que le cœur des anges vient lui ravir comme un trésor. Le Diable pense que tout ce qui existe mérite de périr, et qu’il vaut mieux que rien ne naisse pour s’en tenir au vide. C’est une condamnation de l’être humain en tant que tel. Il peut parfaire un objectif de destruction.
Au XXe siècle cet objectif nihiliste européen a pris des proportions dans lesquelles on s’embourbe facilement, en s’arrêtant à des effets de terreur. Oui, c’est ici Une saison en enfer, texte capital d’avril-août 1873. Je me crois en enfer, donc j’y suis : Rimbaud a parlé de l’enfer comme d’une saison, c’est-à-dire que ça ne durait pas plus d’une saison, ce qui est une invention bouleversante. La fin du texte, il faut la lire avec les Illuminations à côté : « Il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. » C’était encore une époque où l’âme avait en quelque sorte son poids. Il écrit aussi : « Mon âme éternelle / Observe ton vœu / Malgré la nuit seule / Et le jour en feu. » C’est Rimbaud tutoyant son âme. Le mot « âme » depuis est devenu obsolète. Y a-t-il une âme qui vive ? Ce n’est pas sûr…
A. W. L. : C’est donc la question de l’âme et du corps ?
P. S. : Dans le Faust de Goethe, esprit prophétique et extralucide pour son temps, il y a des propositions considérables sur ce point. Il voit venir et expérimente, il passe soixante ans avec le diable, il le fait parler, lui répond. Il voit venir la prise en main technique de la reproduction humaine. Tradition ésotérique et alchimique ; épisode fameux où le personnage de Wagner fabrique dans son laboratoire le petit personnage nommé « homonculus » et déclare, à l’applaudissement de Méphistophélès , que la reproduction « à l’ancienne » est une farce qu’il s’agit de dépasser. L’homme a une destinée plus haute, donc il est fabricable, transformable à l’infini. […] Dans une séquence extraordinaire du Faust, [Goethe] fait apparaître Hélène de Troie, et le passage célèbre : la descente, favorisée par Méphistophélès, chez les Mères. Le romantisme est une maladie. Goethe est formel : ce qui est classique doit être mis en avant. Il doit cette lucidité à son voyage en Italie, mais il faut rappeler le voyage de Freud en Italie, ou cette passion de Nietzsche pour le Sud.
A. W. L. : L’Italie, le Sud, c’est un moyen de sortir du gothique ?
P. S. : C’est la question : comment arriver, Diable ou pas, inconscient ou pas, pulsion ou pas, à sortir de quelque chose qui est comme éternellement dans le Nord la banlieue de l’Enfer ? Mais l’Enfer attire beaucoup plus que le Paradis. L’Enfer, c’est plus intéressant, paraît-il : pétrification, glaciation, aphasie de plus en plus fortes. Le Paradis, c’est plus difficile, ce sont des tourbillons, des langues de feu… Et surtout, le Paradis, c’est in-filmable. Le cinéma, qui est désormais la règle absolue de la représentation, peut mettre en scène autant que vous voulez de l’infernal. Il faut que ça coince. Comme Freud qui découvre Charcot présentant ses hystériques… En 1980, j’ai fait la préface d’un livre intitulé Les Démoniaques dans l’art. J’y rappelle que Charcot explique au jeune Freud, qui suit ses cours à la Salpêtrière à Paris, que seule compte la chose sexuelle. Freud est étonné : c’est curieux, Charcot ne dit jamais ça en public. Freud, lui, l’a fait, ça donne des résultats très quantifiables.
Qu’on le veuille ou non, on reste toujours en enfer : c’est ce qui donne le spectacle et le cinéma. Quelqu’un qui a fait le diagnostic du spectaculaire, où la caverne de Platon à côté est une villégiature, c’est Guy Debord, dans son film de 1978, In girum imus nocte et consumimur igni, formule latine qui se lit dans les deux sens et signifie « nous tournons dans la nuit et nous sommes consumés par le feu ». Nous sommes dans une séquence de l’Enfer. C’est au cinéma même qu’il s’attaque. En noir et blanc, sans jamais la couleur. Attaque contre le spectateur passif contemporain.
A. W. L. : Le feu, le démoniaque, le cinéma… l’enjeu, c’est ici la représentation ?
P. S. : Si vous n’avez pas accès aux cinq sens à la fois… C’est l’aphorisme, sous forme de devinette, de Lichtenberg : « Il y a très peu de choses que nous pouvons connaître avec les cinq sens à la fois » — la réponse étant l’amour. […] C’est parce qu’il y a une audace dans la représentation que l’on peut mieux saisir ce qui s’est passé dans l’art français. D’où L’Éclaircie, mon dernier roman, avec la rencontre Manet-Picasso. Par exemple, on voit bien que Manet reste encore aujourd’hui tout à fait méconnu. Olympia, Le Déjeuner sur l’herbe ont suscité une telle haine à l’époque, et encore aujourd’hui (lisez l’article débile qui vient de paraître dans Libération le 21 juin 2012). Moment très étrange de peinture et de poésie, c’est l’expérimentation de quelque chose de néantisant.
Ont été contemporains Manet, Lautréamont, Rimbaud et, un peu plus tard, Cézanne. C’est quelque chose qu’on ne comprend plus aujourd’hui.
A. W. L. : Quelle est la place de ce moment esthétique dans l’histoire culturelle ?
P. S. : Cette place reste unique. Récemment, à l’exposition Manet du musée d’Orsay, j’ai vu le public ne rien voir. Au point qu’on pouvait regretter le temps où les tableaux de Manet pouvaient encore choquer. Il n’y a plus de scandale aujourd’hui. Notre société a atteint sa vitesse de croisière du nihilisme, indélogeable. Pas la peine de s’indigner. Il faut trouver sa voie solitaire, à l’écart. Plus de Paradis, Dieu est mort et se décompose de façon de plus en plus nauséabonde, et la société, devenue Dieu, s’appelle les marchés financiers. Car le moment où le sexe et l’or changent profondément de nature est le moment où, chez Goethe, le vieux Diable lui-même trouve que quelque chose n’est plus comme autrefois. Je ne vous dirai pas où va nous mener la formidable tornade bancaire actuelle : il n’y a pas de fin. Quelle pourrait être la fin d’ailleurs ? Je ne vous dirai pas non plus ce que devient un objet de soufre et d’idéal comme le sexe ou l’amour. L’apocalypse, vous aurez une impression fallacieuse que nous n’y sommes pas encore. Quelle illusion ! Ce fonctionnement de la société (l’argent fou, la publicité, la mode) est une des nouvelles nervures de l’Enfer, où le temps lui-même est attaqué à la racine. Ce qui s’est passé ce matin est déjà obsolète et terminé.
.
.

.
.
A. W. L. : L’apocalypse, aujourd’hui, ce serait la disparition du temps…
P. S. : Il y a beaucoup de choses qui se passent et sont immédiatement effacées. Une violence en remplace une autre ; un drame chasse l’autre. Le personnage principal de ce tragique opéra, c’est la mort — « le maître absolu », disait Hegel — qui ne terrifie plus personne. Voyez-vous, ça n’a pas été sans débats séculaires. Faust, c’est ça : la naissance, la mort. À son époque, Isidore Ducasse a vu venir cette disparition du temps. Seule solution, se vouer à la littérature, à l’écrit. Mais ce qu’il faut se demander toujours, c’est ce que les gens ne veulent pas savoir. Seule question désormais digne d’intérêt. Il y a un roman de Nabokov qui n’est pas assez célèbre, c’est La Vraie Vie de Sebastian Knight, son premier roman écrit en anglais et dont il avait tort de ne pas être content. C’est un homme qui veut faire la biographie de son frère, un écrivain, et qui s’arrange pour ne pas enregistrer ce qu’on pourrait lui dire de véridique. Roman très subtil, très diabolique, et formidablement construit par Méphisto-Nabokov. Aucun succès à sa sortie. Le lecteur est immédiatement pris au piège, obligé de découvrir pourquoi ce curieux biographe ne veut rien savoir. C’est un procédé très habile. Chaque fois que le héros pourrait savoir, il refuse aussitôt. Ce roman de Nabokov annonce l’être humain de notre temps, possédé par la volonté de ne pas savoir.
[…] Le Diable est là pour calculer, il n’est pas là pour penser. Il est là pour essayer d’empêcher la pensée ou la poésie — ce qui revient au même d’un certain point de vue. La misère de la poésie et la misère de la pensée sont étroitement liées. Ce n’est pas Misère de la philosophie qu’il faut écrire, comme Marx l’a fait en 1847. Aujourd’hui, ce serait Misère de la pensée, misère de la poésie. Vous en voulez la démonstration ? Prenez l’expression « esprit de vengeance ». Qu’est-ce que l’esprit de vengeance ? C’est, dit Nietzsche, le ressentiment de la volonté contre le temps et son « Il était ». C’est une question sur le temps et le passage du temps. L’esprit de vengeance, vous en avez la preuve minute par minute si vous êtes sensible à ce qui se dit dans ce qui évite de se dire. C’est curieux : la volonté préfère vouloir le rien plutôt que ne rien vouloir.
[…] L’apocalypse, c’est la misère. L’Enfer, c’est la morale. Dès que vous entendez un jugement moral appliqué à telle ou telle œuvre, s’il y a œuvre, vous pouvez être sûr que c’est un possédé qui vous parle. Or, ça n’arrête pas.
A. W. L. : Donc l’Enfer est mesurable ?
P.S. : Après tout, l’Enfer est une expérience qui peut être vécue comme une saison, nous l’avons dit. On peut y être et, ensuite, en sortir. Mais c’est très grave. Parce que, en principe, on n’en sort pas. Pas plus que de la mort elle-même. À moins qu’un fou ne prétende que vous allez ressusciter un jour, ça a eu lieu et on en parle encore. La confusion à ce sujet est extrême, « Mort où est ta victoire ? Où est-il ô mort ton dard venimeux ? La mort a été engloutie dans la victoire. » : ce sont les exclamations triomphales de saint Paul dans la première Épitre aux Corinthiens. À propos de l’apocalypse, il faut se demander : y a-t-il un jugement sur le diabolo et sur l’étang de feu ? [2] L’Apocalypse est un texte magnifique : l’ange et le diable, la mort et la résurrection. Tout est déjà là. Après, on passe à Anges et Démons, le roman de Dan Brown. Turbulence au Vatican, menace des Illuminati… pauvre pape : à 85 ans, quel boulot. Souvenez-vous de la célèbre invective placée par Corneille dans la bouche de Camille, à l’acte IV de sa tragédie de 1640, Horace : « Rome, unique objet de mon ressentiment. » Esprit de vengeance.
A. W. L. : Comment alors éviter la tragédie infernale généralisée ?
P. S. : Pour ma part, je pourrais vous dire que La Divine Comédie m’aide à vivre et que j’ai fait un livre pour suivre ce texte sublime vers après vers. Mais est-ce vraiment raisonnable de le dire ? L’Enfer, c’est la misère et la laideur. Nous y sommes. Après tout, vous prenez les sorcières de Macbeth, une des scènes fameuses : le beau est laid, le laid est beau, le vrai est faux, le faux est vrai. Vous êtes chez les Mères. Quelle apparition soudaine. C’est du cinéma. Un film pourrait-il rendre d’ailleurs la force de cette malédiction ? L’image de l’Enfer est-elle possible ? Le diagnostic de Nietzsche est à retenir, quand il dit : « Plèbe en haut, plèbe en bas. » Ce mot, « plèbe », est très fort chez les Romains. En bas, il y avait les mauvais instincts, alors qu’en haut, quand même, il restait quelque chose. Non, tout le XXe siècle nous a démontré le contraire : désormais, il n’y a plus de hiérarchie. [3] Avec Nietzsche, il faudrait inventer une nouvelle noblesse de la pensée. Impossible aujourd’hui où règne la violence. Avec la mort, le « Tu ne tueras pas » biblique est déjà dépassé. Voilà ce qui arrive, entre l’or, le sexe et la mort : le nouvel Enfer, à peine climatisé.
.
.
Notes :
[1] Le texte a ensuite été repris dans le recueil d’essais Complots, Philippe Sollers, éditions Gallimard, septembre 2016. http://www.pileface.com/sollers/spip.php?article1762
[2] Diabolo fait référence à l’étymologie grecque du mot Diable : diabolos, le calomniateur, le séparateur. L’étang de feu est le châtiment réservé par Dieu à Satan et à ses anges : contrairement aux humains arrivant en enfer qui, étant physiques, y finiront détruits par le feu qui est physique, ceux-ci, esprits non physiques, y sont tourmentés pour l’éternité.
[3] « “Le désert s'accroît”, disait Nietzsche. Il y a 123 ans, il posait déjà toutes ces questions sur le nihilisme de l’époque, la misère intellectuelle et la misère tout court, qui sont constatables partout, à chaque instant... Une autre actualité de Nietzsche m’intéresse. C'est quand il énonce, dans la foulée de “la mort de Dieu”, que, désormais, ça va être “plèbe en haut et plèbe en bas”. Autrement dit, nous avons perdu le sens d'une hiérarchie des valeurs, du goût, des pensées, tout ce qui définit l’ensemble d’une civilisation. Il se demande : “Qu’est-ce qui est encore noble ?” Ce qu’il appelle l’aristocratie a disparu. Bien entendu, il ne s'agit pas d’une noblesse de privilège, tombée avec la Révolution, il ne s’agit pas non plus d’admirer les mariages princiers ou d’applaudir la “peopolisation” à outrance, qui sont la vulgarité même, de gros spectacles plébéiens, voracement avalés par la foule. Voyez la grande cérémonie à Londres pour le mariage de ce prince. Plèbe en bas, dans la foule, devant les écrans, plèbe en haut, où les people se battent pour être assis près de la reine d’Angleterre. Qu’est-ce qui est noble ? Ce n’est donc pas une noblesse de privilège ou de nouveaux riches, de stars, mais la noblesse d’esprit, la nouvelle déclaration des droits de la noblesse d’esprit, des esprits libres libérés de “l’instinct du troupeau”. Et où la trouve-t-il ? Chez les Grecs bien sûr. Mais aussi dans l’esprit français, les Lumières françaises. Il admire Voltaire, à qui il dédie Humain, trop humain, Voltaire qui a pour lui la qualité du Grec antique, la vitesse d’esprit, le goût pour le style, l’intérêt pour la langue mais aussi l’humour, l’insolence française et ce refus de l’abêtissement religieux... » (Philippe Sollers, « Où en sommes-nous avec Nietzsche ? », entretien avec Frédéric Joignot, Le Monde, Hors-série Friedrich Nietzsche. L’éternel retour, juin 2011). Texte en entier sur le blog de Frédéric Joignot : https://www.lemonde.fr/blog/fredericjoignot/2023/05/11/philippe-sollers-disparait-deux-grands-entretiens-sur-voltaire-et-sur-nietzsche-lironie-est-pus-aiguisee-que-le-blaspheme-le-nihilisme-deteste-la-joie-et-la-vie/
.



