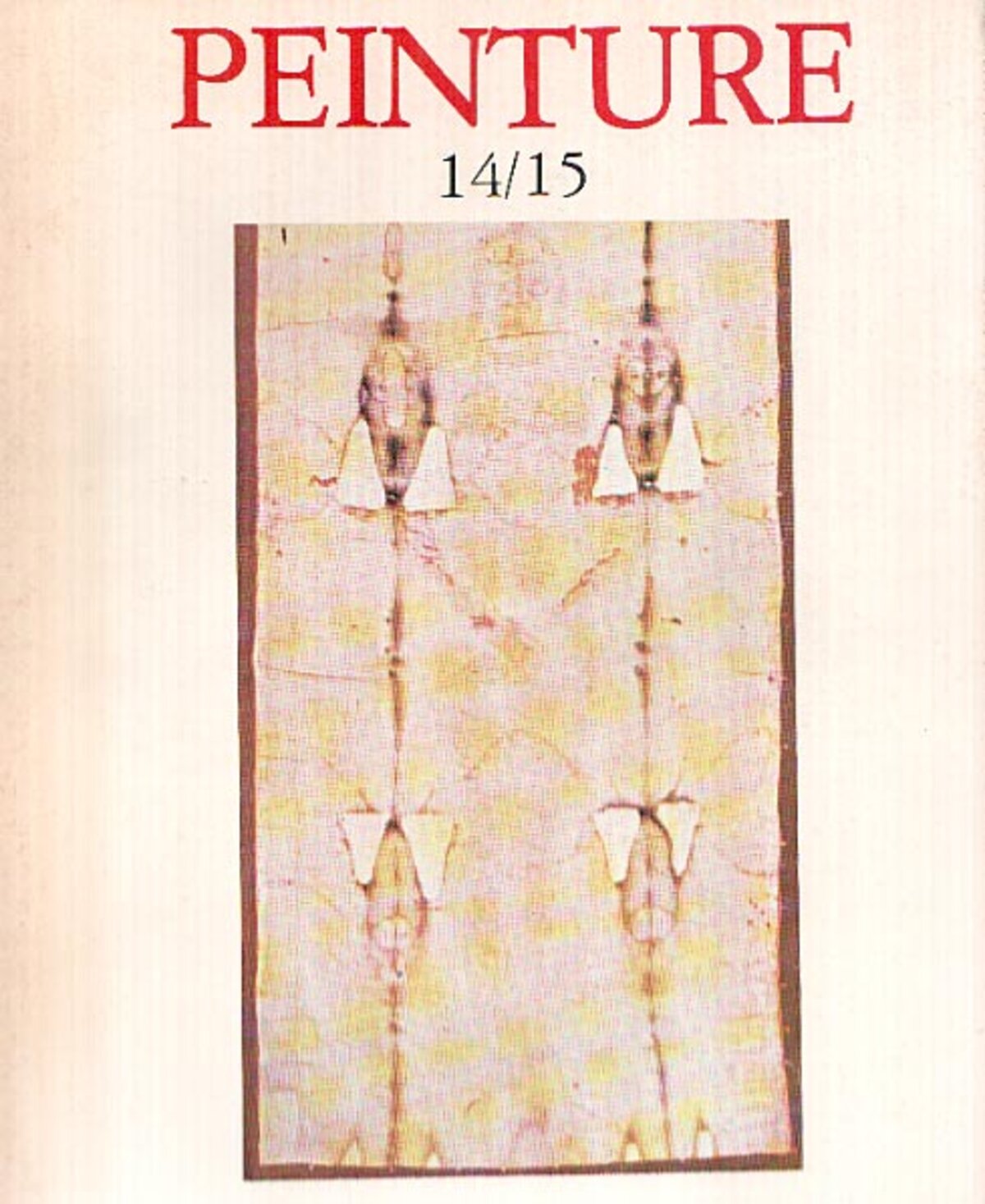
.
Entretien avec avec les peintres Louis Cane et Marc Devade pour la revue artistique Peinture. Cahiers théoriques, numéro 14/15, en décembre 1978 [1].
.
.
––––––––
.
Louis Cane : Quel rapport y a-t-il entre votre travail d’écrivain et les Écritures ?… Pourquoi le style d’écriture de Paradis vous conduit-il à évoquer les religions ?
Philippe Sollers : […] Ce qui m’intéresse, ce n’est pas du tout la religion. Pour que les choses soient très claires, pour éviter tout malentendu, je ferai une affirmation de position radicalement areligieuse. S’il m’arrive, de temps à autre, de mettre l’accent, non sans humour il me semble, sur le catholicisme en tant que matrice d’une certaine élaboration esthétique pour l’histoire occidentale, c’est que je considère — et je pense que cela peut se prouver — qu’un certain dépassement du religieux se trouve précisément dans cette configuration catholique. Ce n’est pas la vraie religion, comme disait Pascal, c’est le lieu du moins de religion possible. En quoi, bien entendu, ça m’attire, sauf à démontrer que, par une position antireligieuse ou areligieuse de type rationaliste, on obtient effectivement un moins de religion par rapport à cela. Or l’histoire des deux derniers siècles, à mon sens, démontre qu’à vouloir à toute force se mettre à la place de l’Église catholique — car c’est ça, le fantasme fondamental de toutes les révolutions qui s’enracinent dans la Révolution française — on obtient, pas du tout comme on le croyait, un moins de religion, mais un plus de religion. Ce qui fait que pour l’histoire occidentale et pour l’histoire tout court, le malaise est de découvrir que l’endroit du moindre religieux reste, ni plus ni moins, la structure catholique. C’est démontrable (ce qui ne veut pas dire que ça peut convaincre n’importe qui).
Pourquoi est-ce que c’est le lieu du moins de religion ? Bien entendu, il va falloir se demander d’où ça sort. Eh bien, en effet c’est une histoire fondamentale du discours. C’est une histoire du discours pour la bonne raison qu’il se passe à l’intérieur du judaïsme cet événement qui s’appelle la position trinitaire. Vous voyez, je reviens toujours sur ce point [N.B. : explicite, selon Sollers, dans l’écriture exprimant « le passage du sujet à sa trinité : J’écris, donc je ne suis pas ; j’écris, donc je suis l’Autre ; j’écris, donc je dis que je ne suis pas et que je suis l’Autre » (extrait de « Le Tri »)].
Ce qui fait qu’aujourd’hui, quand on va vous dire que le grand débat est depuis toujours et de nouveau entre monothéisme et paganisme (formulation, par exemple de Lévy), et j’irai jusqu’à dire : entre mono et démono-théisme, je suis bien d’accord, mais il ne faudrait pas oublier qu’il y a quelque chose qui, en effet, se présente comme n’étant ni païen ni strictement monothéiste, qui se situe non pas entre les deux, mais dans une position de décrochage très bizarre, c’est ce qu’on pourrait appeler en quelque sorte un monotrinisme, et c’est bien ça qui, moi, m’intéresse parce que j’ai l’impression qu’il s’agit là de la position la plus profonde et la plus étendue qu’on peut prendre par rapport au discours ; la question de l’art étant pour moi dérivée d’une question fondamentale qui est celle du langage verbal avant tout. L’art, ça n’est jamais que de l’hyperverbal ou du transverbal dérivé. Je vous illustre ça d’un exemple très simple. Vous prenez la Bible, ce qu’on appelle l’Ancien Testament. Comment ça fonctionne aux endroits particulièrement stratégiques, c’est-à-dire bien entendu au moment où Dieu parle ? De la façon suivante — je prends un exemple dans le Livre des Nombres : « Et Dieu parla à Moïse, disant : “parle”. » Vous retrouvez ça constamment : Dieu parla, disant : parle. Dieu dit, disant : dis. Qu’est-ce que ça montre ? Une position de l’énonciation au passé car, en un sens, Dieu est ce qui est toujours déjà passé, lorsque quelque chose se fait entendre ; une dimension de participe présent et ensuite une dimension impérative. Et Dieu parla à Moïse, disant : parle aux enfants d’Israël et dis-leur. Et Dieu parla, disant : dis à eux et dis-leur quelque chose. Après ça, il s’ensuit un certain nombre de recommandations et de prescriptions pour se faire en quelque sorte son trajet dans le temps et l’espace, ainsi qu’une possibilité de s’y reconnaître dans la réalité. Le réel, avant d’en arriver à dire ce qu’il faut faire dans la réalité, passe par un certain nombre de détours. Ce sont des coudes de la position du sujet de l’énonciation. Il a besoin, ce sujet-là, pour dire ce qu’il faut faire dans la réalité aux enfants, de partir d’un passé qui se participe-présente, qui s’impérative et qui se redouble dans l’impératif, pour aboutir à quelque chose qu’on appelle l’Écriture. Après quoi, vous pouvez passer votre temps à ruminer, réciter et balbutier ça dans tous les sens.
[…] Voilà pour ma première réponse. Cette nervure de la Bible : et Dieu parla, parlant pour dire : parle, et parle à eux et parle-leur ce que je te parle là, c’est ce qui fait Écriture. Et c’est parce qu’un sujet, une fois, est venu se placer en ce lieu de la parole, ce sujet qu’on appelle le Christ, qu’il y a ce qu’on appelle le Nouveau Testament, qui n’est pas du tout un fait d’écriture mais un fait d’incarnation de la parole. Incarnation de la parole qui implique qu’un sujet surgit pour dire : si vous êtes comme moi, ou un avec moi, eh bien vous serez au lieu-même où ça parla-parlant-parle. « Ce que je dis comme il me l’a dit je le dis » (Jean, 12 51). Ça a produit un certain nombre de conséquences, que je dirai être le fait que le Christ est le premier et le seul athée sérieux, qui résout par l’abandon, par la douceur, par le contraire absolu de la violence, la violence qui se dit dans toute écriture. Violence par rapport à quoi ? À Dieu ? Mais non : à la position du sujet dans le discours. Qui résout donc, envers et contre tous, et pour tous, cette bizarre hallucination qui fait que nous croyons que le langage nous serait infligé comme un coup.
.
.


.
.
[…] Dieu n’est pas un artiste, a dit Sartre. Quelle erreur ! Quelle formulation incroyablement naïve ! Il suffit de regarder comment ça procède pour voir qu’au contraire cette histoire de Dieu relève précisément du très grand art. Tout cela n’est compréhensible que par le biais subjectif de l’art. Parce que c’est bien la question du sujet lui-même en personne, et je dis même en trois personnes. […] Vous savez qu’il y a une représentation du divin qui consiste à mettre un œil dans un triangle. Vous avez ça sur le dollar. Une pyramide tronquée, inachevée, en cours, inachevable, et puis vous avez au-dessus le triangle avec un œil : ça, c’est ce que j’appelais tout à l’heure se mettre l’œil dans la bouche ou dans le sexe féminin, si vous voulez, pour maintenir cette idée, très importante pour l’espèce, qu’elle serait en quelque sorte regardée depuis son origine, et surveillée comme ça tout au long des générations. Ça permet de donner un fantasme très consistant, parce que toutes ces histoires de religion, de religiosité, ça part de certaines affectations de parties du corps qu’on suppose au grand Autre, ça permet de se munir de ce fantasme qu’on serait vu par Dieu. « L’œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Vous pouvez réifier ça, ça donnera en quelque sorte l’emblème le plus adéquat de ce qu’il peut en être de la police de l’espèce. Une forme en quelque sorte policière, une conception policière du divin. Il n’y a pas un religieux qui ne mise sur ceci qu’il y aurait une fonction policière de Dieu. […]
Marc Devade : À propos de tout ce que vous venez de dire, je suis en train de réfléchir sur deux peintres, Newman et Rothko. Deux peintres juifs, et Thomas Hess a bien montré en quoi la Kabbale avait pu influencer Newman, par exemple. Et ces deux peintres, curieusement, ont chacun fait quelque chose qui se rapportait au Christ. L’un a fait un Chemin de Croix, et l’autre a fait une Passion. Et, à la différence de toute la peinture de la Renaissance, ce Chemin de Croix et cette Passion ne représentent jamais le Christ. On est dans la pure présence, disons, d’un signifiant toujours différé qu’on ne nomme jamais directement. Donc, tout de même, ils se sont approchés là d’une question qui nous touche de près, mais sur un mode tout à fait différent. […] Le Christ est en jeu là-dedans, mais d’une façon tout à fait différente de ce qu’il était pour la peinture de la Renaissance.
L. C. : Ce que Devade dit là, c’est le problème de la vocation. C’est ça chez Joyce en tout cas : la recherche de la vérité de son activité artistique. Le Christ incarne la vocation dans la vie — dans la vérité de la vocation —, c’est ce qu’il nous lègue en tout cas comme religiosité ; les mystiques, c’est ça aussi et chez les très grands écrivains, c’est ça aussi. L’idée de la vocation nous agitant comme artistes, si je puis dire…
P. S. : C’est bien pour cette raison que, dans les questions que vous me posez, me paraîtrait tout à fait stérile une opposition tranchée entre judaïsme et christianisme […]. Ce serait répéter un geste très renaissant ou très classique, ce qui revient au même, que d’opposer judaïsme et christianisme. Sans parler du fait qu’à se fixer sur ce simple registre, on choisirait de ne pas faire attention à ce qui est en train d’arriver, à savoir le troisième partenaire qu’est l’Islam, extrêmement important pour les temps que nous vivons, sans parler d’autres partenaires qui nous tombent dessus depuis un siècle et demi, à savoir l’Inde ou la Chine. Vouloir se limiter à une simple confrontation entre judaïsme et christianisme me paraîtrait une attitude finalement assez, je disais, classique, mais du même coup, si nous sommes à l’époque moderne, on peut ajouter ignorante. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas là un enjeu fondamental pour notre culture, enjeu que je crois être en cours de dénouement.
Je prends les choses par la négative. Si j’étais païen, si j’étais violemment opposé à tout questionnement du monothéisme, de la Bible, si j’étais donc par définition antisémite, antijudaïque, antichrétien — parce que ça revient au même —, autrement dit si j’étais nazi aujourd’hui, à supposer qu’il y ait du nazi dans l’air — ce que je crois, je ne vois pas pourquoi le nazisme serait une pure et simple concrétion délirante d’un petit moment de l’histoire, pourquoi il ne serait pas, en effet, le symptôme de quelque chose qui suit son cours depuis toujours —, si j’étais nazi, eh bien je pense que je m’attacherais à empêcher par tous les moyens une conciliation entre juifs et chrétiens. Si j’étais nazi — en ne me présentant pas comme tel, bien sûr, mais comme l’homme d’une sorte de raison avertie —, je m’attacherais à contrecarrer, disais-je, par tous les moyens l’apparition du fait que l’Ancien Testament, le Nouveau Testament, c’est la même chose. […] C’est-à-dire, j’essaierais de persuader le plus de juifs possible qu’il faut qu’ils restent sur une position de critique, de méconnaissance du christianisme ; j’essaierais aussi d’empêcher que les chrétiens s’intéressent à l’Ancien Testament. […] Bref, j’essaierais de diviser pour régner.
Pour revenir à votre question, je trouve très intéressant que Newman ait fait tout ce qu’il a fait, je ne veux pas y revenir… Un petit détail cependant : dans le Chemin de Croix de Newman, c’est son marchand, comme vous le savez, qui a appelé « Résurrection » le dernier. Il y a eu comme qui dirait une hésitation. Newman ne l’a pas nommé « Résurrection », il l’a appelé « Be » : Être, sois. Si « Be » (être, sois), ça peut éviter une fantasmatique débile autour de l’affaire de la résurrection, je ne vois aucun inconvénient à ce qu’on appelle ça comme ça. Je ne vois pas pourquoi non plus on serait obligé, pour parler de cet événement interne au discours, de peindre des corps. Ça peut être un moment, comme ça… On peut faire n’importe quoi avec la représentation. […] Ce qu’on peut dire, c’est qu’il y a une dramaturgie chez Newman et Rothko que vous avez cités en quelque sorte angoissée. Moi, je ne sens pas dans cette aventure quelque chose qui ait la même valeur de discours que, par exemple, ce qui se passe avec Matisse. Mais chacun ses goûts.
M. D. : Chez Matisse, il y a de la représentation de corps. Je crois que c’est très important, la différence entre Newman et Rothko, par exemple, d’un côté, et Matisse de l’autre.
P. S. : Il faut regarder comment ces gens se débrouillent avec l’histoire de la femme, avec l’affaire-femme : la ferfemme. La ferfemme, c’est le cas de le dire, ça y croit dur comme fer, et c’est pas obligatoire qu’un sujet s’en arrange. Pour comprendre ce côté-là, il faut aller non pas vers la question du Christ, mais vers la question de la ferfemme. Il y a beaucoup à parier que, par exemple, Matisse passe mieux le détroit. Si vous préférez, il s’arrange mieux, de façon plus heureuse — ça compte. Le fait que tout ça rende finalement plus ou moins heureux… Je ne vois pas l’intérêt de s’occuper d’art si c’est pour déboucher nécessairement sur le funèbre. Il y a fort à parier que quelqu’un comme Matisse — ou quelqu’un d’autre, Mozart, si vous voulez — croyait moins que d’autres à cette affaire-femme. Autrement dit, si vous préférez, qu’il pouvait fréquenter de façon plus détendue des prostituées. Oh ! qu’est-ce que j’ai dit, des modèles, des odalisques, enfin des femmes… Les femmes s’intéressent, comme vous le savez, beaucoup aux alentours de l’art. Et pour cause. Elles y sont intéressées d’une façon massive parce qu’elles sentent bien qu’elles y seraient en quelque sorte doublées. C’est pourquoi un artiste a beaucoup à faire avec ce que j’appellerai la proposition permanente de sa doublure féminine, qui ne manque pas de lui arriver dans son existence. Il y a un cas fameux sur lequel on n’insistera jamais assez dans l’art moderne, c’est ce qui est arrivé à ce pauvre Pollock sous la figure de l’épouvantable Lee Krasner, dont vous pouvez voir les déjections au Musée d’Art Moderne de New York. C’est vraiment une des choses les plus laides qu’on puisse y voir.
Bon, je ne veux pas relancer cette affaire de veuve, de surveillante, de nourrice, de préceptrice, de majordame, mais enfin il faut bien voir qu’un artiste, c’est quelqu’un qui a affaire — c’est pour ça que j’évoquais tout à l’heure cet œil dans le con, le panopticon — qui a affaire à la police de l’espèce sous forme, en général, de femme. Je ne veux pas dire par là qu’elles ne sont pas bien : elles sont simplement appelées là pour que le père tel qu’il doit être, c’est-à-dire religieux, n’ait pas, si j’ose dire, de contact trop invisible, autrement dit trop intime, avec un fils. Parce que, à ce moment-là, ils pourraient non pas se dire des choses, mais se transmettre quelque chose d’incomptable. Alors, il y aura toujours des rabbins, des curés, des imams, des bonzes et tout ce que vous voudrez pour gérer la prodigieuse angoisse qui tenaille l’espèce du côté de la ferfemme. Oh ! j’allais oublier les secrétaires de cellule, de fédération, les secrétaires du parti, et j’allais oublier la figure laïcisée de tout ça qu’est le professeur, autrement dit le sujet supposé renseigner ; et j’allais oublier le psychanalyste aussi, forme moderne de la chose. Je ne parle pas de la psychanalyse en tant que découverte, je parle de ce qui s’y installe pour gérer ce qui pourrait être dérangé par l’exception. Ce n’est pas tous les jours qu’apparaît la position analytique de la découverte. On peut plus exactement voir dans la rentabilisation de l’hystérie ramenée socialement à sa fonction de surveillance du vibratoire quelque chose qu’Artaud désigne d’une façon stricte comme « l’indécrottable cheptel des profiteurs d’abîmes ». Les expérimentateurs de l’abîme, de ce qui fait abîme dans la question du langage : si vous préférez, les gens qui vont y parler en sujet dans ce qu’il en est du discours, c’est bien à ce moment-là qu’ils deviennent des noms qui font problème, des noms tout seuls, des fils de nom, des noms-pères… Ceux-là, ils sont seuls. Ils n’ont plus à compter sur institution, religion, université, communauté-ceci, communauté cela… Cela est banal, mais il faut le répéter de temps en temps parce que, si je peux dire, il y aurait périodiquement du relâchement dans ce domaine. Il y en a qui pensent qu’on peut s’expérimenter la question de l’abîme du discours en étant quand même bien vu : non, on ne peut pas être bien vu dans cette aventure.
[…] Quand je veux parler du moindre effet de religieux ou du moindre effet de surveillance, il va de soi que j’entends parler d’une sorte de relatif détachement par rapport à la croyance sexuelle fondamentale de l’espèce telle que la ferfemme est absolument intéressée à la faire fonctionner au nom d’un père qui ne soit pas à la place du sujet qui parle, mais, comme ça, une sorte de porteur de la fonction de la parole en tant qu’elle ferait un peu loi, c’est tout.
.
.


.
.
[…] L’expropriation rationnelle de l’individu-homme, c’est-à-dire du petit propriétaire, de l’artisan, de son propre sexe, c’est une expropriation qui va carrément dans le sens d’une modernisation que j’ai appelée la grande surface des choses. Qu’on appelle ça libération, émancipation des femmes, il faut bien qu’on fasse ça avec du leurre, avec du voix-voile, il est bien évident que ce qui compte dans la récente période, c’est cette espèce de mutation technique dans la façon de se repérer par rapport au phallus. Les femmes sont appelées là, comme le prolétariat autrefois, à briser leurs chaînes… On sait comment ça finit : toujours de la même façon, c’est-à-dire à la chaîne, à la chaîne industrielle que j’appellerai aujourd’hui gynécologique, à la chaîne clinique, à la chaîne de ce qui s’étend comme gestion rationnelle. Autrement dit, l’espèce en est au point où elle doit commencer à se poser rationnellement la question des flux de population, du calcul sur ces flux, de la rationalité économique qui s’en déduit ou non : par conséquent, de l’intégration des femmes dans ces mouvements, de la programmation éventuelle de tout ça. Évidemment, si je suis en bas de l’immeuble où ça se cogite, si je suis appelé en tant qu’homme, en tant que femme, à vivre tout ça comme une sorte de révolution, d’émancipation, tout ça, c’est dans l’ordre de l’idéologie. Mais au fur et à mesure que je monte dans les étages, j’arrive simplement sur la machine à calculer, le computer dont personne ne parle, bien sûr.
[…] [La position du phallus], vous voyez bien que ça consisterait à repérer aujourd’hui, aujourd’hui même, tout ce qui fait en quelque sorte obstacle à la jouissance — autrement dit à la jouissance phallique. Il n’y en a qu’une, de jouissance, et elle est phallique. Ce qui ne veut pas dire que ce qui l’incarne en « crate » soit de l’ordre du phallus : phallocrate, ça désigne l’être affecté du phallus sur son versant masculin, c’est-à-dire précisément qu’il n’arrive pas à en jouir, alors il manifeste comme qui dirait de l’autorité. La position du phallus n’a aucune autorité particulière. Sauf la suivante, qui est que c’est de là que vient le sens. Vous serez d’accord avec moi pour constater que ça ne va pas fort dans ce registre.
C’est si vrai, pour en revenir à mon petit Paradis… C’est bourré de sens, il n’y a personne pour s’en rendre compte […]. Mais il n’y a pas meilleurs sourds que ceux qui ont décidé qu’ils avaient la mesure du phallique. À partir du moment où vous croyez avoir l’étalon, vous devenez sourd, analement, à ce qu’il en est du phallus. Ce qui n’est pas du tout, encore une fois, une question visuelle, mais auditive. C’est pour ça que quand il est question d’engendrer d’une façon correcte, divine, c’est pas par l’oreille, comme on a la bêtise de le répéter, mais bel et bien par la parole ou le souffle que ça passe. Paradis, c’est très clair, très simple à lire : c’est d’ailleurs très lu, mais évidemment somnanbuliquement. C’est sursaturé de sens. D’ailleurs, si vous trouvez que ce que je dis a le moindre intérêt, ça n’est dû qu’au fait que j’ai écrit ça. Je ne dis ce que je dis que parce que j’écris ça. Ce qui se passe, c’est que je le commente. Or ça, c’est délicat, parce que le lien social n’est pas là du tout pour accepter que quelqu’un en première personne commente ce qu’il vient d’écrire. Soit l’un, soit l’autre : on écrit, on est commenté – on commente, on n’écrit pas. Où je fais symptôme, où je viens embêter le monde, c’est précisément de me tenir sur ces deux jambes. La loi, c’est : écris et tais-toi – commente et n’écris pas.
M. D. : Le commentaire passe de plus en plus pour être de l’écrit.
P. S. : Moi, il se trouve que je peux me faire, si j’ose dire, mon commentaire moi-même. Je sais me taire et me lire, en quoi je suis le parfait célibataire. Je veux dire par là : non seulement quelqu’un qui pourrait être marié sans que ça le gêne, chose déjà très mystérieuse ; mais qu’en plus il est compliqué — en quoi, ça m’attire des ennuis — de m’apparenter. Vous savez fort bien que tout marche par apparentements. Après quoi, on se raconte qu’il y a une histoire. Disons que c’est de cet acte à la verticale du roman familial que je dois d’être considéré comme extrêmement peu religieux.
L. C. : Une façon d’être ?
P. S. : Je pense finalement que je ne vise rien d’autre que le fait d’être moins religieux que la plupart.
L. C. : Matérialiste ?
P. S. : Je prends une distance avec « matérialiste »…
L. C. : … cosmique ?
P. S. : Non plus. Comme vous savez, le matérialisme, en son fond, sert à certains à imaginer qu’ils n’y a pas de trou dans l’univers. Par exemple Lucrèce. Prenons le prologue du De Natura Rerum,tout ça est offert à Vénus. Vous savez que ça ne va pas loin quand même, parce que, en effet, toute la théorie matérialiste — qui m’intéresse fort — est pour ainsi dire construite sur le fait qu’il ne faudrait pas qu’il y ait un trou dans Vénus parce qu’à ce moment-là tout fout le camp. Les atomes, le vide lui-même : on ne les trouverait plus quelque part. Il y aurait comme qui dirait un endroit où il n’y a plus rien. Même pas un « trou noir », qui n’est pas un trou, mais sa forme révulsive. Je ne suis pas pour laisser subsister un fantasme de cosmicité — de faux trou. Ma position est gnostique, si vous voulez, elle n’est pas cosmologique. Elle est gnostique en ceci que je distingue entre réalité et réel, entre le fait qu’il y a des phénomènes, du monde, tout ce que vous voudrez, mais que c’est affecté à mes yeux d’un signe négatif. Vous savez ce que c’est qu’être gnostique… c’est imaginer simplement que tout ce qui existe, c’est le produit d’un mauvais dieu qui s’est mal débrouillé. D’un mauvais dieu qui ne serait rien d’autre que le désir de la Sophia. Il y a un mauvais dieu qui a créé le monde et ce n’est rien d’autre que… la mère qui a voulu faire aussi bien que le père. Le père est le seul à pouvoir créer quelque chose en dehors de lui-même ; la mère, elle, veut créer quelque chose à l’imitation du père, seulement l’embêtant, c’est que ça ne sort pas d’elle. Alors, le monde, il est comme qui dirait pas dehors, nous compris. Pour en arriver au Dieu qui est là-haut, au Père des Lumières (pas le mauvais, pas celui dans lequel on est, enfin, comprenez ça), pour rejoindre celui d’en haut — vraiment d’en haut —, pour aller vraiment en haut, dehors, c’est toute une histoire parce qu’il faut alors traverser des cercles, des mondes, des planètes, etc. Le plérôme, ce n’est même pas ce qu’il y a de plus élevé, ça laisse la question ouverte. La question du dehors est ouverte. Ce qui me touche dans l’art justement, puisqu’on parle de ça, c’est que c’est un effort pour toucher enfin le dehors. Pas le dehors des « choses », celui du discours. Celui que Dante atteint, par exemple — moment que même Lacan ne semble pas en mesure de saisir. Encore la littérature… […] Enfin, je me fais fort de démontrer quand vous voulez que tout ce que vous appelez vocation, art, littérature, etc. ce sont tous des gnostiques. Ils ne parlent que de ça. Artaud, Kafka, Joyce, qui vous voulez, ils sont tous gnostiques. C’est bien la raison pour laquelle, si vous vous occupez de cette affaire en première personne, vous allez avoir sur le dos des sollicitations religieuses de tous ordres, voulant vous refaire adhérer à on ne sait trop quel ensemble qui se passerait fort bien de l’exception que vous êtes. Vous serez en quelque sorte assailli par la demande de ré-adhérer au religieux.
L. C. : Dans une question [N. B. : à la suite d’une lecture publique de Paradis donnée antérieurement par Philippe Sollers], je disais que Paradis semble retourné sur lui-même, comme le papier dans une machine à rouler les cigarettes. Je me suis intéressé surtout à sa « façon » d’être écrit, un peu comme on regarde comment est peint un tableau, comment les touches de pinceau se qualifient en style…
P. S. : Oui, mais il y a aussi la chose dont ça parle, et je vous assure que c’est ça qui est tout à fait censuré.
M. D. : C’est ça qui gêne beaucoup les littérateurs et les commentateurs.
P. S. : […] Je peux vous commenter une page et demie pendant deux heures. Qu’est-ce que ça veut dire ? […] Ça veut dire que loin d’écrire un livre, j’en écris au moins cent. Qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’au lieu d’avoir un double, j’en ai mille, deux mille. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça s’infinitise au présent, et ça, c’est rigoureusement scandaleux. Il faut, pour le consensus sociologique : autrement dit, familial, convivial, parce qu’il n’y a que lui, il faut n’être que ce qu’on est. Et n’être que ce qu’on naît, c’est vite vu. Il faut faire généalogie d’une certaine façon. Il ne faut pas pousser. Il faut laisser de la place pour les gens qui sont censés dire ce que ça veut dire. Alors, ça fait une crise, pas forcément chez les individus, ça fait une crise très intéressante dans le marché. De quoi ? De l’édition. Édition — édition, éditeur, comme on dit éboueur. C’est celui qui tend à éliminer celui qui dit. […] La plupart des gens croient avoir affaire à leur discours, le leur, leur signature… Pas du tout ! C’est l’éditeur qui commande. Le nom important dans cette affaire, je vous montre une couverture, il est en petits caractères en bas. C’est la même chose par rapport à l’art : on ne voit pas les choses importantes, on croit que c’est celles qui sautent aux yeux. Mais, non : c’est en réalité un conflit de signatures. […] Alors, pendant que les gens se découpent des commentaires sur l’art, des histoires sur les livres, un thème chez machin, et ceci… et cela, la fonction de ceci dans cela… ce qui se joue réellement dans le réel, c’est bel et bien quelque chose qui coince entre support et surface, c’est le cas de le dire.
M. D. : Quelle est la signification, alors, de votre parution de Paradis en feuilleton ?
P. S. : C’est de produire un symptôme pour que éventuellement quelqu’un se demande ce que ça veut dire. Ça ne manquera pas d’arriver, que quelqu’un se demande ce que ça veut dire. […] Paradis ne manque pas de faire symptôme. De là à dire que c’est une impasse inutile, comme le disent les porte-parole de l’utérus du dit, c’est beaucoup dire. Ce qu’ils font, en réalité, c’est vraiment cracher le morceau que le dire en question, dont je m’occupe, ne part pas de cet utérus : du faux trou brandi pour déclencher la peur enfantine du noir. Je n’ai pas peur dans le noir.
.
.
[1] Extrait de l’entretien « Pourquoi je suis si peu religieux », publié initialement dans la revue Peinture. Cahiers théoriques, n° 14/15 en 1979, repris dans la revue Tel Quel, n° 81 en 1979, réédité depuis dans l’ouvrage d’essais Improvisations, Philippe Sollers, Gallimard/Folio, 1991.



