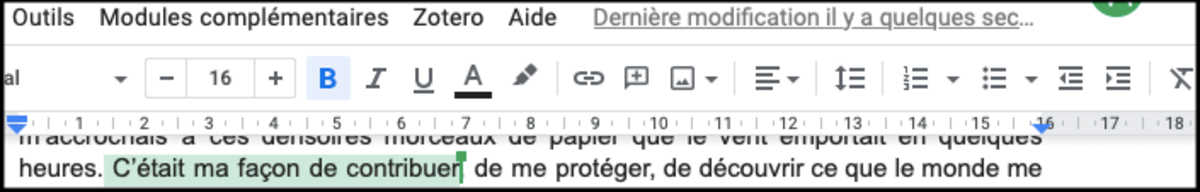
Agrandissement : Illustration 1
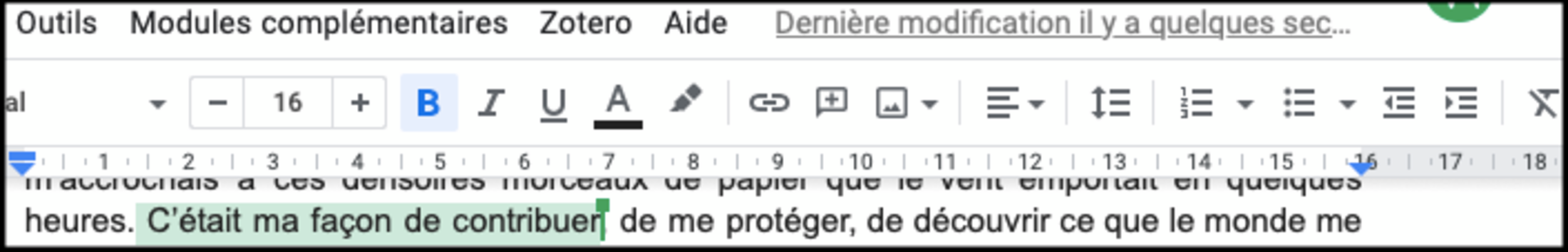
Tout est parti d’un onglet que je n’avais pas fermé. Un document partagé sur lequel nous travaillons. Un lieu de rencontre où les déplacements sont régis par des lignes. Un cruising textuel dans le brouillard de mes fenêtres. Une porte entrouverte sur son intimité.
Je le vois écrire, je le vois avancer, s’arrêter, je le vois penser, douter, se transir de vertiges.
Le surprendre écrire, réécrire sur la page numérique et suivre le curseur avancer, les arrêts brutaux, binaires, le clignotant du curseur sur la bande d’arrêt d’urgence. Composer les scénarios qui défilent dans sa tête, dans la mienne, quand je regarde son curseur clignoter comme tant de fois j’ai vu clignoter le mien. Les appels de phares dans la nuit. Et la nuit que toute une vie anime.
—
Je m’arrête au milieu de la page et non seulement mon œil scanne les mots, saute les lignes, réassemble le texte mais aussi mes souvenirs se superposent, les perspectives d’écriture s’emballent. Elles s’emballent si loin qu’elles recouvrent virtuellement la page d’un tas de symboles indéchiffrables. Soudain ma tête est une énigme, mes souvenirs sont un brouillard, et le texte est un assemblage fatigué de propositions. Je suis en demi sommeil devant la lumière de mon écran de veille, prêt à sombrer dans mes rêves. Les touches quittent le clavier pour me tatouer de lettres de la tête au pied ; la langue me parcourt. Je reste coi.
Ces minutes de clignotants sont des silences qui en disent long. Des rêves interactifs. Des plateformes érotico-textuelles. Ces minutes de respiration du clavier lorsqu’on arrête d’écrire et que l’on voyage assis la clope à la main la fatigue dans l’autre. Tout est à dire. Redire. On appuie précieusement puis frénétiquement sur ← puis l’on réassemble pour trouver la formule qui relance la machine à traiter des empreintes pour te toucher.
La mémoire cache de l’ordinateur se souvient de tout. J’ai pu entrevoir les émotions que ma mémoire cache pouvait ressentir à mon égard, ce qu’elle pouvait dévoiler, à chaque instant, de mes doutes, de mes hésitations, des termes que je jugeais équivalents, des mots qui déterminent le reste d’un texte et ceux qui me font cogner contre mes démons intérieurs. Ceux qui me mettent en transe. Ceux qui me mettent en veille.
Ma mémoire cache sait tout de moi, car elle connaît toutes les astuces que j’emploie pour ne pas laisser de traces.
—
Les outils de base d’une psychanalyse des curseurs seraient d’une part l’observation indirecte du traitement de texte et de ses différents mouvements : les moments de pause, la durée des pauses, les variations dans la vitesse d’effacement des lettres, la reprise de vitesse dans la réécriture, la répétition de certains mots, le retour du curseur à certains endroits du texte. L’autre serait l’intrusion dans le texte qui scellerait la relation de partage de l’analysant à l’analysée : l’ajout d’éléments, les captures d’écran photographiques et vidéographiques, les commentaires en marge, la réactualisation des brouillons de texte.
Les objets d’étude principaux de cette psychanalyse du curseur ne sont ainsi plus le corpus de fantasmes individuels peuplant l’imaginaire d’un sujet mais les datasmes collectifs mis en partage sur les plateformes collaboratives. On peut ici esquisser une définition des datasmes en détournant la définition freudienne du fantasme :
Les datasmes sont des opérations de « quasi-écriture », des mouvements involontaires observés ou exécutés dans l’espace numérique partagée, fabriquant des personnages et scénarios qui hantent les plateformes et les actes d’écriture à la manière d’un rêve, d’un désir ou d’une figure plus ou moins voilée.
–
Regarder ce qui entre dans la boîte noire des cruisings textuels sans jamais l’ouvrir. Laisser la lumière et le divan en dehors de tout ça et assembler du bout des doigts les traces laissées dans l’inconscient partagé.
Ces éléments constituent la base d’une psychanalyse de la parole écrite, de la parole qui se livre dans ses opérations de choix, ses hésitations, ses reprises, ses hontes et ses fiertés ; une psychanalyse qui ne se sert pas des réminiscences écrites ou racontées comme un support d’interprétation à l’intérieur d’un espace clos et d’un temps donné mais qui se sert des mouvements du traitement de texte comme d’un support pour lier les écritures dans le mouvement clignotant des notifications.
On n’éprouve plus rien en regardant dans le trou de la serrure – d’ailleurs les serrures n’ont plus de trous et il n’y a plus grand-chose à voir. La nudité de la peau est montrée, les corps s’allongent sans peine : les mille entrées des réseaux en ligne nous donnent accès à toute image et à tout écrit, et n’étonnent plus personne. Les positions sexuelles et politiques s’affirment en phrases simples et en images claires. Mais le curseur continue de jouer à cache-cache. Et avec lui, les corps queer, les visages tatoués, les cerveaux neurodivergents1, et tous les autres visages apparemment effacés des pages de l’histoire et dont les lignes se tracent dans le cloud des chats, dans la toile des fils Reddit et les autres brumes de ces cruising textuels.
—
On n’a jamais eu autant de mal à livrer l’écriture en train de se faire, l’amour en train de s’hésiter, la pensée en train de trébucher – le brouillon manuscrit ment. Il garde la marque consciente, sous forme de ratures, des retours d’évaluation bien pesée. Le traitement de texte, au contraire, offre cette possibilité inédite de refouler automatiquement les erreurs, de les ranger dans le dépotoir psychanalytique des fichiers temporaires, de les cacher sous les tapis des dossiers archivés.
Paradoxalement, l'inexistence d’une fonction « ratures » sur les logiciels de traitement de texte impose un retour du refoulé sous la forme de déplacement du curseur dans le traitement du texte. On retrouve en un clin d’oeil, en un clignotement, tout le magnifique chaos d’émotions et de symboles que peuvent réserver ces fichiers temporaires, l’art de nos dysfonctions émotionnelles et cognitives2.
La sensation ressentie lorsque l’on observe quelqu’un écrire sur un logiciel d’écriture partagée n’est pas trompeuse : les sauts, les arrêts sont riches de choix inconscients, d’interprétations que le corps effectue en silence entre deux mots, entre deux lettres, entre les clignotements du curseur. Ces choix entraperçus ouvrent sur un monde mystérieux, attirant et encore mal documenté, celui des proto-écritures et de l’inter-texte, des écritures qui n’ont pas encore de noms et qui cherchent à surtout ne pas en avoir.
On a déjà exploré l’utilisation de l’écriture, de la tenue d’un carnet de bord ou du travail de fiction, dans un cadre thérapeutique et on a déjà traduit nos rêves en images télédiffusées3 ou en réalité virtuelle4. On a déjà observé l’effet, sur la vie affective du sujet, de l’usage des technologies de communication et de la massification des échanges en ligne5. Maintenant, il s’agit de regarder l’écriture dans son non-écrit, dans ses reprises, ses retours, ses sauts de ligne ; et de regarder la littérature numérique non comme une masse systémique à ciel ouvert et au bras long, mais comme un réseau de maisons closes, de portes entrouvertes et d’onglets que l’on ouvre et ferme du bout des doigts.

Agrandissement : Illustration 2

Ce n’est plus la parole du corps que l’on touche que la cure psychanalytique doit viser, mais les textes que l’on tape, les traces que l’on coupe sans coller, et la façon dont on accepte ou non de les imprimer, de les rendre lisibles et visibles. L’étymologie du mot texte signifie « tisser », et Tim Ingold remarque, dans son anthropologie des lignes et des liens6, la parenté entre le chemin que l’on trace, les liens que l’on tisse le long de ce chemin et les traces qu’on laisse pour se remémorer les passages anciens, annoncer les passages futurs.
La psychanalyse doit s’intéresser à ces nouveaux liens : cette relation d’amour, d’intimité, de fougue et de rejet que l’on entretient non pas avec notre écran d’ordinateur mais avec nos tableaux Excel, nos conversations Messenger, nos posts Facebook, avec notre capacité à les remplir de nous-mêmes ou notre angoisse de les voir vide de toute notre substance. Cette relation épistolaire que l’on entretient avec les nouvelles créatures de nos mémoires caches (amants mythologico-informatiques, employeurs tyranumériques, animaux mystico-digitaux7, et autres « datasmes ») tisse du bout des doigts les fils désirants d’un inconscient du curseur.
Elle élabore de WhatsApp à Gmail en passant par Tinder, LinkedIn, les Notes, les Zotero et les noms des dossiers de notre bureau numérique, un formidable réservoir de brouillons cachés où se tissent les inconscients partagés et les linéaments d’une exploration scientifique à venir. Cette exploration scientifique, encore à dire, est au carrefour des théories du care en ligne, de la littérature partagée et de l’analyse de la place du corps intime dans nos réseaux d’informations mondialisées.
Il est impératif à l’époque d’une densification des échanges écrits et du traitement textuel de toutes les opérations de vie (travail, amitié, sexualité, santé etc) d’une part de redéfinir les contours d’une vie non numérique expurgée des créatures freudo-patriarcales8, mais aussi et surtout d’engager une analyse des proto-écritures que le passage clignotant des datasmes impriment à la surface de nos inconscients partagés.
1Kapp K (2020) Autistic community and the neurodiversity movement. https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-8437-0
2Halberstam J (2011) The queer art of failure. Duke University Press. https://www.dukeupress.edu/the-queer-art-of-failure
3https://www.onlinetherapyinstitute.com
4Jarret C (2009) Get a second life. In The Psychologist.org https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-22/edition-6/get-second-life
6Ingol T (2016) A brief history of line. Routledge Classic https://www.routledge.com/Lines-A-Brief-History/Ingold/p/book/9781138640399
7A ce sujet, voir le travail de Dorah Simon: « Méditation data-spirituelle » https://www.dorah.club/dataspirit/
8Preciado P (2020) Je suis un monstre qui vous parle. https://www.grasset.fr/livres/je-suis-un-monstre-qui-vous-parle-9782246825562



