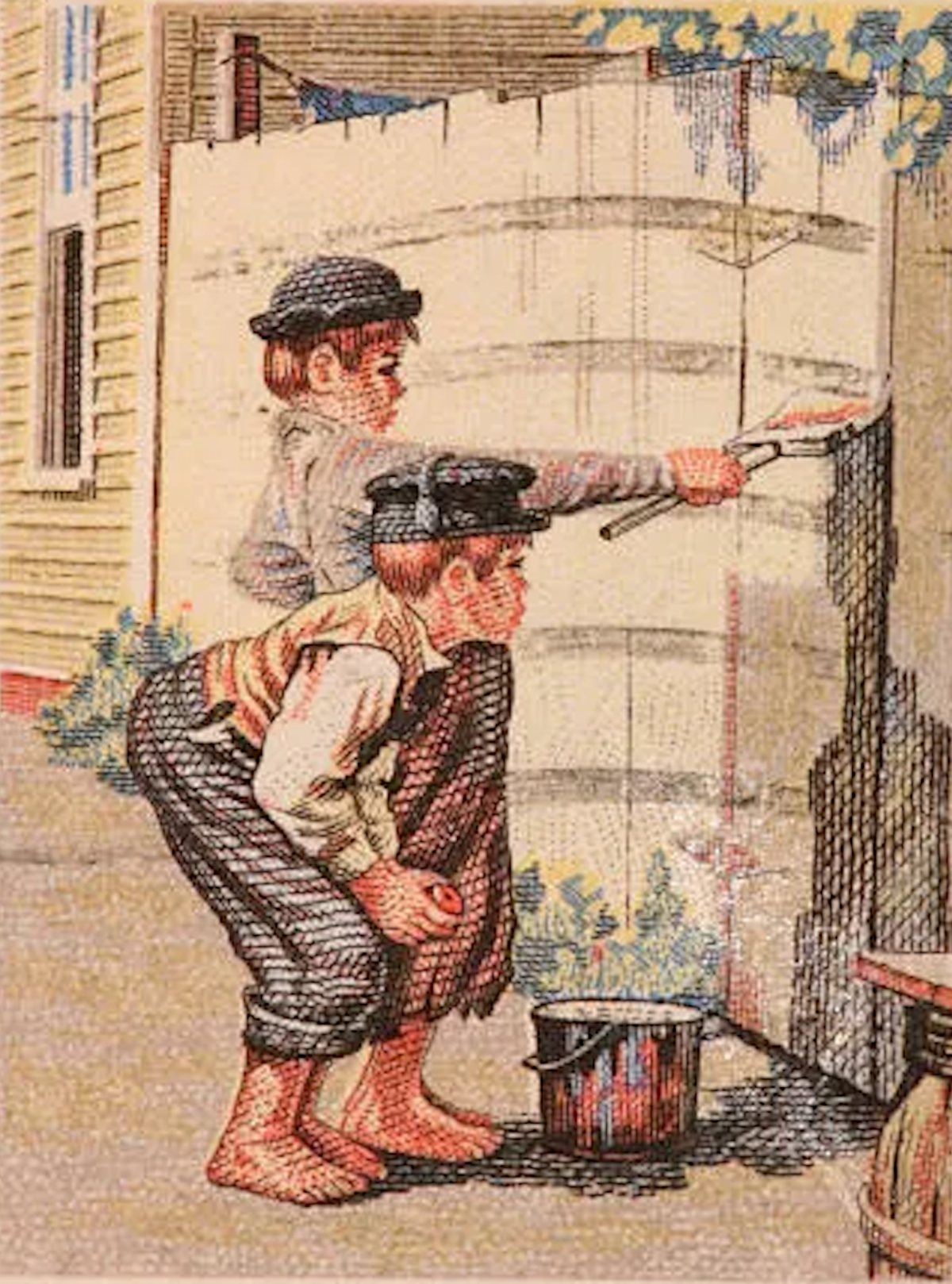
Agrandissement : Illustration 1
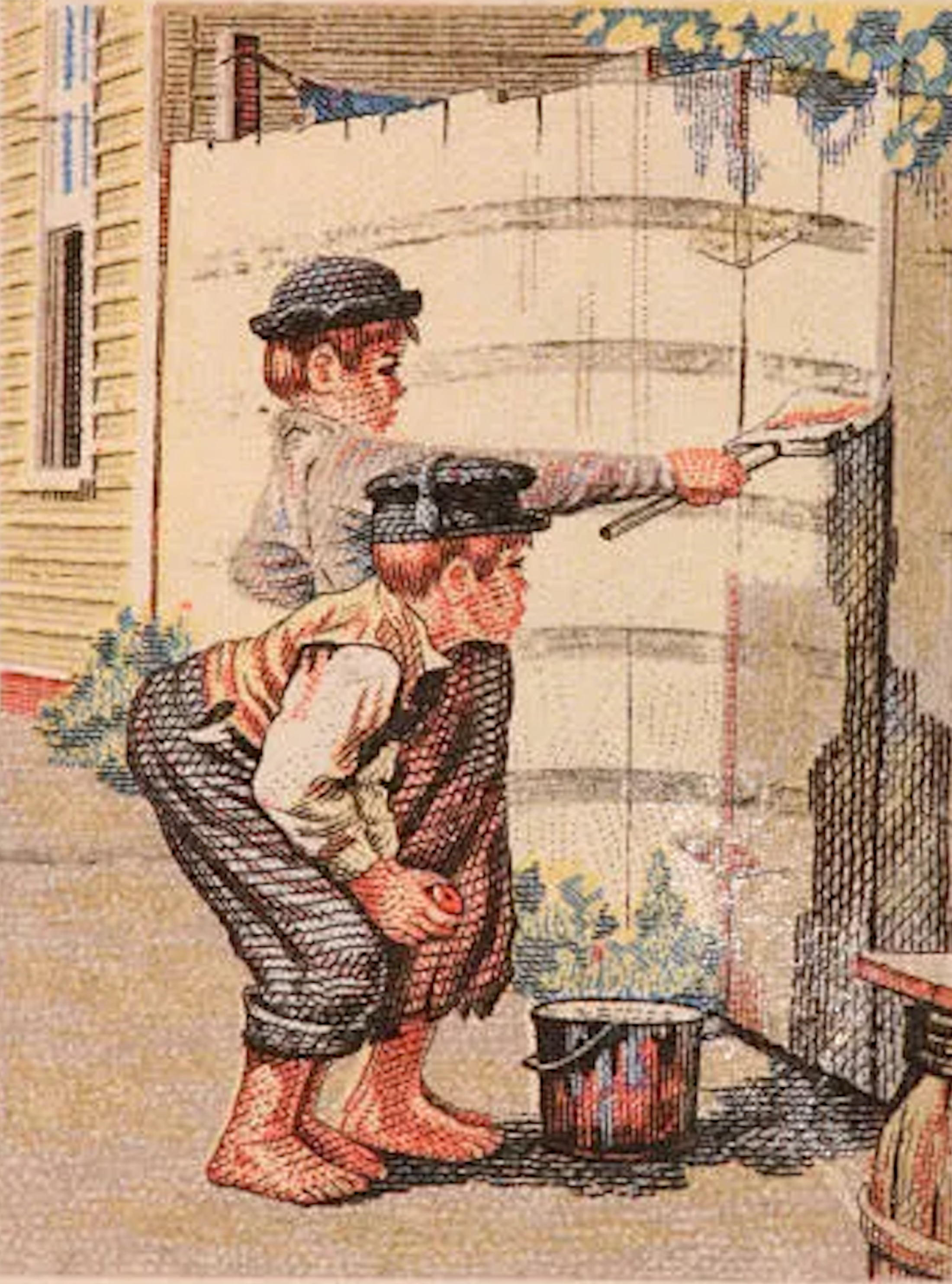
De la plume caustique de Mark Twain est né un portrait inoubliable : Tom Sawyer, contraint par sa tante de peindre la clôture du jardin, savait qu'il serait la risée de son groupe d'amis. C'est pourquoi, lorsque ceux-ci s'approchèrent pour le narguer de ne pas pouvoir aller jouer sur les rives du fleuve, il décida de recadrer la situation en affirmant que sa tante lui avait accordé le privilège exclusif de peindre la clôture. Immédiatement, ses amis commencèrent à le supplier de les laisser aussi participer et, après de multiples supplications, il finit par céder, exigeant de chacun un paiement pour avoir le privilège de collaborer à la tâche. À la fin, non seulement ses amis firent tout le travail à sa place, mais il récolta en prime un petit trésor : un cerf-volant, une souris morte, douze billes, une craie, un harmonica, un soldat de plomb, deux têtards, entre autres précieuses trouvailles.
Paul Watzlawick, brillant psychologue de la communication humaine, illustre à travers cet épisode sa thèse sur « l'art subtil du recadrage » comme une méthode créative de résolution de problèmes, qu'il oppose à la pratique du « toujours plus de la même chose », laquelle peut être décrite comme « insister sur des solutions qui ne fonctionnent pas dans l'espoir d’obtenir des résultats différents ». Nous n’avons pas besoin d’être d’accord avec Donald Trump pour admettre qu’il y a en lui quelque chose de Tom Sawyer.
Durant ces trois années de guerre meurtrière à l’est de l’Ukraine, le monde a semblé, à plusieurs reprises, au bord de l’apocalypse ; et pendant ce temps, les dirigeants européens et nord-américains ont répété en boucle le mantra du soutien au gouvernement ukrainien as long as it takes. À mesure que leurs arsenaux et ressources financières s’épuisaient et que, symétriquement, la machine industrielle militaire russe se renforçait, les désavantages logistiques et la pénurie de ressources humaines du côté ukrainien sont devenus évidents. L’illusion complaisante d’une guerre économique contre la Russie, visant en dernier ressort un « changement de régime » et la fragmentation du plus grand et du plus autosuffisant pays du monde, a surtout révélé la fragilité des piliers des économies européennes et accéléré le démantèlement, depuis longtemps annoncé, de l’hégémonie unilatérale nord-américaine.
Pendant trois ans, l’entêtement dans des « solutions qui ne fonctionnent pas » a conduit des centaines de milliers d’Ukrainiens et de Russes à des morts atroces, sacrifiés sur l’autel de la « défense de nos valeurs », tandis que les précieuses vies européennes et nord-américaines étaient cyniquement préservées – celles des habitants privilégiés du « jardin », selon la tristement mémorable description de l’inepte ex-vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell.
En février 2022, j’ai pressenti que la victime ultime de cette guerre serait « l’Europe » ; j’ai même écrit que la conséquence du conflit ne serait pas l’européanisation de l’Ukraine, mais l’ukrainisation de l’Europe (ukrajina signifie, dans les langues slaves, « périphérie » ou « terre de frontière »). Trois ans après, entre attentes élevées, incapacité d’auto-analyse et déficit inénarrable de réalisme, voici où nous en sommes : le centre névralgique du monde s’est inexorablement déplacé vers l’Est, l’Europe a perdu une occasion en or d’accepter qu’elle n’est qu’une modeste péninsule de la masse eurasiatique, et l’ingérence nord-américaine dans les affaires européennes est devenue un vestige de l’appareil impérial anglo-saxon.
Face à l’évidence que les équilibres issus du système géopolitique né de la Seconde Guerre mondiale étaient en train de se fissurer, et que le pendule de la politique nord-américaine commençait à basculer du côté de la fameuse doctrine Monroe, l’appareil bureaucratique oligarchique de Bruxelles s’est révélé incapable, intellectuellement et moralement, de produire autre chose que du « toujours plus de la même chose ».
Et voilà que Donald Trump revient sur la scène politique mondiale et abat la carte Tom Sawyer : avec un simple coup de téléphone à son homologue russe, la question des relations transatlantiques est recadrée dans le contexte du grand casse-tête des relations russo-sino-américaines. Le pion ukrainien a été sacrifié, le cavalier européen relégué dans un coin de l’échiquier, et le roi a roqué. La grande partie continue désormais, avec les bellicistes européens pusillanimes assis sur le banc des remplaçants.
Il existe une expression populaire en Russie, dont l’origine se trouve dans la comédie de Gogol L’Inspecteur général : англичанка гадит, que l’on peut traduire par « l’Anglaise chie ». Elle renvoie, en substance, à l’idée largement répandue selon laquelle les étrangers sont toujours la cause des problèmes russes. À la fin du XIXe siècle, « l’Anglaise » désignait la reine Victoria, et l’expression suggérait que la Grande-Bretagne recourait aux bons ou mauvais offices des Turcs et des Français pour atteindre ses objectifs stratégiques et empiéter sur les zones d’influence de l’Empire russe.
Selon l’historien Alexander Dolinin, cette expression, comme d’autres du même type, fait écho à un thème récurrent de la pensée philosophique russe : celui de la décadence de l’Occident. Depuis au moins la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle, les courants anglophobes en Russie se nourrissent, en miroir, de la russophobie britannique. Il n’est donc pas surprenant que, du point de vue du Kremlin, la guerre en Ukraine soit perçue, en grande partie, comme un projet machiavélique britannique, dans lequel tant l’Union européenne que les États-Unis auraient été stupidement entraînés. Il n’est pas étonnant non plus que l’arrivée de Donald Sawyer Trump à la Maison-Blanche soit perçue avec soulagement, comme le signe que la résurgence de l’anglophobie inhérente à l’identité américaine depuis l’indépendance pourrait temporairement geler les éternelles ambitions territoriales anglo-européennes face à la Russie.
Devant ce grand recadrage, je jure que je ne serais pas surpris si quelqu’un venait me dire que les États-Unis pourraient rejoindre les BRICS et que l’Union européenne cesserait d’exister avant 2030.



