
Agrandissement : Illustration 1

Il est difficile d’imaginer le succès phénoménal de ce « roman musical » naturaliste, ouvriériste et mélodramatique dans la première moitié du siècle dernier. Deux ans avant le Pelléas et Mélisande de Debussy, l’Opéra Comique parisien jouait les contrastes en 1900 : une œuvre élitiste, hermétique, succéda à un opéra populaire. A la préciosité des mots de Maeterlinck, Charpentier préférait les mots simples : « O, cœur ami ! … O, jolie ! … Quel crampon, à Charenton ! Quelle scie, il est fou… Viv’la rigolade, loin du flic et du cipal… » (le gendarme municipal), tout en comparant Louise à Juliette et Ophélie et faisant chanter à des gueux Perrette et le pot au lait de La Fontaine - références populaires chères aux hussards noirs de la République. Aussi célèbre que Carmen l’insoumise, Louise rencontra immédiatement le public par son sujet et la modernité du discours féministe, par son appel irrépressible à la liberté et au pur plaisir sensuel et sexuel (« Je veux du plaisir… Ah, prends moi ! » chante Louise) comme par sa dénonciation de ce que formula André Gide en ces termes « famille, je vous hais », dénonçant l’enfermement morbide imposé par des parents possessifs voire incestueux. Et puis Louise est un hymne à Paris ville de toutes les émancipations !
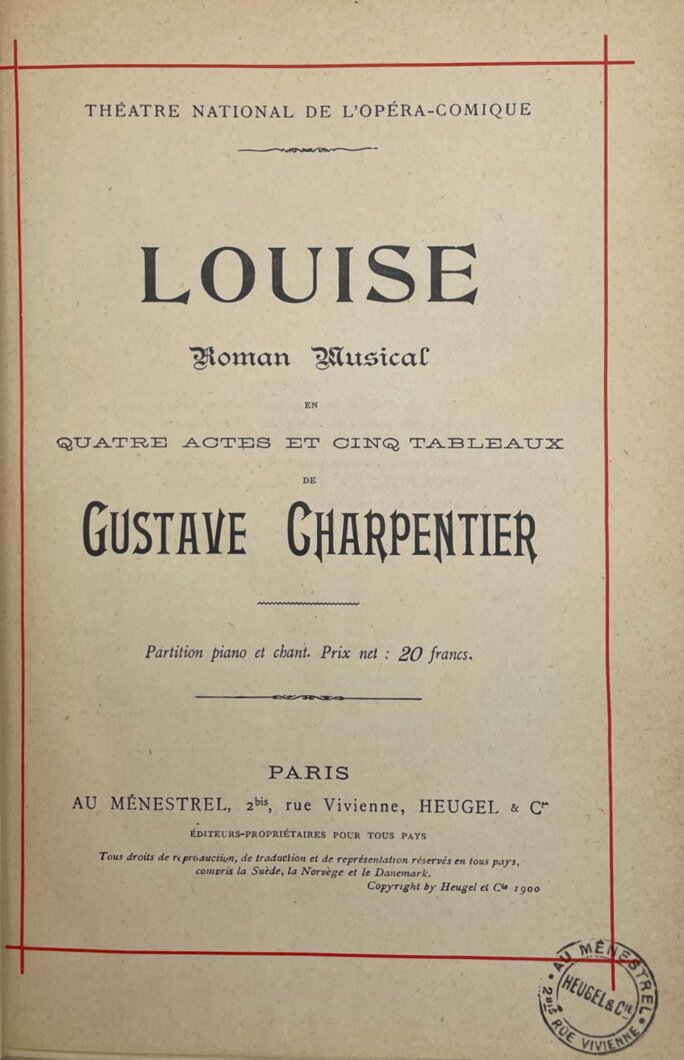
Agrandissement : Illustration 2
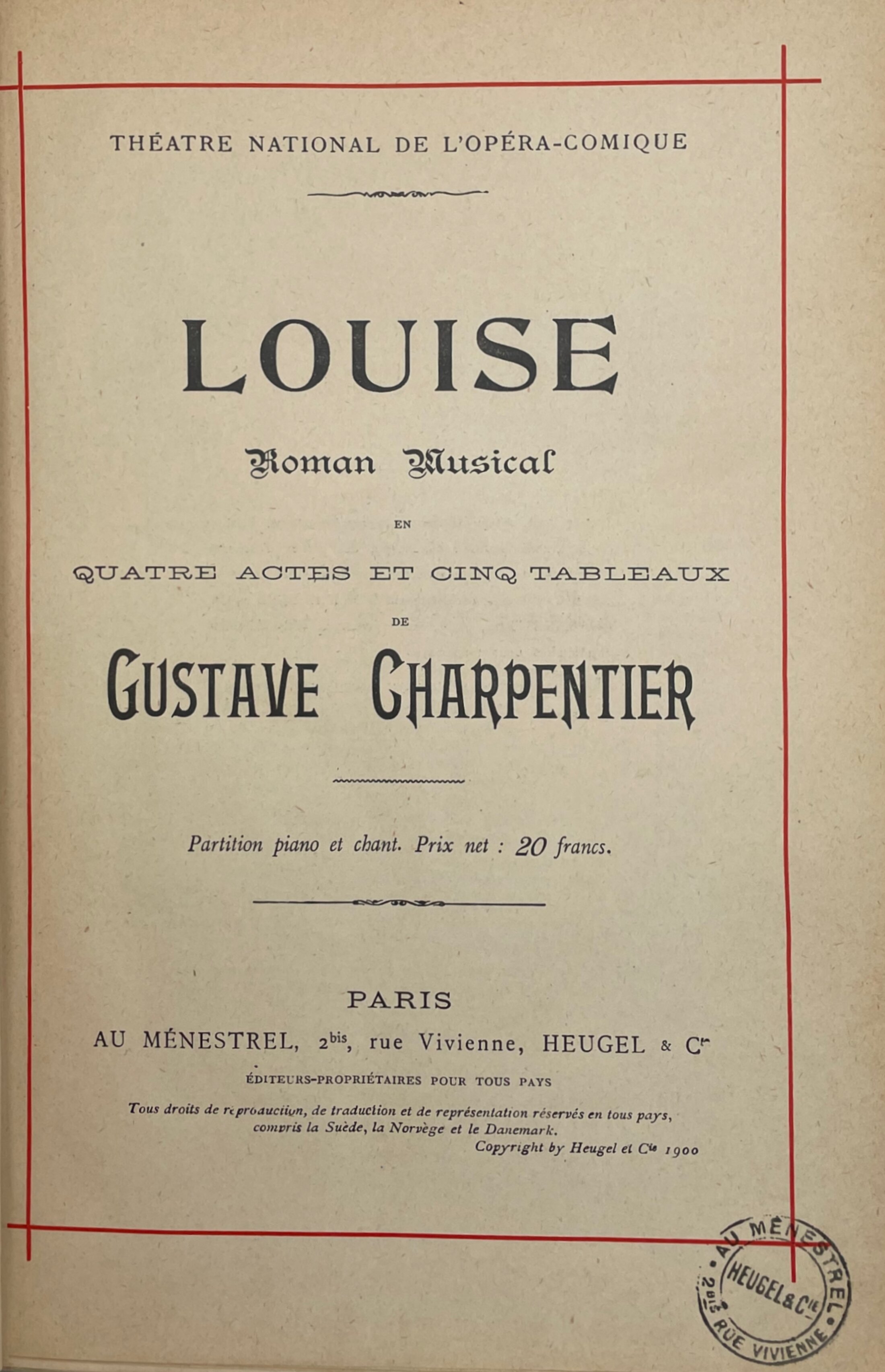
Car Gustave Charpentier dénonce les portes fermées d’un horizon mental imposant à la fille un comportement d’autant plus exemplaire qu’il est à l’opposé de ce que ses parents lui font subir. Cette dénonciation d’une morale bourgeoise catholique oppressante qui s’est instillée dans tous les pores de la société est ici un manifeste lyrique porté à incandescence.

Agrandissement : Illustration 3

L’histoire est simple : Louise est amoureuse de son voisin, Julien le poète. Ses parents, par une toxique emprise, refusent qu’elle les quitte. Elle l’avait pourtant promis à Julien qui, désespéré, vient chanter sous les fenêtres de son atelier, ce qui la décide à le rejoindre. Heureux de vivre libres ensemble dans ce Paris « splendeur première », ils sont emportés par la fête des artistes qui font de Louise la Muse de Montmartre - lorsqu’apparait sa mère. Elle implore son retour au logis où le père est très malade. Au dernier acte, voilà Louise enfermée entre deux parents acariâtres avec un père qui la sermonne et finit par comprendre qu’elle leur échappe : elle s’enfuit - et il maudit Paris.
Ce qui fit le succès était lié à la mise en valeur de ces innombrables petits métiers si souvent ignorés (et à vrai dire, jamais représentés ailleurs que dans cet opéra, si l’on excepte Il tabarro de Puccini créé en 1918) mais également au nombre impressionnant d’artistes sur scène comme à la caractérisation de chacun des quatre actes : le logis ouvrier lieu de l’intime ; le réveil de Paris puis l’atelier des cousettes ; la fête à Montmartre ; le retour dans le huis-clos étouffant. Alors que les trois premiers actes sont ceux d’une libération, le dernier retourne à la case originelle d’un départ impossible, d’un enfermement familial.

Agrandissement : Illustration 4

On attendait beaucoup de la mise en scène de Christof Loy, remarqué pour un Peter Grimes à Lyon et un rare Guercœur à Strasbourg. Il a opté pour un parti-pris radical avec un décor unique, triste et gris-vert, dans une scénographie signée Etienne Pluss et des lumières blanches de Valerio Tiberi. Et c’est là que le bas blesse car la diversité des lieux et des atmosphères est un des grands atouts de l’opéra. Si la scène de l’atelier de couture et celle de la fête montmartroise sont réussies, ce décor d’une salle d’attente d’hôpital est problématique. Il permet de lire tout le spectacle comme un flashback - ce qui est décidément la mode (voir mon compte-rendu du Don Giovanni). Ainsi, Louise revoit sa vie dans ce vaste espace vide doté cinq très hautes fenêtres avec des volets en bois que l’on ne cesse d’ouvrir et fermer durant toute la représentation (ce qui est aussi répétitif que lassant… même s’il s’agit de symboliser les allers-retours entre ouverture et fermeture au monde). Alors que son Julien n’est autre que le médecin qui la reçoit en consultation, l’image finale est celle d’une pauvre fille, quasi lobotomisée, qui sort, soutenue par sa mère qui la cajole - tandis que l’instant d’avant, elle venait de se jeter par la fenêtre. Admettons.

Agrandissement : Illustration 5

Autre lien avec la production du Don Giovanni, l’inceste qui est clairement suggéré, assorti là aussi de son corollaire : le syndrome de Stockholm, faisant chanter à Louise, au début, son amour pour son père aussi fort que celui pour Julien son amant (c’est dans le livret) puis enlaçant son géniteur de façon explicite à la fin de l’opéra.

Quant à la musique, il y a beaucoup de déceptions, à commencer par un Orchestre de l’Opéra de Lyon en très petite forme. La direction de Giacomo Sagripanti n’a aucunement réussi à donner les couleurs idoines à l’ensemble. Cette musique française nécessite une recherche diaphane dans la scène du réveil de la ville aux sons des cris de Paris, reprenant les multiples chansons des petits métiers, exemple musical unique depuis Clément Janequin et si précieux pour la conservation et l’évocation de tout un monde disparu. Aucune véritable poésie ne se dégage de ces atmosphères subtilement composées par Charpentier. Dans les scènes de chœur (excellent Chœur de l’Opéra de Lyon tout comme la Maîtrise des Bouches-du-Rhône), l’orchestre couvre trop souvent les chanteurs obligeant à des forte trop appuyés. Il est toutefois notable que ces vastes scènes polychorales de l’atelier et de la fête sont parfaitement en place, ce qui n’est pas une mince affaire au vu de la complexité d’écriture et la multiplicité des forces musicales en présence. Peut-être ces réglages ont-ils été privilégiés de sorte que, globalement, c’est un manque d’unité, de rondeur, d’étoffe qui se fait jour dans la nuit d’Aix.
Les « petits rôles » sont luxueusement distribués avec Annick Massis en balayeuse, Marianne Croux en Irma. Il faudrait tous les citer, tant ils donnent une belle énergie, particulièrement dans les scènes d’ensemble où le Pape des fous donne au ténor Grégoire Mour l’occasion de briller avec un entrain communicatif.

Agrandissement : Illustration 7

Incarnant le Père incestueux, drôle d’ouvrier en costume-cravate, tour à tour pervers et impudique, la basse Nicolas Courjal montre de vrais dons d’acteur, avec toutefois un côté surjoué sans doute demandé par le metteur en scène, dans une voix d’airain avec un vibrato un peu large. La très méchante Mère de la mezzo Sophie Koch dénote dans son tailleur Channel incongru et déplacé dans un monde d’ouvriers. Son interprétation est plus que convaincante, malgré une diction toujours en manque de clarté. Quant au Julien du ténor Adam Smith - Pinkerton décevant dans la Butterfly puccinienne l’an passé au même endroit - il rate ses premières notes et, malgré une énergie de tous les instants, ne rend pas le panache bohême de son personnage, tant par un jeu de scène trop souvent caricatural que par un timbre parfois agressif, aux aigus poussés, aux graves manquant de rondeur avec une diction inégale - ce qui est plus que regrettable pour une telle œuvre.

Agrandissement : Illustration 8

La Louise d’Elsa Dreisig, à la présence si émouvante et sensible, au timbre pur et radieux, est bien la grande réussite de ce spectacle. Excellente actrice, elle passe de la prostration du premier acte à l’amour épanoui puis à la folie finale avec naturel. LE grand air de la partition ouvrant le troisième acte, « Depuis le jour où je me suis donnée », si provocant à la création, est ici particulièrement touchant, malgré un aigu légèrement forcé qui surprenait.

Agrandissement : Illustration 9

Finalement, cette actualisation par le truchement de la mise en scène de Christof Loy pose un problème de fond : en débouchant sur le suicide et la folie de l’héroïne, voilà l’opéra rendu beaucoup moins émancipateur qu’à sa création où Louise choisit la liberté en claquant la porte à l’enfermement du passé. On aurait pu s’attendre au contraire…
Reste un choix décoratif lourd de signification politique en 2025. Car durant la fête montmartroise, que chante le chœur ? « Vivent les artistes, gloire aux anarchistes ! ». Alors se déploient et s’agitent sur scène d’innombrables drapeaux tricolores. C’est là non pas un contresens mais un manifeste politique plus que déplacé dans l’air nauséabond du temps : car le Montmartre des artistes exalté par Charpentier, c’est celui qui trente ans avant a été le lieu de naissance de la Commune de Paris. Personne ne l’a oublié lors de la création comme ensuite. S’il fallait des drapeaux, c’était ici des drapeaux rouges et noirs. Mettre le tricolore à cette fête, c’est gommer que le bleu-blanc-rouge était alors l’emblème des revanchards nationalistes - à des années lumières de l’esprit montmartrois. Et c’est donner dans un air du temps fétide qui ne cesse de détourner symboles et valeurs. Dangereuse et inexcusable réécriture.

Agrandissement : Illustration 10

(Théâtre de l’Archevéché d’Aix en Provence - Le 11 juillet 2025)
___________________
Elsa Dreisig*, Louise - Adam Smith, Julien, le noctambule
Sophie Koch, la mère, la première d’atelier - Nicolas Courjal, le père, le chiffonier
Annick Massis, la balayeuse - Marianne Croux*, Irma
Grégoire Mour, un marchand d’habit, le pape des fous - Carol Garcia, Gertrude Karolina Bengtsson, Camille - Marie-Thérèse Keller, Madeleine
Julie Pasturaud*, Marguerite, la laitière - Céleste Pinel, l’apprentie, le gavroche
Marion Vergez-Pascal, Élise, la petite chiffonnière
Marion Lebègue, Suzanne, la glaneuse de Charbon
Jennifer Courcier*, Blanche, la plieuse de journeaux - Frédéric Caton, le bricoleur
Chœurs et Orchestre de l’Opéra de Lyon - Orchestre des Jeunes de la Méditerranée
Giacomo Sagripanti, direction musicale
Christof Loy, mise en scène - Etienne Pluss, scénographie
Robby Duiveman, costumes - Valerio Tiberi, lumières - Louis Geisler, dramaturgie



