Hier se tenait à l’Assemblée Nationale un colloque d’une brûlante actualité organisé par La France Insoumise autour de trois thèmes : 1/ La guerre sans démocratie 2/ La guerre invisible 3/ La guerre imposée. Les intervenants étaient d’une grande qualité et apportèrent de précieuses informations à une assistance venue en nombre.
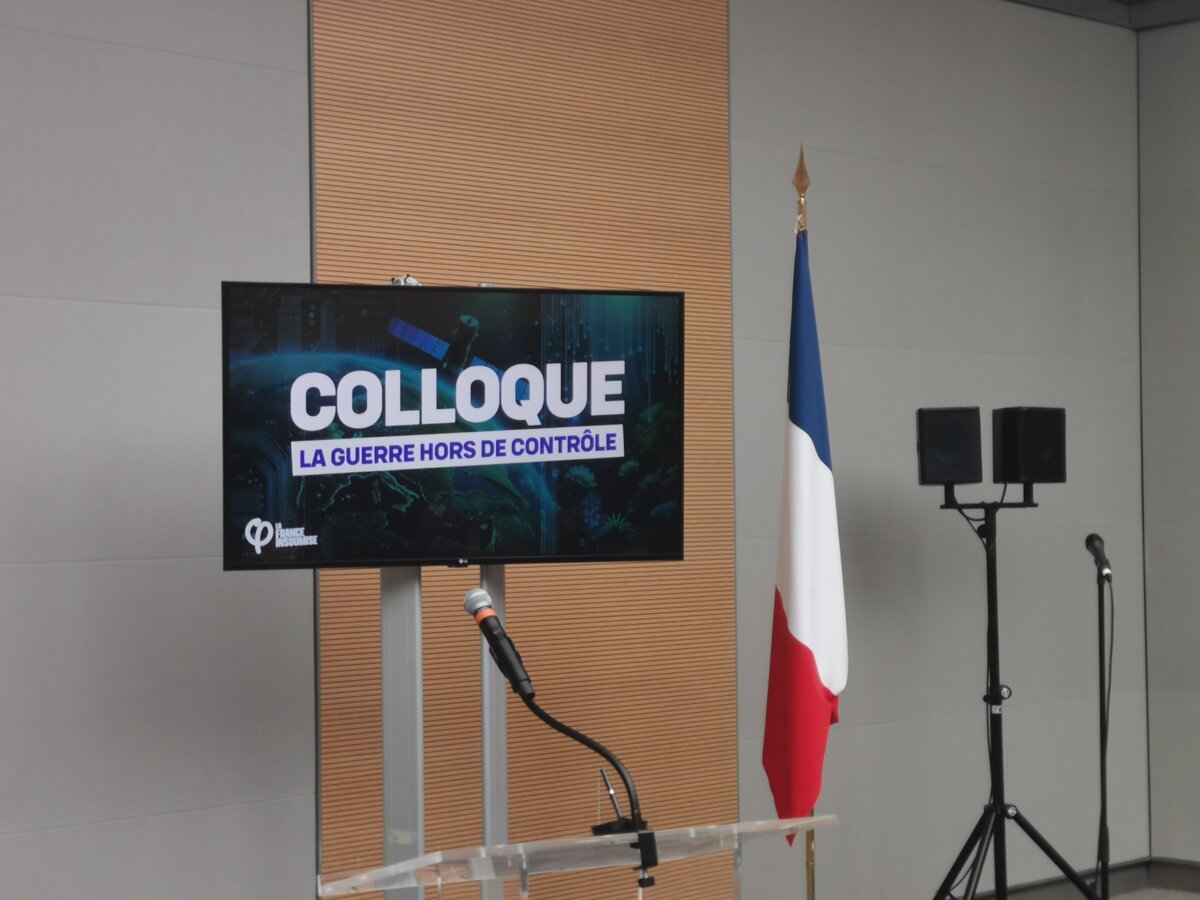
Agrandissement : Illustration 1

En introduction, la députée Nadège Abomangoli, vice-présidente de l’Assemblée Nationale, rappelait la brutalité avec laquelle Trump envisage la résolution des guerres. Va-t-on vers une Pax Americana ? Pointant ce qui nous hante toutes et tous, à savoir que la guerre est à nos portes, insistant sur le non respect du droit international par la Russie ou par Israel, elle interrogeait : quel soutien du droit existe contre la loi du plus fort et comment ne pas subir cette loi du plus fort ?
« En tant que pacifistes conséquents, nous ne pensons pas que l’on prépare la paix en relançant cette course aux armements qui a pour conséquences de rogner les droits sociaux et de casser les services publics. Le refus de la guerre est une boussole pour nous. »
1/ La guerre sans démocratie
- Grégory Daho, maître de conférence en Science Politique à Paris 1 Sorbonne, intervenait tout d’abord sur la question du contrôle parlementaire, donc des citoyens via la représentation nationale, dans les décisions qui engagent militairement la France.
Le Parlement joue un rôle dans la loi de programmation militaire. Mais l’emploi récent du 49.3 a empêché tout débat.
Le Parlement a avalisé toutes les interventions depuis 2008, sans qu’aucune leçon politique ne soit tirée. Il faut donc mettre à l’agenda la question de la démocratisation de la politique de défense. Une direction autocratique est-elle évitable ? Les responsables politiques peuvent-ils contrôler les opérations militaires ? Comment se fait-il que des pratiques se cristallisent pour aboutir à la seule prééminence du « domaine réservé » du Président de la République ?
Car dès lors, la question du contrôle parlementaire devient un non-sujet : le Président décide, circulez, il n’y a rien à voir… Ainsi, le contrôle des techniques du renseignement est un hors champ parlementaire…
La clé de cela, c’est l’auto-disqualification des parlementaires qui n’imposent pas le droit de regard démocratique dont les institutions en font pourtant le garant.
D’où deux questions clés :
1/ Consensus de défense : sur quelle base ? 2/ D’où vient cette auto-disqualification des parlementaires ?
1/ Cette expression de « consensus de défense » a émergé via le PS de la fin des années 1970 autour du nucléaire, de la place de la France au Conseil de Sécurité de l’ONU, puis de la fin de la conscription. Hausse des budgets de l’armée ? Depuis quelques années, tous les partis s’y rallient autour de l’idée d’une armée bonzaï (tout faire, en petite quantité et pour peu de temps).
C’est en France que la chaîne décisionnelle est la plus courte qui soit : trois niveaux de décision : le Président, le Comité de défense, le Général en chef des armées (Thierry Burkhard depuis 2021).
2/ D’où vient cette auto-disqualification des parlementaires ?
On ne créé pas le consensus, on est pris dedans.
On peut pointer les effets sur une carrière politique : un député est un généraliste. S’il n’a pas de base militaire dans sa circonscription, il n’est pas très intéressé par des sujets militaires qui ne rapporteront pas de voix aux élections. C’est donc un choix de logique de carrière.
Il faut compter avec les préjugés à propos de la technicité militaire. Il faut des connaissances très précises et pointues.
Il est politiquement couteux de produire un dissensus dans l’Assemblée car le débat se passe a-posteriori, lorsque les forces françaises sont déjà engagées (comme dans le cas du Mali) Et se forger une opinion dissidente prend énormément de temps.
Pourtant, il n’y a pas d’effet mécanique. On assiste à un renouvellement générationnel. Les affaires militaires deviennent moins exotiques. L’armée pourrait redevenir un ciment de l’unité nationale.
Quoiqu’il en soit, il faut un accès à l’information pour les parlementaires. La sur-classification Secret défense est un véritable problème. Il est codifié en France en plusieurs strates : diffusion restreinte / Confidentiel défense / Secret défense / Secret défense France / Secret secret défense.
- Rebecca Mignot-Mahdavi, spécialiste du droit international, professeure à Science Po, intervint en visio sur le thème de « la guerre infinie ».
L’Article 35 de la Constitution est au cœur du questionnement : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. »
Ainsi, la guerre commence sur une déclaration officielle, ce qui est une notion totalement dépassée. Il n’y a presque jamais de déclaration de guerre. (rappelons qu’en 1939 même, la France entra en guerre à reculons, en suiviste de l’Angleterre, avec cette formule sibylline: « La France se considère en état de guerre avec l’Allemagne »)
Cette idée de « déclaration de guerre » est morte avec les Conventions de Genève de 1949. Il s’agissait alors de déterminer des critères objectifs. L’Article 2 de la déclaration de Genève dit clairement que l’état de guerre est reconnu même s’il n’y a pas eu déclaration. On passe donc à la notion de conflit armé. Ce que confirment les Protocoles de 1977. Différents conflits armés peuvent co-exister.
D’où la proposition de loi constitutionnelle déposée par LFI pour abolir l’article 35, afin d’installer la pratique d’un renouvellement annuel de la poursuite d’un conflit armé auprès du Parlement. La déclaration de guerre n’a plus sa place dans la Constitution.
Quant aux critères juridiques concernant la fin de la guerre, ils sont liés au début de la guerre : deux états commencent des hostilités ou bien cela est lié au seuil d’intensité des violences. Dans le cas de la fin, il y a dilution de ces critères objectifs. Ces dernières années, une théorie contestée d’absence de risques raisonnables de la reprise des hostilités a été énoncée par Florence Parly (ministre des Armées de 2017 à 2022). Ce qui contrecarre l’appétence pour la guerre infinie.
Il serait important de soumettre au vote du Parlement tout envoi de forces armées. A l’heure des nouvelles technologies de guerre, de la dilution de la frontière guerre/paix, c’est loin d’être le cas. Le droit international pourrait être le levier dans la nécessaire intervention du Parlement dans son regard sur les questions militaires.
- Bastien Lachaud, député LFI rapporteur de la commission de la Défense Nationale, s’interrogea sur les moyens de mettre en échec la toute puissance de l’exécutif, puisqu’actuellement, le Président peut décider seul.
Jusqu’à maintenant, il y avait validation par le Parlement au bout de 4 mois d’intervention des forces extérieures, dans le cadre d’une OPEX (Opération Extérieure).
Mais on est passé de l’intervention validée par le Parlement à une nouvelle catégorie, les missions opérationnelles. Ainsi, le ministre actuel, Sébastien Lecornu, évoque les centaines de soldats français déployés en Roumanie disant qu’ils n’y font que ce qu’ils feraient à Mourmelon : des exercices. Or s’il se trouve des troupes en Roumanie, c’est pour dissuader l’armée russe d’envahir le pays. Or à aucun moment le Parlement n’a voté : au delà de cet exemple récent, il pourrait donc se trouver totalement exclu de toute prise de décision.
Il faut que tout envoi de forces militaires soit discuté et voté. Pensons à l’Opération Serval, lancée le 11 janvier 2013, devenue Opération Barkane le 1er août 2014, sans que jamais cela ne soit discuté au Parlement. En effet, au bout de 2-3 mois, il y eut un succès foudroyant de l’opération Serval. Grisé par ces succès contre les djihadistes, Barkane pris le relai en étendant les objectifs au nord du territoire du Mali et concernant 5 pays du Sahel.
Sans aucun contrôle démocratique, cette opération a coûté 58 morts et un milliard d’€ par an jusqu’à sa fin précipitée, lié au retrait à la va-vite, annoncée par Emmanuel Macron le 9 novembre 2022.
Les choses se compliquent encore lorsqu’il s’agit de former des militaires dans un pays en guerre par le biais d’officiers de liaison. On ne connait pas le contrat opérationnel. Mais ils font plus que de la formation…
Il peut aussi exister l’envoi des troupes d’élite. Et concernant les groupes para-militaires qui se développent de plus en plus, comment lutter par le droit contre des groupes qui, par définition, sortent du cadre de la législation internationale sur le droit de la guerre ? Ce sont d’anciens officiers qui sont partie prenante dans la formation de ces groupes.
Depuis quelques années, l’armée omniprésente dans le quotidien. D’abord dans nos espaces publics avec la préssence des soldats de Sentinelle, mais aussi par l’apparition toujours plus fréquente de militaires en uniforme dans les médias, ce qui avait disparu depuis la fin de la guerre d’Algérie. Il y a une réhabilitation de la figure de l’officier qui va de pair avec la décharge du politique sur le militaire (cf sécurisation des manifestations de Gilets Jaunes par l’armée).
Le premier employeur de la jeunesse non-qualifiée est l’armée (54.000 soldats) avec seulement 1/3 des contrats renouvelés.
Les officiers sont conscients qu’il y a un problème car les militaires veulent être l’armée de la Nation plus que le bras armé de l’État. Il existe, de la part de l’armée, une volonté de fournir les informations à la représentation nationale - dans les limites de l’autorité de l’exécutif.
- Aurélien Saintoul, député LFI membre de la commission de la Défense Nationale, évoqua ensuite le coût du dissensus.
La conscription : l’idée fait consensus dans la population en tant que lien social. Mais il n’existe aucun consensus sur ce sujet dans la communauté militaire : trop cher, « ce n’est pas à nous de faire ce lien social… Bien que se dessine inflexion et changement au sein des élites militaires, avec une réflexion sur le modèle des réserves, de ce que font les finlandais.
La proposition LFI de « conscription citoyenne » : une proposition particulière.
Que fait-on en cas d’agression ? Allons-nous directement vers la vitrification ?…
Compte-tenu des agressions actuelles, la société entière doit être consciente de ces réalités. D’où la nécessité de cohésion, la responsabilisation en position de citoyenneté active afin que le citoyen soit un acteur de l’État. C’est un projet de société global (conscription dans le service public de la santé, la police, l’armée, les eaux et forêts, etc…)
Toute prise de position argumentée est réputée hérétique d’autant que la société du spectacle sape toute forme de débat démocratique.
Alors que l’on débat aujourd’hui du concept de « guerre infinie », dans notre programme L’Avenir en commun de 2022, nous avions déjà introduit le thème de « guerre larvée ».
Mais face au triptyque traditionnel « Paix / Crise / Guerre », un tout autre triptyque s’est installé : « Compétition / Contestation / Confrontation ». Il n’y a plus là ni paix, ni guerre. A l’origine, il y a le concept de compétition - qui conduit à la guerre. Face à cela, nous opposons coopération (rien n’est plus universel que le problème écologique) et non-alignement.
2/ La guerre invisible
Comment la guerre hybride déborde-t-elle les cadres juridiques et doctrinaux traditionnels ? Comment se préparer au pire sans le faire advenir, sans renoncer à contrôler la force.
- Général Denis Mercier, ancien Chef d’état-major de l’armée de l’air et commandant responsable de l’avenir et la prospective au sein de l’OTAN
Comment fait-on pour prévoir l’avenir quand on est militaire ? C’est prévoir le futur des décisions d’aujourd’hui. La prospective commence maintenant. Les méthodes ? Cela vient des directives politiques ; ainsi Le livre blanc pour la France, ce cadre de la stratégie de défense française pour les années à venir, traduit en besoins militaires les buts fixés : ce qu’il faut / ce qu’il y a / ce qu’il faut obtenir. Il s’agit de traduire en terme industriel et trajectoire budgétaire, répondre en terme de moyens. Or les engagements sont de plus en plus complexes. Pour le long terme existait auparavant le plan de prospective à 30 ans.
Les nouvelles technologies changent beaucoup de choses : autres domaines (cyber-espace), domaine sous marin (quelles capacités ?), opérations multi-domaines. L’organisation d’un flux d’organisation digitale est nécessaire, avec une infrastructure digitale au cœur de tout. Ce qui amène à la question de l’IA - permettant de répondre différemment aux questions « classiques ». Il y a là un vrai enjeu d’autonomisation et de modernisation.

Agrandissement : Illustration 2

- Laure de Roucy-Rochegonde, chercheuse à l’IFRI, auteure de La guerre à l’ère de l’intelligence artificielle évoque alors la guerre invisible et la place de L’IA.
Il y a un recours de plus en plus marqué, comme on le voit en Ukraine et à Gaza. L’IA est un système qui irrigue désormais tous les systèmes traditionnels.
Quelle définition donner à l’IA ? Celle de John Mc Carthy en 1956 : « c’est un ensemble des techniq permettant de mieux comprendre et imiter le domaine humain et de le répliquer ».
Les SALA, Systèmes d’armes létales autonomes, sont à la pointe des hautes technologies. Une fois activés, ils sont utilisables sans opérateur humain dans un environnement changeant. Plus rapide et précis, plus coordonnés. Un drone classique = télécommande piloté à distance. Un drone autonome = il n’y a plus d’opérateur et le drone résiste aux capacités de brouillage.
Cela induit des réflexions juridiques, des préoccupations sécuritaires (escalade, prolifération…), des questions éthiques. Se pose le problème du contrôle politique de la force, ce qui renvoie à la capacité des citoyens à contraindre les forces politiques dans l’emploi de la force. Il y a une érosion de plus en plus grande dans la capacité des citoyens à intervenir. Quid du droit à l’information, du contrôle et de la sanction parlementaire ? Si l’on reprend la théorie de Kant sur le libre consentement par le vote donnant lieu à un « impôt du sang », alors le contrôle s’exerce en amont (autorisation) et en aval (les parlementaires peuvent demander des comptes).
Or les armes autonomes remettent cela en question. Elles permettent une économie de la vie humaine et une économie de dépense public. Avec comme risque un moindre regard des citoyens et un moindre coût politique. L’exemple de l’intervention des USA en Libye le 15 avril 1986 est éclairant : la loi n’a pas été respectée, la Maison Blanche dut en répondre devant le Congrès et déclara que ce n’était pas la peine car il n’y avait pas de pertes humaines américaines en jeu.
Ces armes nouvelles posent un problème d’aléa moral : moindre risques = problème de dé-responsabilisation de l’agent. Avec un autre problème : des mesures moins brutales rendent la guerre « plus propre », sont donc plus tolérées. Mais un mal plus grand peut advenir en raison de mesures cumulatives. Les drones permettent de projeter du pouvoir sans projeter de vulnérabilité, avec le danger de la banalité de la banalisation.
- Aurélien Saintoul
Dans ces nouveaux espaces de la guerre, il y a la question des océans et des fonds marins. Selon lui, si une guerre devait se déclencher, se serait par une agression en mer, car la plupart des échanges ont lieu en mer. Interrompre les flux commerciaux est un moyen d’attenter au potentiel naval, de viser les intérêts économiques. Cela peut prendre la forme de harcèlement, de sabotage, d’attaques directes via des intermédiaires (cf des Houthis et l’Iran ou les câbles sous-marins dans la Baltique…)
Infrastructures (sous-)marines devenant des cibles pour tout acte malveillant.
En quoi est-ce nouveau ? La piraterie, la guerre de course n’est pas neuve. Mais nous vivons une nouvelle ère corsaire. La piraterie fut interdite par le traité de Paris de 1856 qui mettait fin à la guerre de Crimée : marines civiles et de guerre se sont dissociées - jusqu’à un retour de la piraterie dans les années 1990. Question réglée par moyens militaires traditionnels et acteurs privés. La stratégie de puissance des États est d’identifier les combattants en mer. Le cadre légal ordinaire est débordé. Qui soutient et armes les pirates ? Lorsque les infrastructures visées (navires ou autres) appartiennent à de grandes entreprises, les attaquer est-ce attaquer des intérêts privés ou nationaux ? Dans la guerre hybride, à qui imputer les actions de destruction ? Cadre légal qui doit évoluer. Comment faire pour éviter l’escalade, sans pour autant banaliser… ?
- Général Denis Mercier : On n’est pas dans un domaine de temps de paix - jamais. Est-ce qu’on laisse faire, jusqu’à un certain point et lequel ? Comment caractériser ?
Exemple d’une attaque cyber : d’où viennent-elles ? D’un état ou de mafieux ? Le plus souvent les deux. C’est un domaine où l’on fait attribuer à d’autres les actions offensives. L’espace ou les mers sont des domaines visibles. Mais avec le cyber c’est beaucoup plus complexe pour caractériser d’où est partie la menace. La réponse à ces attaques ne sera pas forcément cyber. Jusqu’où grader la réponse sans aller provoquer l’escalade?
Il faut combiner les moyens de caractérisation via une réponse internationale, sur des communautés de valeurs. Il faut traiter cela à plusieurs et non pas de façon individuelle.
- Laure de Roucy-Rochegonde : La qualification juridique est essentielle. A quel moment un casus belli pourrait intervenir dans ces domaines cyber.
- Aurélien Saintou : lComment rester une démocratie si l’on ne rend pas publics les coups que l’on reçoit et ceux que l’on donne ? Dans le domaine international, on n’a pas d’amis, on n’a que des intérêts.
- Général Denis Mercier : Il est des choses que l’on peut dire dans des cercles plus restreints.Après avoir passé 6 ans dans l’OTAN, il est clair que l’on peut être capable de vider son sac sur un désaccord mais pour autant, ne pas l’afficher publiquement.
- Laure de Roucy-Rochegonde : Dans le domaine des Relations Internationales, c’est le lieu du secret et de la raison d’État. Les Organisations internationales sont essentielles.
- Général Denis Mercier : Est-il possible de fixer des règles codifiées de réponse à une attaque ?
Un exemple dans l’OTAN : imaginons un pays du Moyen-Orient lançant un misssile pouvant atteindre l’Europe. La détection doit être très rapide. Il faut envoyer un missile-anti-missile pour le stopper dans l’espace. Le seul point pour l’arrêter est de le frapper à son apogée. Le temps de réaction est de 10 minutes à peine. La 1ere réponse fut : bravo, efficace, allez-y ! Oui, mais Moscou se trouve en dessous. Comment les russes vont-ils prendre cet envoi de missiles balistiques ? D’où la 2è réponse : ah non ! Il faut d’abord une décision politique. Mais c’est impossible car il n’y a que 10’ entre la détection et le point d’impact. Il y a bien risque d’escalade sur un sujet grave.
Dans le cas de la crise de Cuba en 1963, la dissuasion nucléaire empêchait l’escalade. Aujourd’hui, tout se pose différement avec les nouvelles technologies.
Il existe des munitions téléopérées par l’IA. De nouveaux acteurs industriels sont déjà en activité pour les produire, en Ukraine notamment.
- Laure de Roucy-Rochegonde : Il existe une Agence ministérielle pour l’IA de défense.
Avec l’IA, quelle est la place des humains dans la boucle ? Il y a un effet black-box : les développeurs eux-mêmes ne comprennent pas vraiment le fonctionnement de la machine, alors que les opérateurs ont tendance à avoir une grande confiance dans la machine.
- Bastien lachaud : Il n’y a pas de droit international pour protéger l’espace, le numérique et la mer. Cf la figure d’Elon Musk : en 2019, il y avait 2.000 satellites en orbite. En 2025, il y en a 10.300 dont 6.000 de Starlink (avec 12.000 pour objectif…) Cela ouvre des questions majeur en terme de pollution. L’espace devient lieu majeur de confrontation et les enjeux dépassent les nations. Car espace et mer sont les lieux des mécanismes du changement climatique. Comment réintroduire l’Humain dans la boucle des enjeux ?
La France est la 1ère nation spatiale européenne. Concernant la mer, nous possédons la 2è zone économique exclusive du monde. Quel projet politique portons-nous pour jouer notre rôle et avoir une influence de Paix ? La réponse mobilise toute la société (enseignement…) Nous devons être souverains, or il y a absence de volonté du Gouvernement pour sauver Atos ; nous avons besoin d’un réseau diplomatique à la hauteur de nos ambitions et Macron a cassé le corps diplomatique.
Notre boussole : faire des lieux de confrontation des lieux de coopération.
3/ La guerre imposée :
Les alliances défensives conduisent-elles à l’escalade ?
- Mélissa Levaillant, Docteur en Science Politique - Spécialiste de l’Asie
Avant, on parlait de la zone Asie Pacifique, désormais, Zone Indopacifique. A partir des années 2010, certains états ayant des intérêts dans les océans Indien et Pacifique ont désigné ainsi cet espace, dont la délimitation n'est jamais clairement définie, mais qui est une façon d’en exclure la Chine. A partir de 2018, la France a adopté une stratégie en zone Indo-pacifique. Puis l’Allemagne et d’autres. Ce qui pose d’emblée des questions d’enjeux sécuritaires, d’enjeux lié au dérèglement climatique, d’enjeux de tensions y compris pour le maillage d’intérêts pour la France dans la zone.
Les risques de conflits à haute intensité sont forts dans cette immense zone concentrant 35% de la richesse mondiale et 70% de la croissance.
Ce sont des lieux de tensions géopolitiques : Taiwan, la péninsule coréenne, Inde… Les USA ont des accords de défense avec le Japon, la Nouvelle Zélande, l’Australie, les Philippines, alors que la Chine n’a pas d’accords de maillage. Mais elle pratique de multiples investissements dans les ports civils. Il n’est pas rare que des flottilles de pêcheurs armées attaquent pêcheurs vietnamiens ou philippins. A partir des années 2000, ils ont poldérisé des atolls pour y installer des pistes d’atterrissage.
Quelle est la place et les propositions de la France ? La place est singulière, avec des atouts, dont l’attachement à une autonomie stratégique : refus de la stratégie de communication des USA, refus de bipolarité, engagement au soutien du multilatéralisme. Les cadres multi-latéraux restent faibles dans cette zone indo-pacifique. L’ASEAN (fondée en 1967) exprime un besoin de mutilatéralisme. La France propose des alternatives basées sur partenaires clés (Inde, Japon). Les territoires ultra-marins sont pris en compte. La France reste dans le cadre de l’alliance US avec une prise de conscience des menaces de la Chine.
- Jean-Luc Mélenchon intervint ensuite pour rappeler que la Zone Indo-Pacifique comprend 75 pays, 2/3 de la population et du commerce mondial, 60% du PIB. C’est la zone numéro 1 : tous les pays possédant l’arme nucléaire sont là ! Chine, USA, GB, France, Inde, Pakistan. Il rappelle que les frontières de la Chine, intégrant Taïwan, sont reconnues par l’ONU.
- Mélissa Levaillant, revenant sur Taiwan, rappelait que lors d’un colloque international en 2018, le Ministre défense chinois parlait de sacrifier des centaines de milliers de vies chinoises pour récupérer l’île.
Concernant le désarmement nucléaire la tendance va à l’inverse de ce qui fut acté pendant la guerre froide. D’autant que les USA et la France ont accepté de dire que l’Inde était une nation nucléaire responsable, bien que non signataire du traité de non-prolifération. Ce qui a contribué à sa décrédibilisation…
- Le député Arnaud Legal est revenu sur la politique de non-alignement prônée par LFI en insistant sur :
* L’enjeu du symbole : parler au-delà de l’Occident, aux pays du sud global.
* C’est tout sauf la neutralité : il s’agit de s’aligner sur le droit international, sur les biens communs, sur la paix.
* C’est l’indépendance. Tout sauf l’isolement, dans un monde où les alliances sont fluides. Nous le constatons au jour le jour.
- Enfin, pour terminer ce colloque, Jean-Luc Mélenchon fit une intervention sur le travail au long-court de LFI, insistant tout d’abord sur la nature de la guerre qui a changé depuis la 1ère Guerre Mondiale. Aujourd’hui, les militaires font la guerre aux civils. Dans la réalité de la guerre contemporaine, c’est la masse de la population qui est visée.
Voir : https://melenchon.fr/2025/03/15/trump-poutine-le-double-contre-sens-de-macron/
(Les Actes du colloque sont à venir)

Agrandissement : Illustration 3




