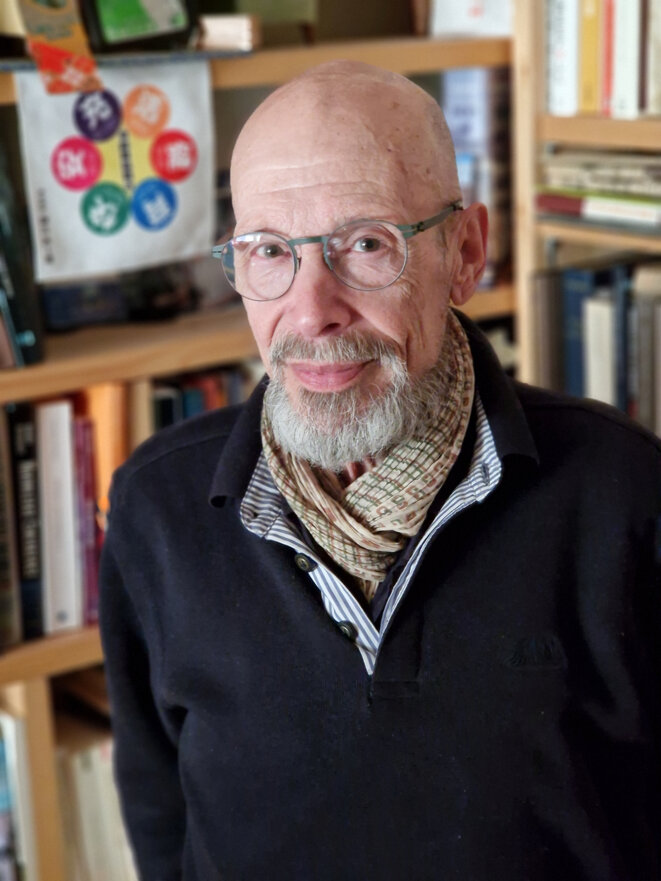Le libéralisme destructeur des liens et des limites au nom de la science
Les Lumières c’est aussi un formidable retournement de la position de subordination de l’homme vis-à-vis de la nature. L’Âge de la raison a fait de l’homme celui qui connaît la nature de manière scientifique avec Francis Bacon (1620) et cette Raison doit même permettre, selon l’injonction de René Descartes (1647), de « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». S’ouvre alors l’ère d’un progrès scientifique auquel nulle limite ne doit être opposée – on ne verra plus les malheurs d’un Galilée à qui l’inquisition interdisait en 1633 de professer que la Terre tournait autour du soleil. Ce renversement est aussi bien sûr celui qui a permis – j’y viendrai plus loin- de doter l’humanité de la capacité de se détruire, de mettre fin à l’habitabilité de la terre et d’offrir aux plus puissants l’espoir d’une cyber -humanisation peut-être martienne.
La conception de la liberté individuelle a amené John Locke (1690) à soutenir que cette liberté doit permettre à chacun de s’approprier les fruits de son activité et il a fait de la propriété privée un fondement du credo libéral et des droits civils que reconnaissent à tout individu des déclarations solennelles. Ce faisant, la porte a été ouverte, en Angleterre à l’essor du mouvement des « enclosures » et, plus largement, dans les démocraties libérales à la disparition des communs. La nature n’est plus disponible pour que chacun puisse en être un co-usufruitier raisonnable. Le lien collectif avec la nature est rompu au bénéfice de la logique d’une appropriation privée et d’une marchandisation de la terre : on peut l’acheter et la vendre.
Ce faisant, la conception de Locke conduit également à rompre le lien entre les personnes pour y substituer une relation contractuelle entre individus libres qu’Adam Smith[i] (1776) a ensuite généralisée par un discours de théorie économique popularisant le slogan « laissez faire laissez passer ». Smith prônait que lors de ces échanges chacun ne considère que son seul intérêt personnel, car, « conduit par une main invisible […] en ne cherchant que son intérêt personnel, […il agit] d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société[ii]. » Karl Polanyi (1944) souligne le rôle du culte de la raison, de cette économie politique qui prétend révéler les lois scientifiques qui gouvernent le monde, et justifier par ces lois la posture libérale[iii].
Smith imagine que, de toutes façons, bien rares étaient les marchands qui, avant cette démonstration, avaient la passion de travailler pour le bien général. Karl Marx et Friedrich Engels (1848) font plus que confirmer l’hypothèse de Smith et dénoncent au-delà des marchands la Bourgeoisie et l’égoïsme qu’elle pratique, sans besoin de soutien théorique, grâce à la révolution politique libérale[iv]. Selon eux, elle n’a laissé « subsister d’autre lien entre l’homme et l’homme que l’intérêt tout nu, le froid « paiement comptant ». […]. Elle a dissout la valeur de la personne dans la valeur d’échange, […] à la place de l’exploitation voilée par des illusions religieuses et politiques, elle a mis l’exploitation ouverte, éhontée, directe, dans toute sa sécheresse. »
L’appropriation privée des terres et leur marchandisation tout comme celle de la force de travail, permises par la philosophie libérale et justifiées par la science économique constituent une aberration en termes humanistes. Ce que fustige Polanyi : « le travail n’est rien d’autre que ces êtres humains eux-mêmes dont chaque société est faite, et la terre, que le milieu naturel dans lequel chaque société existe. Les inclure dans le mécanisme du marché, c’est subordonner aux lois du marché la substance de la société elle-même[v]. » C’est pourtant ce qui a été fait, supprimant les liens et les limites des relations entre les hommes, entre eux et la nature, et ouvrant un espace où a pu s’engouffrer l’esprit du capitalisme, soufflant tel un ouragan destructeur.
L’ouragan déclenché par l’esprit du capitalisme
Selon Fernand Braudel[vi], l’émergence de structures sociales façonnées par des comportements capitalistes est observable dès le 12ème siècle en Europe. C’est ensuite le cas de la transformation de villes comme Venise au 13ème, puis d’autres au fil des siècles avant que l’Angleterre entière soit à son tour restructurée. Joseph Schumpeter[vii] repère des prémices du capitalisme dans l’Antiquité et souligne que les capitalistes d’avant le libéralisme s’appuient sur un pouvoir politique fort et protecteur.
« Capitalisme » désigne un processus d’accumulation matérielle par un opérateur « privé », un individu ou une entité – un groupe organisé de personnes ou une institution. Ce processus repose sur l’appropriation, par tous moyens, de quelque chose que l’opérateur considère comme une ressource, sur laquelle il exerce son pouvoir de propriétaire afin d’en réaliser l’exploitation. Dans le but de réaliser un profit, en obtenant de l’exploitation efficiente de cette ressource, la valeur d’échange la plus élevée possible par rapport aux coûts de son obtention, sorte de retour sur investissement, et qui permet de continuer le processus d’accumulation. Sa logique est utilitariste : tout peut être tenu comme une ressource à exploiter, et il faut le faire de manière efficiente, sans considération morale ou politique, dans un univers de rivalité sans merci, face à d’autres opérateurs existants ou potentiels et sans auto-limitation d’aucune sorte. Selon le mot d’ordre caricaturé par Marx[viii] : « Accumulez, accumulez ! C’est la loi et les prophètes ! […] Accumuler pour accumuler, produire pour produire, tel est le mot d’ordre de l’économie politique proclamant la mission historique de la période bourgeoise ».
La marchandisation de la terre et du travail, c’est à dire la propriété privée et le salariat ont ouvert un boulevard aux capitalistes. L’essor scientifique et technique leur a permis une formidable et continue croissance des possibilités de production, mais il leur a été nécessaire de trouver des débouchés. Le souci permanent des capitalistes reste celui d’étendre les marchés toujours et encore. Ce qu’a autorisé le « Laissez faire laissez passer », - aujourd’hui l’OMC et les accords d’échanges bilatéraux- facilité par l’essor des infrastructures et des moyens de transport qui ont soutenu la pénétration – presque accomplie- du capitalisme dans le monde entier « globalisé ».
L’extension des marchés est allée de pair avec la généralisation de l’usage de la monnaie et à ce que peu à peu, tout devienne marchandise et/ou ressource à exploiter sous la pression de l’esprit capitaliste. Comme la terre et le travail, la monnaie elle-même a été marchandisée. La monnaie a échappé aux monopoles d’Etat et depuis la fin des années 1970, l’époque dite néolibérale est celle où ce sont les banques privées qui créent de la monnaie en raison de leurs perspectives de profit. Elle est celle de la montée de l’endettement des Etats eux-mêmes, pour un montant global égal au PIB mondial et de la multiplication des instruments financiers dits dérivés. Ces actifs financiers reposant sur d’autres actifs financiers sans contrepartie réelle, d’un montant insignifiant en 1990 sont passés à 370 mille milliards de $ en 2006, soit 7 fois le montant du PIB mondial et ont joué un rôle majeur lors de la crise de 2008.
Les financiers achètent et vendent des actifs comme autant de ressources à exploiter de manière efficiente pour en tirer profit. Ils n’hésitent pas à investir dans des paradis fiscaux. La libération totale des mouvements internationaux de capitaux au milieu des années 1980 après celle des taux de change avait été obtenue des autorités sur la prétention que les marchés financiers seraient efficients, c’est-à-dire que tout en s’autorégulant ils assurent la répartition des capitaux là où ils sont nécessaires. Il n’en a absolument rien été. En revanche, comme dans le passé, l’absence de régulation a provoqué des crises périodiques qui se répercutent sur l’économie réelle et font souffrir les masses, tandis que les spéculateurs en bourse n’ont pas à se plaindre. Ainsi entre 2010 et 2020, alors que la croissance mondiale était inférieure à 4%, l’indice boursier US S&P 500 grimpait de 14, 35%.
Cela ne peut se faire que par une extraction de valeur par la sphère financière sur la sphère de l’économie réelle. Et cela au détriment des masses populaires qui, dans les pays riches voient leur situation se dégrader depuis 40 ans et qui dans la plupart des pays pauvres, survivent avec difficulté alors même qu’on leur avait promis, il y a 75 ans « le développement ». S’il n’y a pas d’amples protestations populaires c’est en raison à la fois d’une imposture monstrueuse et d’un autre avatar du libéralisme, dont il me faut rendre compte.
En tout cas, mon propos montre déjà clairement qu’on ne peut attendre nulle amélioration en poursuivant avec la philosophie libérale qui soutient cette mainmise des relations de marché et de l’esprit du capitalisme sur l’organisation des sociétés avec les conséquences désastreuses qui en découlent.
A suivre…
[i] Adam Smith (1776) Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, traduction de Germain Garnier, 1881.
[ii] Tome IV, Livre IV, Chapitre II.
[iii] Karl Polanyi (1944) La Grande Transformation – Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 1983, p. 144.
[iv] La citation à suivre dans le texte est extraite p. 164-165 de Karl Marx et Friedrich Engels (1848) Le Manifeste Communiste, in Karl Marx Œuvres – Economie, T 1, Gallimard, 1965.
[v] Ibid., p. 106.
[vi] Fernand Braudel (1979) Civilisation matérielle et capitalisme Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XVe et XVIIIe siècles), 1. Les Structures du quotidien - 2. Les Jeux de l'échange - 3. Le Temps du monde, Paris, Armand Colin. Le tome 1 était paru en 1967.
[vii] Joseph Alois Schumpeter (1942) Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 1951.
[viii] Karl Marx (1867) Das Kapital, Vol 1, Chap. XXIV, Sect. 3, ici, Karl Marx, Oeuvres op.cit., p. 1099.