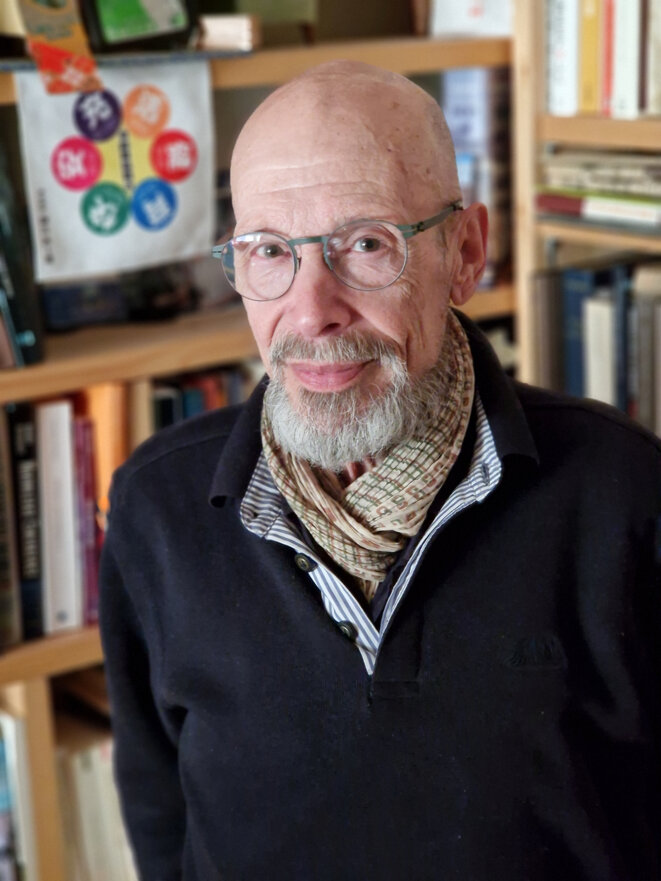Dans ce monde qui coule quelle est la tâche des intellectuels ?
Je vais présenter une réponse ancienne à cette question – quelle est la tâche des intellectuels ? - qui se pose à moi de différentes manières. Professeur émérite d’université, j’ai publié des centaines de textes plus ou moins longs, enseigné à des milliers d’étudiants, prononcé des dizaines de conférences, participé et intervenu dans autant de colloques, animé des dizaines de réunions de citoyens. Mais je n’ai pris aucune responsabilité politique et je n’ai pas dirigé des établissements, que ce soit dans les secteurs public ou privé ou dans l’économie sociale et solidaire qui auraient pu apporter des contributions anticipatrices au changement de système. J’entre donc dans la catégorie des intellectuels et assez souvent lorsque je me mêle de présenter des analyses, de proposer des principes d’orientation, certains pensent voire me disent : et alors qu’est-ce qu’on fait, tout cela c’est bien une position d’un intellectuel, c’est de la théorie ! Passez aux actes !
Mais, j’ai persisté, pensant, auraient dit mes critiques, que je pouvais m’abstenir de ces actions, croyant ma tâche ailleurs. Toutefois comment définir ce que peut être la tâche d’un intellectuel dans ce monde qui coule ?
Effectivement ce monde, l’humanité, coule, et il faut considérer que cette régression globale a commencé depuis longtemps. C’était déjà le constat porté en 1964 par Herbert Marcuse (1898- 1979). Cet Allemand exilé aux Etats-Unis pose ce diagnostic terrible en particulier dans son ouvrage l’homme unidimensionnel. Avant même 1960, nombre d’intellectuels ont compris que l’humanité est engagée non pas vers un progrès infini mais dans une voie en impasse. Toutefois ses leaders ont réussi à convaincre, à manipuler les peuples pour continuer dans la direction prise, celle qui mène à une impasse, une voie de destruction de l’humanité et de la nature. Parmi d’autres intellectuels qui en étaient conscients, il y avait l’économiste français, François Perroux (1903- 1987)[1].
Ainsi Marcuse s’appuie sur une citation de Perroux[2] pour affirmer (le passage emprunté est en italique) : « Les esclaves de la civilisation industrielle avancée sont des esclaves sublimés, mais cependant ils sont esclaves, car l’esclavage peut se définir : « non par l’obéissance, ni par la rudesse des labeurs, mais par le statut d’instrument et la réduction de l’homme à l’état de chose » ». Il puise aussi confirmation dans cet ouvrage de Perroux publié en 1958 que le fondement de cette situation gît dans « les mystifications de l’industrie et du pouvoir » citant à nouveau Perroux[3] qui précise : « La collusion de l’industrie moderne et du pouvoir territorialisé est un vice dont la réalité est plus profonde que les institutions et les structures capitalistes et communistes ».
Marcus pense trouver dans Perroux la réalité de l’universel et pour convaincre le lecteur de ce qu’est cette réalité il dit d’un passage tiré de Perroux « Voici une « bonne traduction » de la forme réifiée d’universaux en une forme vraiment concrète et pourtant elle reconnait la réalité de l’universel puisqu’elle l’appelle par son vrai nom » (Marcuse, op.cit., p.231). Ce passage est le suivant :
« On croit mourir pour la Classe, on meurt pour les gens du Parti. On croit mourir pour la Patrie, on meurt pour les Industriels. On croit mourir pour la Liberté des personnes, on meurt pour la Liberté des dividendes. On croit mourir pour le Prolétariat, on meurt pour la Bureaucratie. On croit mourir sur l’ordre d’un Etat, on meurt pour l’Argent qui le tient. On croit mourir pour une nation, on meurt pour les banquiers qui la bâillonnent. On croit – mais pourquoi croirait-on dans une ombre si épaisse ? Croire, mourir ?...quand il s’agit d’apprendre à vivre ? » (Perroux, op.cit., p. 631).
Marcuse nous invite comme Perroux à apprendre à vivre alors que l’histoire de la société existante est régressive, une négation du principe de vivre ; il y ajoute que « l’histoire est une négation de la nature » car sauf dans « de petits espaces protégés, elle [la civilisation] a traité la nature comme elle a traité l’homme – comme l’instrument d’une productivité destructrice » (Marcuse, op.cit., p. 264).
Il trace le chemin théorique d’une réforme nécessaire de la Raison, elle doit pour lui devenir « une rationalité post-technologique, dans laquelle la technique est elle-même un instrument de pacification, bref, l’organon de « l’art de vivre ». Alors convergent la fonction de la Raison et la fonction de l’Art[4]. » (Marcuse, op.cit., p. 262).
Ceci nous rappelle le projet de société conviviale qu’Illich a proposé un peu plus tard (1973), ensuite repris et explicité par le convivialisme (2010). Marcuse se penche sur les conditions de son avènement qui ne saurait se faire sans que les intellectuels accomplissent leur tâche indispensable. Il résume en peu de pages son argumentation dans la préface originale qu’il a écrite en 1967 pour l’édition française de son ouvrage[5] :
« La productivité devient destruction, destruction que le système pratique « vers l’extérieur » à l’échelle de la planète. A la destruction démesurée […] de l’homme, de la nature, de l’habitat et de la nourriture, correspondent le gaspillage à profit des matières premières, des matériaux et forces de travail, l’empoisonnement également à profit, de l’atmosphère et de l’eau dans la métropole riche du capitalisme. (p. 7-8)
[…] la contradiction entre le caractère social des forces productives et leur organisation particulière, entre la richesse sociale et son organisation destructive, détermine cette société […mais] aucune contradiction sociale pourtant, même la plus forte n’explose « d’elle-même » […] la société existante parviendra à endiguer les forces révolutionnaires aussi longtemps qu’elle réussira à produire toujours plus « de beurre et des canons » et à berner la population à l’aide des nouvelles formes de contrôle total. (p. 11)
[…] La chance de l’avenir dépend de l’arrêt de l’expansion productive et profitable (politiquement, économiquement, militairement) (p. 12)
[…] L’expansion qui sauve le système, ou du moins le fortifie, ne peut être arrêtée que par un contre-mouvement international et global. Partout se manifeste l’interpénétration globale : la solidarité reste le facteur décisif [. Elle] a été brisée par la production intégrante du capitalisme et par la toute-puissance de sa machine de propagande, de publicité et d’administration. Réveiller et organiser la solidarité en tant que besoin biologique de se tenir ensemble contre la brutalité et l’exploitation inhumaines, telle est la tâche. Elle commence par l’éducation de la conscience, du savoir, du regard et du sentiment qui saisissent ce qui advient : le crime contre l’humanité. La justification du travail intellectuel réside dans cette tâche, et aujourd’hui le travail intellectuel a besoin d’être justifié.» (p. 13, c’est moi qui souligne).
Telle est donc la tâche de l’intellectuel, essayer de montrer la terrible nature de ce qui advient, le crime contre l’humanité en train d’être perpétré, pour permettre une prise de conscience indispensable afin de rendre l’humanité malmenée cependant capable de réveiller et organiser la solidarité.
[1] Mon propos ici n’est pas de faire le tour des intellectuels qui partageaient au même moment, ou auparavant déjà, celui exprimé par Marcuse. Pas plus de faire l’éloge de François Perroux (1903- 1987), qui parmi d’autres a exercé une forte influence en France et au-delà, sur la pensée des intellectuels concernant l’évolution du monde dans l’après-guerre jusqu’à la fin des années 1970. Mais de rappeler que cette influence et l’importance de sa réflexion puisqu’elle a inspiré, entre autres, Marcuse et de nombreux intellectuels et surtout des économistes dans le monde. Perroux a inspiré Marcuse sur le diagnostic, mais divergeait sur ce que pourrait être le futur et surtout les préconisations. Voir par exemple, quand un moment la « révolte » de 1968 fit croire que le peuple allait se lever spontanément, leur dialogue publié : Herbert Marcuse et François Perroux (1969) François Perroux interroge Herbert Marcuse…qui répond, Paris, Aubier-Montaigne. Perroux, certainement appuyé sur son humanisme chrétien, espérait en un sursaut par l’émergence d’une société de participation et croyait par ses écrits pouvoir contribuer à une réforme du monde. Comme continuent à y croire certains, malgré plus d’un demi-siècle globalement marqué par la régression.
[2] Herbert Marcuse (1964) One-Dimensional Man – studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Boston, Beacon Press, édition française : Herbert Marcuse (1967) L’homme unidimensionnel, Paris, Gallimard, cite p. 58 : François Perroux (1958) La Coexistence pacifique, Presses universitaires, Paris, 1958, vol.III. p. 600.
[3] Perroux, Ibid., p. 633 cité par Marcuse, op.cit., p. 79.
[4] Il écrit par ailleurs (p. 9-10 de l’édition française) : « la transcendance politique de l’énergie érotique […ferait que] la forme sociale de cette transcendance serait la coopération et la solidarité dans l’établissement d’un monde naturel et social qui, en détruisant la domination et l’agression répressive, se mettrait sous le principe de la réalité de la paix ; avec lui seulement la vie peut devenir son propre but, c’est-à-dire devenir bonheur. Un tel principe de réalité libérerait aussi la base biologique des valeurs esthétiques, car la beauté, le repos, l’harmonie sont des besoins organiques de l’homme dont la répression et l’administration mutilent l’organisme et activent l’agression. Les valeurs esthétiques sont également, en tant que réceptacle de la sensibilité, négation déterminée des valeurs dominantes, négation de l’héroïsme, de la force provocante, de la brutalité, de la productivité accumulatrice du travail, de la violation commerciale de la nature. »
[5] Herbert Marcuse, février 1967, préface à l’édition française dont il a revu lui-même la traduction de son ouvrage publié trois ans plus tôt.