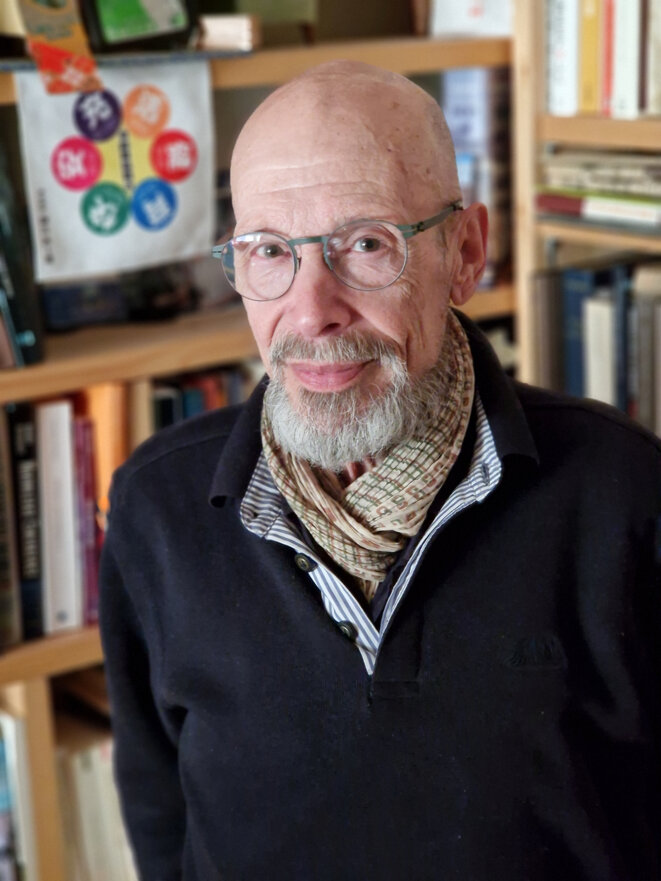L’humanité est en péril, la barbarie est à nos portes. Il n’a jamais été aussi urgent de se mobiliser pour conjurer les dangers qui pèsent sur notre humanité. Sa survie même, physique et morale est en péril. Cinq ensembles de menaces mortelles se développent qu’il faut clairement identifier. Pour les combattre et y échapper nous devons tisser un réseau collectif de promotion des principes qui pourront permettre de régénérer l’humanisme.
I- Cinq ensembles de menaces de barbarie pesant sur notre humanité
- Les menaces économiques et écologiques : la situation est dramatique car aucune transition écologique forte n’a été engagée malgré cinquante années d’avertissements. Ceci résulte d’une logique économique, fondée sur la compétition acharnée entre individus, entre firmes, entre Etats pour toujours plus. Logique écologiquement dangereuse et socialement inefficace car la malnutrition touche 40% de la population mondiale et que la pauvreté non disparue dans les pays riches s’y aggrave avec des inégalités accrues.
- Les menaces idéologiques : Une partie de l’humanité subit une idéologie dominante qui donne à l’individu plus d’importance qu’à la société et vise à l’émanciper de toute contrainte poussant à tous les identitarismes. Une autre partie est soumise à des croyances qui écrasent les individus et en font des pions soumis à une minorité autoritaire de type théocratique au sein de communautés étouffantes. Ces idéologies potentiellement totalitaires débouchent sur des types de barbarie à mille lieux de la poursuite du bien commun.
- Les menaces anthropologiques : l’humanité est menacée par des discriminations entre certaines catégories d’êtres humains. Elles sont apparues très tôt comme la xénophobie et le racisme, subsistant malgré la montée de l’humanisme. Après la sédentarisation, elles ont été amplifiées à l’égard des femmes par le patriarcat, le machisme, doublés d’une normalisation des orientations sexuelles et de genre. Récemment la menace anthropologique est venue de l’irruption et de l’extension du monde dit virtuel, des réseaux dits sociaux, un virtuel maintenant boosté par des réalités inconsistantes et invérifiables produites par l’intelligence artificielle, menaçant de nous faire basculer vers un post-humanisme.
- Les menaces sur la démocratie : l’humanisme a été porté par l’idéal démocratique de l’émancipation individuelle via des libertés civiles et politiques. Mais une démocratie en actes c’est plus qu’un État de droit avec séparation des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, plus que l’organisation d’un système multipartis avec des élections périodiques au suffrage universel. Elle bute sur plusieurs questions non résolues. Comment définir les contours d’un ensemble d’individus formant le peuple de référence ? Comment organiser le pouvoir collectif, par quel régime électoral à l’heure des médias internet et des réseaux sociaux ? Comment relier démocratie politique, démocratie économique et sociale et vie quotidienne de la société civile ? Faute de réponses et de pratiques satisfaisantes, montent l’acceptation, le soutien, voire l’aspiration des masses à des gouvernements forts, même autocratiques, parfois théocratiques qui promettent l’ordre, la sécurité et la bonne vie.
- Les menaces politiques et géopolitiques : la menace du chaos pèse au sein de toutes les sociétés, plus ou moins démocratiques et sur les relations qu’elles nouent entre elles pour coexister sur la planète. Le tissu social s’est distendu, dans les pays occidentaux plus qu’ailleurs. L’évolution des mœurs s’y est accompagnée d’un déclin de l’éthique collective, de l’intérêt général et de l’éthique individuelle, favorisant l’extension de la délinquance et de la corruption. La communauté politique recule devant la montée des communautarismes et des pulsions identitaires. Entre les États-Nations la situation est tout aussi terrible car l’ONU fondée en 1945 n’a pas réussi à établir une communauté internationale de pleine coexistence pacifique. La course à la plus grande puissance s’est déplacée sur le terrain économique et technologique. La promesse de développement par l’aide publique internationale et le libre marché international n’a pas été tenue. En revanche des stratégies nationales périphériques ont contesté les anciennes hiérarchies. L’heure est au dépassement de la domination exercée par l’Occident. Dans ce chaos potentiel, les Etats-nations sont à la fois dépassés et encore indépassables. Les conflits économiques s’intensifient, les conflits armés se sont étendus, le réarmement est général. La perspective d’une guerre mondiale a refait surface.
II- Six principes pour régénérer l’humanisme
Pour contrer ces menaces il faudrait régénérer notre humanisme en mettant en œuvre six principes fondamentaux. Les trois premiers reconnaissent une réalité établie scientifiquement et qui ne l’était pas à la Renaissance, ni même lors des Lumières et de la mise en œuvre de la philosophie libérale, lorsque naquit la Modernité. Les trois suivants sont de l’ordre de l’adoption délibérée d’une organisation politique légitime.
(i) Commune naturalité : Les êtres humains font partie de la nature et doivent prendre soin de ce qui est leur indispensable milieu de vie.
(ii) Commune humanité : Tous les êtres humains, par-delà toutes leurs différences, partagent une dignité égale.
(iii) Commune socialité : Leurs relations sociales sont la source première de la vie et du bonheur des êtres humains.
(iv) Légitime individuation : Chaque individu doit pouvoir développer sa singularité tout en respectant celle des autres et le milieu de vie commune.
(v) Légitime opposition : Les conflits sont légitimes s’ils restent constructifs et ne menacent pas les principes de commune naturalité, humanité, socialité et de légitime individuation.
(vi) Légitime limitation : La modération est un impératif catégorique pour limiter les excès de pouvoir, de richesse et de domination qui sont les moteurs poussant vers la barbarie.
Ces principes pour régénérer notre humanisme peuvent être formulés de différentes manières qui en gardent l’esprit[1] par exemple en soutenant qu’il y a lieu de reconnaître certaines réalités, que tout humaniste ressent intuitivement, et d’adopter des modes de comportements individuels et collectifs, soucieux de justice et empreints d’empathie :
1) Reconnaître notre essence commune à toute parcelle d’un univers partagé.
2) Reconnaître une spécificité commune à tous les êtres humains.
3) Reconnaître notre socialité vécue en communautés politiques solidaires.
4) Adopter un droit à l’émancipation individuelle et collective.
5) Adopter un modèle de délibération collective pour cibler le bien commun.
6) Adopter un principe de modération et d’encouragement à la coopération.
[1] Par exemple Utopia, les Convivialistes, l’Archipel de l’écologie et des solidarités et l’Archipel des confluences ont inclus ces principes dans leur manifeste ou leur charte dans des formulations différentes.