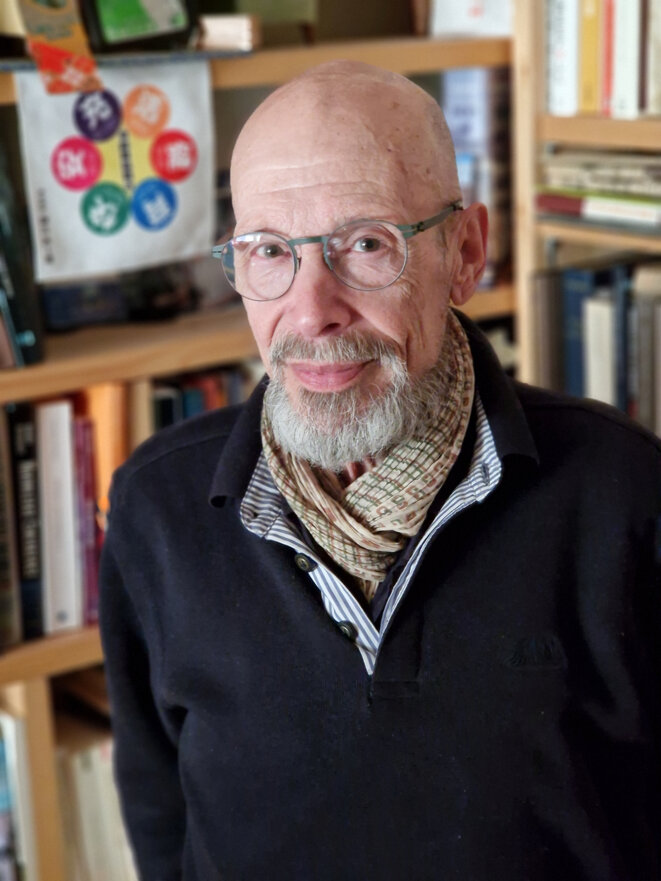J’ai montré précédemment comment l’épopée arabo-islamique née au 7ème siècle était de ce type, qu’elle s’était arrêtée mais que son prosélytisme restait sous-jacent et nourrissait encore des États et des mouvements. Je voudrais montrer maintenant ce qu’il est advenu de l’impérialisme politique et culturel occidental qui a bousculé l’humanité du 16ème au 20ème siècle. Son emprise politique directe sur la planète s’est relâchée fortement avec les indépendances qui se sont multipliées mais la modernité occidentale en revanche a été largement souhaitée, revendiquée même, après ces indépendances. Surtout dans sa dimension techno-économique. Mais les interventions des nations occidentales, bien au-delà de leurs frontières, demeurent, car leur intention d’imposer à toute la planète leur manière libérale de vivre dans le monde persiste, considérant qu’il s’agit là de respecter des valeurs qui sont pour elles universelles.
Les fondements de l’autojustification depuis le 16ème siècle
L’autojustification de l’intervention occidentale sur toute la planète, au-delà des mers, est restée fondée sur le même raisonnement de Sepúlveda à Kouchner, du renversement de l’Inca à celui de Saddam Hussein, en passant tant par Ferry et sa défense laïque de la colonisation que par Lord Curzon et l’invocation du Tout-puissant. Ces interventions militaro-politiques loin de leur pays par les puissances dominantes sont prétendument menées pour le bien des populations concernées qui sont considérées si ce n’est comme barbares, comme des races inférieures. Elles sont maltraitées de fait sans ménagement au nom d’une mission civilisatrice et de valeurs universelles dites enracinées dans le droit naturel[1].
Je donne quelques précisions. L’Espagne a suivi « la doctrine de Sepúlveda[2] » qui tient la violence pour légitime « parce qu’elle s’exerce contre des peuples barbares et qu’il y a un devoir moral à les évangéliser ». Doctrine adoptée malgré l’opposition de Las Casas et son combat pour venir en aide aux autochtones. C’est sur cette doctrine Sepúlveda, appuyée par les autorités religieuses que vont continuer les exactions tant portugaises qu’espagnoles en Amérique. Doublées de l’impact des maladies importées, elles ont décimé les populations locales et ont fait endurer aux survivants des vies misérables ; leurs souffrances ont continué après que les colons ont obtenu d’exercer cette domination pour eux-mêmes en prenant leur indépendance, zone par zone, vis-à-vis des couronnes européennes au début des années 1800.
C’est le même type de justification qui a maintenu l’esclavage dans les colonies de la France révolutionnaire jusque 1848. La troisième République, fondatrice de notre esprit républicain universaliste a poursuivi les colonisations avec le même argument, exprimé par exemple par la voix de Jules Ferry. Dans un discours du 28 Juillet 1885 au parlement, il affirme que c’est là une mission de civilisation des races inférieures. La France, socialistes inclus, le suit, malgré la protestation d’un Georges Clémenceau qui, dans une réponse le 30 juillet, s’oppose à cette qualification et dénonce la colonisation comme un « abus de la force que donne la civilisation scientifique pour s’approprier l’homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur ». Au Royaume-Uni du Bill of Rights, on entend le même argument, dans une version non laïque. Ainsi, Lord Curzon, dans un discours de 1905, explique en quoi « consiste la justification de la présence de l’Anglais en Inde » : apporter, grâce au Tout-Puissant, un peu de justice et de bonheur, une aube de lumière pour les intellects…là où rien de tout cela n’existait auparavant[3]. La communauté internationale conduite par les occidentaux approuve et, en 1919, le pacte de la SDN affirme dans son article 22 : il existe « des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation ».
Les arguments après la création de l’ONU en 1945
La Charte de l’ONU de 1945 n’a pas réussi à faire respecter « le droit moral des peuples opprimés à refuser la supervision paternaliste de « civilisés » auto-proclamés[4] ». La France par exemple a poursuivi après 1945 une guerre coloniale au Vietnam, puis en Algérie. Il faudra attendre la déclaration de l’ONU de 1960 pour que la communauté internationale énonce plus fortement ce droit. La France du général de Gaulle y souscrit enfin et avance vers la décolonisation, le Général président ne manquant pas pour autant de proclamer en 1960[5] : « L'œuvre colonisatrice qui a été accomplie par l'Occident européen, et en particulier par la France fut belle, fut grande, et fut féconde ».
Avec l’indépendance des anciens peuples colonisés sur toute la planète, la mise en place d’une organisation des nations-unies chargée de maintenir la paix mondiale, il était attendu qu’aucun État ne franchisse militairement ses frontières pour aller imposer sa loi chez un autre. La souveraineté de chaque État le laissait maître de ses affaires intérieures comme l’indique l’article 2 § 7 de la charte des nations unies : « Aucune disposition de la présente charte n’autorise les Nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ».
Cela n’a pas empêché la survenue de conflits classiques, liés à des volontés d’expansion territoriale, de différends frontaliers, fondés sur des allégations historiques ou des querelles ethniques ou/et nationalistes, conflits qui ont parfois donné lieu à ce que l’ONU envoie des forces d’interposition et essaie de mettre les belligérants à la table des négociations. Je ne cherche pas à rendre compte de ces conflits, de ces guerres entre États indépendants. J’en cite quelques-uns. En Asie, la guerre indo-pakistanaise, la guerre sino-vietnamienne, Laos-Thaïlande, Cambodge-Vietnam. Au Proche et Moyen Orient, la guerre Israélo-arabe, la guerre du Liban, les guerres Iran-Irak, Irak-Koweit, les guerres Libye-Égypte-Tchad, la guerre du Yémen. En Afrique, la guerre Éthiopie -Érythrée, la guerre du Biafra, les guerres du Soudan-Darfour, la guerre du Kivu, la guerre du Tigré. En Europe la guerre Chypre-Grèce-Turquie, les guerres Serbie-Slovénie-Croatie-Bosnie-Kosovo (et intervention de l’OTAN pour « stopper » le conflit).
Je ne mentionne pas les interventions pour soutenir la lutte anticapitaliste qu’ont menée à l’occasion Cuba en soutien aux mouvements d’indépendance comme en Angola et l’URSS en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Afghanistan. Puis pour assurer l’indépendance Russe supposée menacée par la tentation occidentale européenne et atlantiste, antirusse, en Géorgie, en Tchétchénie, en Ossétie Nord et Sud, en Crimée, et en 2022, l’invasion en Ukraine sous le faux prétexte de sa dénazification.
Toutes les interventions, conflits et guerres que je viens de signaler ont eu lieu en dépit, malgré l’effort de gouvernance mondiale exercé par l’ONU. Mais il y a eu encore d’autres interventions, organisées par les Occidentaux et qui voulaient les réaliser au nom de l’ONU et des valeurs universelles promues par l’Occident. Des interventions pour mettre fin à des faits avérés considérés comme inadmissibles. Le fait que des populations, en raison de circonstances diverses mais dont sont parfois responsables leurs dirigeants, subissent des situations dramatiques sans recevoir le moindre secours. Cela a conduit, dans les États occidentaux, à la naissance d’ONG dites « humanitaires ».
Ces organisations s’efforcent non seulement de dénoncer mais aussi de venir en aide aux victimes sans s’immiscer dans les affaires intérieures des États concernés. C’était le cas par exemple de Médecins sans frontières co-créée en 1971 par Bernard Kouchner[6]. Devant ce qui à lui-même et à d’autres[7] paraissait une montée du non-respect des droits de l’Homme dans de nombreux pays, il a cherché à ce qu’on aille au-delà de ce qu’on appelait déjà « devoir d’ingérence ». Il a poussé la communauté des États à se doter d’un « droit d’ingérence » pour intervenir dans les affaires intérieures d’autres États afin de faire respecter les droits de l’homme et défendre les victimes. Les Occidentaux ont obtenu en 2001 la reconnaissance du concept de « responsabilité de protéger[8] » ses populations qui incombe à chaque État et pour lequel tout État peut demander une aide ; si, malgré cette aide ou faute d’y recourir, il laisse cependant ses populations sans protection, la communauté internationale est autorisée à intervenir pour les protéger.
Avant même l’issue de ce débat juridique, des interventions supposées humanitaires dans les affaires d’autres États ont été nombreuses et militaires, elles ont toujours été le fait d’un État fort chez un plus faible. Les États-Unis détiennent le record du nombre et de l’intensité de ces interventions, seuls sous couvert ou non de l’ONU, de l’OTAN ou d’une alliance ad hoc, parfois pour soutenir des dictatures[9], certes plus souvent, officiellement, pour soutenir la démocratie et les droits de l’homme. Le bilan en ce qui concerne les interventions les plus massives comme au Vietnam, en Irak ou en Afghanistan ne semble pas positif. Face à l’Arabie Saoudite ou la Chine, où manifestement les droits de l’homme au sens occidental ne sont pas respectés, les États Occidentaux font profil bas et respectent en quelque sorte la souveraineté de ces États avec lesquels ils entretiennent des relations commerciales qu’ils s’efforcent de rendre profitables. En revanche, ou symétriquement, l’examen des cas d’interventions laissent suggérer que les considérations d’intérêt économique ou de création de zones d’influence dans la géopolitique mondiale, ont peut-être été plus déterminantes que les objectifs humanitaires des droits de l’homme et de soutien à la démocratie.
Toujours est-il que l’emprise occidentale sur la planète tend à éliminer toute contestation de son modèle libéral ce à quoi elle semble parvenir au moins dans sa dimension économique qu’elle parait en définitive privilégier sur les considérations humanitaires.
[1] Ibidem. Immanuel Wallerstein (2006) L’universalisme européen – De la colonisation au droit d’ingérence, Paris, Demopolis, p.9. Ce livre est la traduction de Immanuel Wallerstein (2006) European universalism : The rhetoric of power, New York, The New Press.
[2] Wallerstein op. cit. , p. 30.
[3] Je m’appuie sur Wallerstein, op. cit. p. 23 qui écrit tirer ces éléments de Michael Mann, p. 25 dans Harald Fischer-Tiné et Michael Mann (2004) Colonialism as Civilizing Mission : Cultural Ideology in British India, Londre, Wimbledon.
[4] Wallerstein, op.cit., p. 30.
[5] Conférence de Presse du 5 septembre 1960 voir https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00061/conference-de-presse-du-5-septembre-1960.html
[6] A la suite de deux expériences différentes, un comportement d’État contre une de ses provinces et une catastrophe naturelle. (i) celle du secours à porter dans des conditions dramatiques aux Biafrais assiégés par le Nigeria dont ils voulaient devenir indépendants au cours donc d’une guerre civile (1967-1970) et (ii) celle d’une aide humanitaire après le cyclone de Boha qui fit 600 000 victimes en 1969 dans ce qui est aujourd’hui le Bangladesh.
[7] Comme Amnesty international fondée en 1961.
[8] A la suite des travaux d’une Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE) à l’initiative du Canada en 2000 et dont est sorti un rapport sur la Responsabilité de protéger, (responsibility to protect,"R2P") précisant sa définition dans les § 138 à 140 qu’elle incombe à tout État, qu’il doit être aidé à la remplir, et que sinon, la communauté internationale peut intervenir. Ce concept a servi pour la première fois en 2011 pour une intervention militaire en Libye puis en Côte d’Ivoire.
[9] Souvent indirectement via des forces spéciales et l’armement de diverses manières de forces locales par la CIA, comme au Guatemala en 1953, au Brésil en 1964, au Chili en 1973.