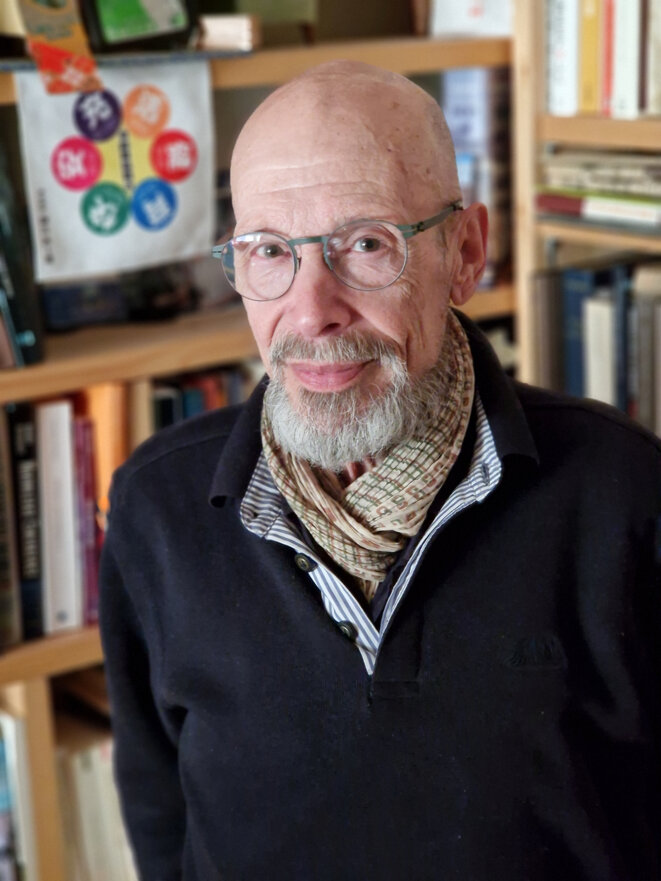L’idéal libéral forgé par la révolution française et qui sera qualifié d’idéal républicain, mérite d’être choisi comme cas exemplaire d’application de l’idéal des Lumières. De fait la Révolution française a joué un rôle planétaire pour la diffusion de cet idéal d’émancipation. Un idéal libéral, un idéal de Liberté. La révolution française prétend combiner cette liberté avec deux autres éléments qui forment ensemble une trilogie « Liberté – Égalité – Fraternité » de valeurs républicaines universellement connues. La Liberté faite France s’appuie aussi sur la popularisation mondiale du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, symbole de la chute du pouvoir royal discrétionnaire. Cette date est devenue, bien plus tard, en 1880, fête nationale, quand la troisième République a adopté définitivement la célèbre devise, alors un peu oubliée, et l’a fait inscrire aux frontons de tous les édifices publics. L’attachement à ces valeurs exprimé pour la première fois par Robespierre en 1790, avait été proclamé comme étendard de la République, sur les façades de nombreux bâtiments dans toute la France et en particulier de l’Hôtel de Ville de Paris en 1793 dans une formulation plus large « Unité, indivisibilité de la République – Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort ».
Deux remarques sont à faire à propos de cette trilogie remarquable considérée comme caractérisant les valeurs républicaines. En premier le fait peu connu qu’elle soit reprise dans le préambule de la constitution de l’Inde indépendante de 1949. Il y est en effet énoncé, la volonté d’assurer au peuple indien : « Justice, Liberté, Égalité, Fraternité ». Il est clair que les rédacteurs de ce préambule à la constitution d’une « République démocratique laïque socialiste et souveraine » ont emprunté cette trilogie à la République française. Il est tout aussi clair que l’ajout de la valeur de Justice tient au moins en partie à ce que la Révolution française paraissait en défaut sur ce point comme l’avait mis en scène l’œuvre mondialement connue, Les misérables de Victor Hugo. Il faut surtout retenir de cette reprise, que ces valeurs peuvent aussi bien convenir à un peuple d’Orient, un peuple du Sud, ex colonie Britannique, composite et multiculturel, qu’à un peuple occidental, colonisateur, un peuple qui se dit indivisible. Bref ces valeurs sont porteuses d’un idéal universel, l’idéal humain d’émancipation juste. Ensemble elles caractérisent ce qui est souvent dénommé l’humanisme républicain.
En deuxième remarque, il faut rappeler que si « Liberté, Égalité » formait un couple occupant une place centrale dans la pensée des Lumières dès le 17ème siècle – chez Locke par exemple-, le troisième terme, « Fraternité », ne s’est imposé qu’ultérieurement. Cela s’est fait en France révolutionnaire, en raison de la montée du sentiment national ou patriotique dont j’ai retracé plus haut le parcours universel ou presque. C’est-à-dire de manière pragmatique. La France révolutionnaire est désormais formée d’individus qui ne sont plus reliés comme sujets d’un même roi ; ce sont des citoyens libres et égaux qui doivent se trouver une raison de se constituer en un ensemble délimité. La France, avec ses frontières, préexiste à la Révolution, mais c’est le pays du Roi. Elle s’est constituée au sein d’une Europe qui reste celle des têtes couronnées, toutes plus ou moins alliées par le sang : l’empereur d’Autriche est le frère de la Reine Marie-Antoinette et se dit, soutenu par le roi de Prusse et les nobles français émigrés en Europe, préoccupé du sort de son beau-frère. Voilà un ennemi commun à des citoyens révolutionnaires qui s’en trouvent unis. Ils vont jusqu’à lancer la guerre contre l’Autriche, en avril 1792, avec l’aval du Roi qui espère leur défaite. Mais après quelques échecs, voilà que la défense nécessaire de la révolution renforce la mobilisation et le sentiment collectif qui se trouve encore plus vif avec la victoire remportée en septembre à Valmy.
Ce n’est pas une armée de sujets qui ont défendu un Roi, mais une armée de citoyens qui ont défendu leur Patrie qui devient, au lendemain de la victoire, une République. C’est parce que nous sommes libres et égaux que nous pouvons nous constituer en Nation, en Patrie, argumentent alors les penseurs révolutionnaires. Et, en conséquence d’avoir cette patrie en commun, nous sommes tous frères, ce qui amène à confirmer la « Fraternité » comme valeur de la République française. Valeur dont l’universalité est reconnue par les penseurs de la révolution, qui, je l’ai rappelé plus haut, posent (en 1793) la question de l’étendue territoriale de la République à constituer, c’est-à-dire envisagent l’éventualité d’une République universelle. Dans le même esprit, Robespierre affirme alors : « les hommes de tous les pays sont frères. » Règne bien sur la Révolution française l’esprit des valeurs dites républicaines, de Liberté, d’Égalité et de Fraternité humaine universelle.
Et bien sûr une pratique de République nationale, centralisée, portée par une démocratie représentative d’élus au suffrage universel. Mais des péripéties n’amèneront vers une stabilisation Républicaine qu’après 1848 (et encore, avec l’intermède du second Empire) quand les citoyens éliront désormais leurs parlementaires au suffrage universel – masculin- et même, en 1848, un président de la République. Le fondement du libéralisme Républicain français est ainsi en place. Il fait référence aux Lumières par la voix de Lamartine, qui soutient alors qu’il s’agit là de l’idéal libéral, mis en pratique et appuyé sur la Raison : « ces sentiments de fraternité, de liberté d’égalité […] sont l’évangile de la Raison humaine[i] ». Mais les sentiments ne sont pas des institutions et l’ensemble des citoyens ne ressentent, semble-t-il pas spontanément, un sentiment de fraternité les uns envers les autres. Les révolutionnaires n’ont pas manqué de souligner qu’on ne pouvait pas considérer tout un chacun comme frères et que les anciens privilégiés émigrés, qui plus est venant avec des alliés étrangers tenter de nous envahir, étaient bien des ennemis. En outre la Fraternité, le sentiment de fraternité ne suffit pas à assurer la cohésion de l’ensemble des citoyens et assurer l’ordre.
La radicalité de la période révolutionnaire en France va cependant buter sur la réalité anthropologique qui rend nécessaire d’adosser l’ordre politique à un ordre cosmique ou religieux. Certains révolutionnaires en ont été conscients et ont pris appui sur un Dieu neutre, dénommé Être suprême dans le préambule de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. On y lit en effet que les droits de l’homme et du citoyen sont reconnus et déclarés par l’Assemblée nationale, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême. Les Lumières, en remettant en cause le pouvoir de la religion, incitaient à abandonner ce type de référence et nombre de révolutionnaires, athées, y étaient hostiles. Ils ont de fait tenté d’éradiquer toute religion et de remplacer le culte de l’Être suprême par le culte de la Raison (septembre 1793).
Mais ils ont été contrés par l’un des plus radicaux parmi les révolutionnaires, Robespierre, qui a repoussé ce refus de toute religion au profit de la Raison. Il a proposé en 1794 au nom du Comité de Salut Public, pour sauver la révolution, d’instituer le culte de l’Être suprême garant de la déclaration des droits, et un calendrier de fêtes républicaines remplaçant les fêtes catholiques[ii]. Il a pu organiser une première grande fête (le 7 juin) qui connut un grand succès dans tout le pays. Robespierre affirmait que chaque fête prévue (dont une le 14 juillet) était « sociale et républicaine » constituant « un rappel continuel à la justice ». Il donnait par là un fondement transcendantal ou métaphysique au gouvernement, un support cultuel à l’organisation de la société. Mais ce culte sera sans lendemain, car Robespierre a été condamné et exécuté en juillet 1794. La Grande Terreur s’installe alors, puis le Directoire et la France sera finalement rechristianisée officiellement avec le concordat signé avec le Pape par le premier consul Bonaparte en 1801. La Révolution populaire est alors terminée.
Il faudra attendre la fin du 19ème siècle pour que le républicanisme que nous célébrons aujourd’hui encore puisse s’installer. Mais d’ores et déjà la Liberté s’est faite France même si ce symbole ne s’est mondialisé qu’avec le célèbre tableau de Delacroix de 1830. Un tableau qui montre, sous les traits d’une Marianne en bonnet phrygien, une France qui brandit le tableau tricolore et guide les peuples du monde vers la liberté et la démocratie. Mais la Liberté seule ne suffit pas et dès le moment de la révolution française, se sont levées des voix et des mouvements pour mettre au même rang l’Égalité. Leur vision d’une société idéale a été qualifié d’anarchiste. C’est la deuxième vision idéale que je vais présenter à suivre.
[i] Le Moniteur universel, 12 mars 1848, p. 597.
[ii] Le décret de la convention montagnarde adoptant cette proposition est du 7 mai 1794. Robespierre a prononcé ce jour-là un discours inspiré de Rousseau dont sont reprises les citations qui suivent.