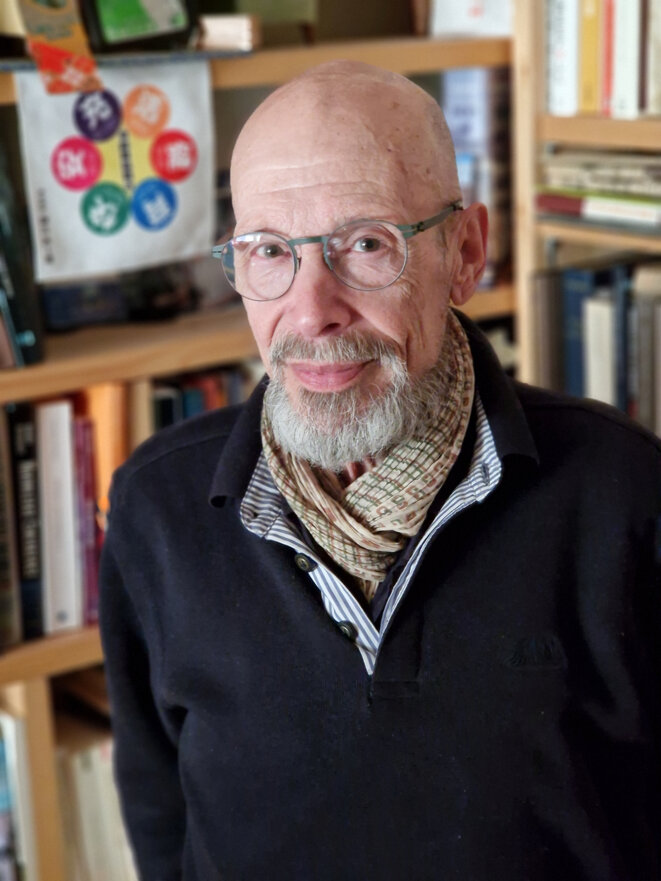La résistance incompressible des derniers peuples autochtones
L’impérialisme occidental européen, nourri de la vision libérale, a rencontré des résistances armées bien sûr, des révoltes, puis des mouvements de libération nationale qui ont obtenu des indépendances après de longs et durs combats. Mon propos ici n’est pas de documenter de manière très large toutes ces résistances[1], mais d’en souligner quelques-unes, emblématiques en particulier par leur refus de quitter leur manière de vivre, leur refus d’adopter le modèle libéral. Celles de peuples encore intouchés, restés depuis des milliers voire des dizaines de milliers d’années isolés du monde moderne, celles de peuples qui ont résisté pied à pied et qui ont su maintenir une certaine autonomie, celles de peuples dont les représentants sont très peu nombreux, dont l’acculturation moderne est avancée mais qui continuent à essayer de revendiquer le maintien de ce qui constitue leur identité fondamentale. Et qu’une partie de la communauté internationale s’efforce de leur accorder.
On sait qu’il y a aujourd’hui encore des groupes humains qui vivent en retrait de notre monde moderne. De ceux dont on connait l’existence, le plus grand nombre se trouve en Amazonie Brésilienne où il y aurait 114 groupes de ce type. Il est possible qu’un certain nombre soit des descendants de groupes ayant échappé il y a bien longtemps à des massacres ce qui explique leur attitude d’hostilité envers ceux qui veulent les approcher. L’ONG survival[2] s’efforce de suivre leur recensement et de s’assurer que ces populations restent protégées[3]. Il y a d’autres groupes en Amérique Latine, semble-t-il, également en Papouasie Nouvelle Guinée.
Le plus connu de ces groupes non contactés est constitué d’une population venue d’Afrique il y a 60 000 ans, peut-être restée sans hybridation. Dénommée Les Sentinelles, formé d’un groupe estimé à une cinquantaine de personnes, apparemment en bonne santé et vivant isolé sur l’île North Sentinelle, une des îles Andaman au large de l’Inde. Peut-être sont-ils des survivants d’un ensemble plus large appelé les grands Andamanais qui étaient plus de 5000 à l’arrivée des Britanniques et qui ont presque disparu aujourd’hui. Cela pourrait expliquer leur hostilité totale à toute tentative d’approche. Après le Tsunami de 2004, le gouvernement indien a fait survoler leur îlot (47km2) pour voir s’ils avaient échappé au désastre ; l’hélicoptère a essuyé une volée de flèches montrant que ces populations, averties à leur manière du danger, s’étaient mises à l’abri et avaient survécu. Depuis 1996, après quelques tentatives de leur apporter des cadeaux[4], les autorités indiennes avaient renoncé à tout contact et interdit à quiconque de venir à moins de 5 km de l’île. Ainsi la volonté de ce peuple de vivre à sa manière se trouve respectée.
Il y a aussi d’autres peuples qui sont parvenus au moins partiellement à se maintenir à l’écart de l’évolution propagée– de manière forcée pour une grande proportion de la population mondiale- par les Occidentaux. Il y a également, on l’a vu, quelques rares États, des sociétés organisées, qui ont réussi à maintenir leur indépendance politique face à la pression occidentale, par exemple l’Éthiopie, l’Iran, le Japon. Tout en procédant à certaines transformations influencées par la modernité occidentale. Il y a encore, au moins un exemple de résistance, d’une société non étatique et dont l’histoire s’étend sur une très longue période qui commence avant les conquêtes hispano-portugaises. Son histoire exceptionnelle se poursuit, même si depuis la fin du 19ème siècle ; il lui a fallu accepter une perte d’autonomie importante. Il s’agit des Mapuche du Chili.
Les Mapuche, peuple sans État centralisé, étaient installés tout le long de la cordillère des Andes côté de l’actuel Chili. Là de très nombreuses chefferies parlaient à peu près la même langue, pratiquaient les mêmes coutumes, les mêmes rythmes et processus sociaux et politiques. Ils formaient une même société, assez vaste, pratiquant l’agriculture, mais sans État. L’empire Inca, organisé comme un État centralisé a voulu s’étendre et à partir de 1450 s’est efforcé de soumettre le peuple Mapuche. Celui-ci a résisté à l’envahisseur et à toute idée d’État centralisé. Les Mapuche ont dû cependant reculer jusqu’au Rio Maule. L’arrivée des Espagnols qui renversent l’empire Inca en 1532 les menace à nouveau et ils reculent cette fois jusqu’au sud du Rio Biobio. Ils maintiendront leur autonomie au Sud de cette frontière, de 1541 jusque 1881 quand l’État Chilien parvint à les soumettre. Aujourd’hui, ils ne sont guère plus que quelques centaines de milliers mais sont organisés et s’efforcent de sauvegarder leur histoire et leur identité[5].
Pour cela, les Mapuche ont le soutien de la communauté internationale officielle qui, au travers de l’Organisation internationale du Travail, a adopté en 1989 la convention 169 qui reconnait l'existence et la spécificité des peuples autochtones[6], s'assure qu'ils bénéficient sur un pied d'égalité des mêmes droits et possibilités que les autres membres de la population nationale de l’État où ils se trouvent. Le Chili a signé cette convention en 2008. L’Allemagne en 2021. Au total seulement 23 pays l’ont ratifiée, la France invitée formellement à le faire par l’ONU en 2010 a réaffirmé son hostilité ; en raison du principe d’unicité et d’indivisibilité de la République, il n’y a qu’un seul peuple français. Elle a invoqué une impossibilité « constitutionnelle » à reconnaître toute multiculturalité, cependant elle affirme assurer le respect des droits de l’homme à toutes et à tous sur son territoire. La communauté internationale cherche à faire ratifier cette convention 169, pour soutenir environ 5000 communautés autochtones dans 90 pays, regroupant au total près de 500 millions de personnes. Bien que ce ne soit guère plus de 6% de la population mondiale, ce nombre représente néanmoins la moitié de ce qu’était la population de la planète en 1800.
Ces communautés demandent protection et non-discrimination bien sûr, mais elles sont aussi très attachées à un élément crucial qui concerne leurs territoires. En de nombreux lieux, comme en Amérique du Nord, les autochtones avaient souvent accueilli cordialement les nouveaux arrivants quand ils paraissaient pacifiques. Mais quand ils eurent perçu que leur obsession était de posséder des terres, les autochtones, en beaucoup d’endroits, et autant qu’ils ont pu, sont devenus hostiles aux arrivants et même se sont transformés en farouches opposants.
Pour les autochtones la terre « est non morcelable parce qu’elle associe à leurs yeux toutes les formes de vie dont se sont nourris certains de leurs peuples depuis des siècles ». Alors qu’ils étaient disposés à faire une place aux nouveaux arrivants dans le « grand cercle de la vie » où pour eux communiquent et se combinent, toutes les formes végétales, animales et humaines, les Européens ont exhibé des titres de propriété délimitant des terres, en s’empressant « de les convaincre, par la persuasion, la force ou la terreur, de les vendre aux grandes compagnies [7]». On a bien là le cœur du libéralisme de Locke, de la propriété privée. On sait la suite, la confiscation des territoires indiens, les guerres et un véritable ethnocide. Aujourd’hui encore les peuples autochtones réclament de pouvoir rester dans ce qui reste de leurs territoires, alors qu’ils sont partout menacés par la déforestation et les exploitations minières. La convention 169 de l’OIT essaie de leur apporter une protection.
Les résistances historiques au sein des sociétés européennes bousculées
Je n’envisage pas de rendre compte ici des résistances éclairées par des philosophies critiques du libéralisme des lumières – on y viendra par la suite. Pas plus de faire l’inventaire de tous les mouvements de quasi rébellion organisés contre le changement de modèle de société. Je vais seulement rappeler quelques exemples de résistances spontanées ou organisées de manière pragmatique au sein de quelques sociétés européennes bousculées par les débuts de l’épopée libérale.
La France, considérée souvent à l’étranger comme l’archétype d’un modèle républicain libéral, n’est devenue proche de ce modèle qu’avec la 3ème République, à la fin du 19ème siècle. Au moment de la Révolution française, la Chouannerie mène la résistance. Des Bretons d’abord qui veulent rétablir la monarchie, puis des ressortissants de tout l’Ouest prennent les armes, particulièrement en Vendée, poussés entre autres par la condamnation que prononce le Pape de la constitutionnalisation du clergé ; des résistances se produiront un peu partout pour soutenir des prêtres réfractaires. L’ordre politico-religieux résiste encore après l’épisode Napoléonien avec la restauration de Louis XVIII en 1815 et plus encore de Charles X en 1830. Celui-ci organise un régime bien peu libéral et rétablit des privilèges. Contrôle de la presse, indemnisation des émigrés ayant perdu leurs biens sous la Révolution, loi criminalisant le sacrilège et malgré la majorité libérale au parlement, nomination au gouvernement du prince de Polignac, très attaché à l'Ancien Régime. La révolution de 1848 amène à la prise de pouvoir « démocratique » de Louis Napoléon Bonaparte, d’abord élu président de la République puis se muant en Empereur plébiscité par le peuple, promouvant l’économie, les banques et les grandes entreprises. Sa chute en 1870, à l’occasion de sa défaite militaire face à l’Allemagne qui se réunit, est l’occasion d’une révolte populaire ouvrière dans quelques villes et surtout à Paris.
La commune de Paris entre mars et mai 1871 tente d’organiser une forme de démocratie directe, ne reconnaissant pas la légitimité de l’assemblée nationale qui vient d’être élue au suffrage universel masculin dans les territoires non occupés. Elle est apparue comme un mouvement d’insurrection ouvrier libertaire – ce que certes n’avait pas été la révolution de 1789 - et comme tel que Marx a d’abord encensé, puis critiqué, considérant que les communards s’étaient condamnés à l’échec faute de projet politique pour transformer et guider leur révolte. Toutefois l’historiographie ultérieure de la Révolution russe de 1917 et de nombreux mouvements ouvriers ont fait de ces 72 jours de résistance une référence historique de la lutte anticapitaliste, antilibérale, et s’en sont nourris comme d’un rêve ou d’une utopie, une promesse d’espérance.
Aucun autre pays n’a connu un évènement comparable. Mais ce n’est pas pour autant que même au Royaume-Uni où la monarchie est devenue pleinement parlementaire dès 1689 il n’y ait pas eu de résistances. Les privilégiés se sont efforcés de maintenir un système électoral très inégalitaire. En 1819, seulement 3% des Britanniques avaient le droit de vote et les autorités massacrent alors ceux qui protestent à Manchester contre cela. La classe dirigeante ne concède que peu à peu des extensions successives, la législation de 1867 ne donne encore le droit de vote qu’à 40% des hommes. Dans les années 1811-1812 de nombreuses manifestations d’artisans (tondeurs de drap, tisseurs sur coton et tricoteurs sur métiers) mis en péril par l’industrialisation s’attaquent aux fabriques et à leurs métiers : on l’appelle la révolte des luddites qui se sont manifestés jusque dans les années 1830.
Je voudrais ajouter deux exemples anglais caractéristiques de la vaine résistance du « vieux monde » face à l’émergence de la logique libérale. Tout d’abord une victoire des industriels sur les rentiers de la terre. Depuis le 12ème siècle des lois sur les céréales dites Corn Laws assurent aux propriétaires terriens de la noblesse de pouvoir cultiver et vendre leurs céréales à un prix numérateur, quel que soit le prix international. Le blocus continental lors des guerres Napoléoniennes et de mauvaises récoltes ont renforcé la fixation à un prix élevé. La bourgeoisie industrielle a bataillé, organisant même une ligue contre ces lois, appuyée sur le raisonnement de David Ricardo[8] en faveur du libre-échange unilatéral. Richard Cobden a réussi à convaincre le premier ministre Robert Peel et finalement ces lois furent supprimées en 1846. Il s’est agi de fait d’une victoire sur l’ancien monde des rentiers terriens par la bourgeoisie industrielle qui accroît ses profits puisqu’elle peut baisser les salaires au rythme de la baisse du prix des céréales permise par les importations. Cela sera efficace sous réserve qu’un autre obstacle soit levé pour que règne la loi du marché et qu’elle décide librement du revenu des travailleurs.
Ce sera fait grâce à un petit évènement au regard des grands moments de l’Histoire. Un évènement ponctuel qui a contribué à faire basculer le monde dans la logique libérale, le renversement du dernier obstacle mis à la marchandisation de la société. Son déroulé est retracé par Polanyi[9], je le résume en quelques lignes. En 1795, dans le village de Speenhamland, les magistrats locaux, dans l’esprit paternaliste légué par les Tudors et les Stuarts mettent en place un système de secours pour assurer, de fait, un revenu minimum aux pauvres « indépendamment de leurs gains ». Le barème adopté n’a jamais été voté comme loi, mais cependant tenu pour loi et appliqué dans la plupart des campagnes et même « dans un certain nombre de districts manufacturiers » […] du pays. « Cette innovation sociale et économique dont il était porteur, n’était rien moins que le « droit de vivre », et jusqu’à son abrogation, en 1834, il interdit efficacement la création d’un marché concurrentiel du travail ». Sa suppression mit fin « au règne du propriétaire terrien charitable » et fut « le point de départ du capitalisme moderne[10] ». La société pouvait désormais se muer en société de marché.
[1] J’ai montré également, plus haut, la résurgence de différentes formes de la religion musulmane qui promeut des manières de vivre bien différente de la manière occidentale.
[2] https://www.survivalinternational.org/
[3] Je tire ces informations d’un article de National Geographic écrit par Fiore Longo directrice du Bureau français de l’ONG survival https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/08/peuples-non-contactes-en-marge-du-monde
[4] Voir https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/anthropologie/sentinelles-le-peuple-qui-ne-voulait-pas-etre-contacte_129748.
[5] Voir https://www.mapuche-nation.org/
[6] Elle fait suite et étend largement la convention 107 de 1957 relative aux populations aborigènes et tribales qui avait été ratifiée par 27 États.
[7] Voir : Rémi Savard (1981) Le Sol Américain, Propriété privée ou Terre-mère ? Montréal, L’Hexagone. Et, Rémi Savard et Jean-René Proulx (1982) Canada. Derrière l'épopée, les autochtones. Montréal, l'Hexagone.
[8] David Ricardo a acheté un siège au parlement pour y siéger de 1819 à 1823 où il a soutenu la lutte contre les Corn Laws en s’appuyant sur son ouvrage David Ricardo (1817) The Principles of Political Economy and Taxation, London, John Murray.
[9] Karl Polanyi (1944) dans le chapitre 7 intitulé « Speenhamland, 1795 » Traduction française Paris, Gallimard, 1983- La grande transformation- Aux origines politiques et économiques de notre temps).
[10] Polanyi, traduction française, 1984, p. 114- 117.
984, p. 114- 117.