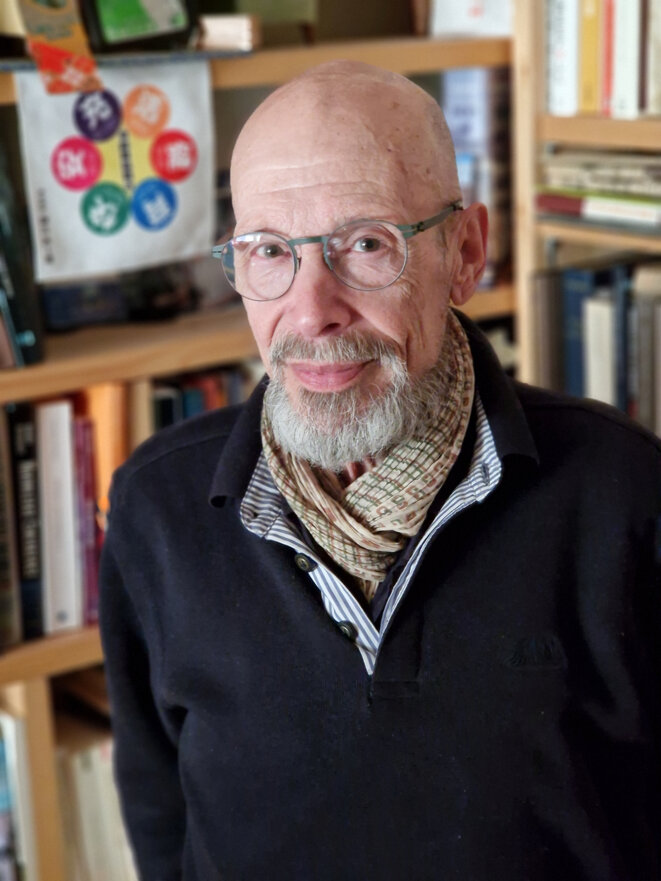L’idéal anarchiste égalitaire
Après la chute de Robespierre, la Grande Terreur poursuit une révolution radicale échevelée. Elle transformait en condamnations et exécutions les conflits incessants qui survenaient au sein des conventionnels élus quand ils discutaient de la meilleure manière de faire le bonheur de tous, de réaliser l’émancipation. S’installe alors un Directoire qui veut surtout gérer le pays.
Il reste cependant des révolutionnaires qui entendent assurer le bonheur de tous et qui sont guidés par des penseurs et des leaders qui continuent à chercher et à faire des propositions pour y parvenir. Babeuf est de ceux-là. Il lutte avec son journal contre les thermidoriens qui ont condamné Robespierre et contre la dictature du Directoire qui a dissout la Convention. Il est à certains égards dans la suite du Manifeste des Enragés de Jacques Roux[1] qui veut prendre en charge les revendications populaires. Il soutient la « révolution des Égaux » qui, entre autres, veut faire admettre les femmes dans les clubs. Il affirme en 1795 dans son journal : « Les gouvernants ne font des révolutions que pour gouverner. Nous en voulons enfin une pour assurer à jamais le bonheur du peuple, par la vraie démocratie. » Le groupe publie des pamphlets réclamant l’abolition de la propriété privée, de la monnaie.
L’idéal poursuivi est celui d’une Égalité totale qui ne saurait être contrainte par des institutions ; un autre précurseur de cet idéal, l’Anglais William Godwin, détaille (1793) les abus des institutions les plus consacrées, même celle du mariage. L’idéal est de faire échapper la société et les individus qui la composent, à l’emprise de l’État et des institutions en place qui cristallisent, dans une hiérarchie de pouvoirs dont ceux que confère la propriété privée, l’administration d’un ordre politico-religieux. La conjuration des Égaux sera combattue et éliminée par le Directoire et Babeuf sera arrêté, condamné et exécuté en 1797.
Dans aucun pays au monde, une société des Égaux, sans État, sans propriété privée, sans monnaie, ne verra le jour, mais l’idéal en sera discuté, explicité, aménagé, comme théorie de la société par des intellectuels et militants, en particulier en France avec Proudhon le premier à s’être qualifié d’anarchiste à partir de 1841. Et bien d’autres intellectuels comme Mikhaïl Bakounine ainsi que de nombreux mouvements libertaires dans le monde entier vont continuent d’essayer de propager des idées pour sortir de cette manière du libéralisme tel qu’il est pratiqué un peu partout.
L’idéal anarchiste nous montre que le couple « Égalité et Liberté » est contradictoire dans le discours libéral. Depuis Locke la propriété privée est considérée comme un droit qui garantit la liberté tandis que la liberté et le travail permettent au méritant de faire croître ce qu’il détient légalement comme propriété privée. Robespierre et les révolutionnaires ont garanti la propriété privée, comme un droit, ce qui est repris dans toutes les déclarations libérales des droits, jusqu’à la déclaration universelle de 1948. Cela lui parait juste, sous réserve que ce droit, comme la liberté, soit borné pour chacun par les droits d’autrui. Mais pas question d’entendre « égalité » au sens de « égalité économique ». Robespierre affirme[2] « l’égalité des biens est une chimère. Pour moi, je la crois moins nécessaire encore au bonheur privé qu’à la félicité publique. Il s’agit bien plus de rendre la pauvreté honorable que de proscrire l’opulence ».
C’est dire que le gouvernement par le peuple, la démocratie, c’est Égalité et Liberté pour le domaine politique : toutes les libertés d’expression et bien sûr, droit de vote, droit d’être élu, droit de faire les lois, égalité devant la loi, égale honorabilité quelle que soit la fortune. Mais la démocratie s’accommode des inégalités économiques, de l’opulence, c’est-à-dire d’une « Liberté » combinée avec une « Inégalité » dans le domaine de l’économie. Le bonheur et l’émancipation d’un individu n’ont rien à voir pour Robespierre avec sa situation économique. Mais pour les anarchistes tels que Bakounine l’a exprimé, la liberté n’est rien sans une égalité de fait, c’est-à-dire sans une égalité économique et sociale ; l’égalité réduite à l’égalité politique est une illusion d’égalité. Les tenants de cette position vont se retrouver souvent aux côtés des révolutionnaires comme le fut par exemple Kropotkine.
À côté de cet anarchisme égalitaire et libéral individualiste refusant le poids des institutions, vont se développer d’autres visions qui s’appuient sur une institution commune, de taille variable mais qui en fait une démarche où une part de la liberté individuelle est abandonnée à un collectif. Parmi ces visées idéales teintées en quelque sorte de collectivisme – ou de holisme[3]- s’est particulièrement distingué l’idéal communiste de Fraternité ; je vais examiner maintenant comment il s’est formé et développé.
[1] Dans son manifeste présenté en mai 1793 Jacques Roux affirmait « « La liberté n'est qu'un vain fantôme, quand une classe d'hommes peut affamer l'autre impunément ».
[2] Discours du 24 avril 1793 devant la Convention.
[3] Au sens sociologique “holisme » s’oppose à « individualisme » et signifie que le collectif impose une bonne part de leurs actions aux individus et n’est pas seulement le résultat des actions et interactions individuelles libres.