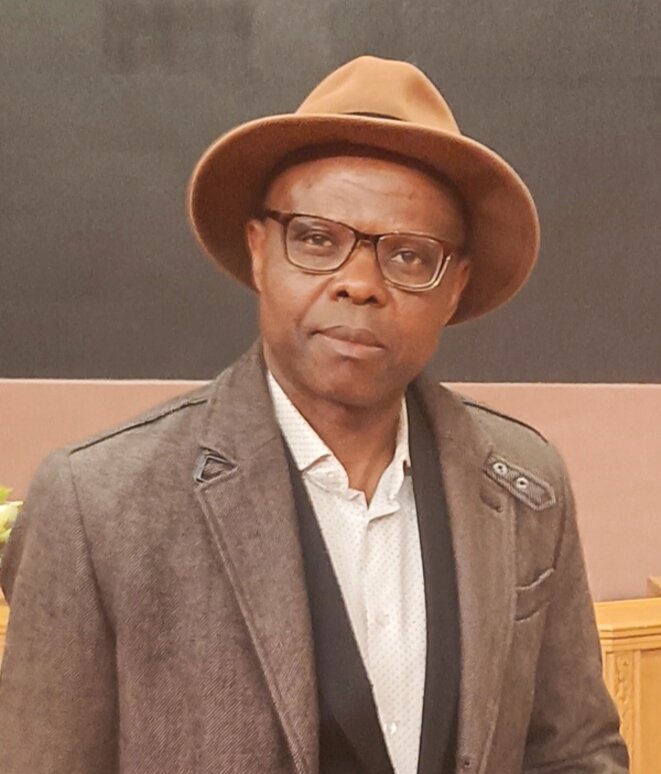La France hexagonale a été préservée des idéologies racialistes à l’origine des violences socio-politiques qui ont secoué l’Afrique du Sud ou les Etats-Unis tout au long du 20ème siècle. Dans ces deux pays, l’organisation sociale reposait sur une hiérarchie ethno-raciale maintenue par ce que beaucoup d’historiens ont assimilé au terrorisme d’Etat. Le non-Blanc était conditionné à la soumission. On l’éduquait à un statut inférieur en instillant dans sa psyché la peur pathologique du Blanc. Le grand écrivain noir américain Richard Wright, mort en exil à Paris en 1960, fut un explorateur avisé de cette peur dans nombre de ses livres. A cet égard, on gagnerait à lire ou à relire Les enfants de l’oncle Tom, Un enfant du pays et Black Boy en miroir de l’histoire dramatique qui, peu à peu, prend corps en France, où l’on commence à voir s’élancer dans le ciel les flammes d’un feu annoncé par James Baldwin.
Suivant la tradition naturaliste, Wright montre comment l’oppression raciale a développé chez le Noir américain un complexe comportemental – Frantz Fanon l’a aussi brillamment analysé - dominé par le sentiment d’insécurité existentielle. Ce sentiment, véritable instrument de contrôle social, opère comme un archétype (pour extrapoler le sens que Carl Gustav Yung a donné à ce mot) qui rattache, par exemple, la mort tragique de George Floyd en 2020, sous le genou d’un policier, aux exécutions sommaires des esclaves récalcitrants ou aux lynchages publics des Noirs dans le Sud des Etats-Unis pour les maintenir à leur place.
La France moderne, née de l'idéal républicain, n’a jamais institué de régime racialiste sur le territoire hexagonal. Mais la croissance des homicides, volontaires ou involontaires, commis par la police, couplée à la banalisation de la parole raciste dans l’espace public et médiatique, crée peu à peu au sein des populations issues de l’histoire coloniale un complexe de persécution. De sorte qu’aujourd’hui, beaucoup de parents noirs ou arabes, comme aux Etats-Unis, imposent à leurs enfants un code de conduite à observer face à la police. Ce code éthique va bien au-delà du respect que chaque citoyen doit aux représentants de l’autorité de l’Etat. Il est davantage mû par la peur, car dans la rue un jeune Noir ou Arabe ne semble pas avoir droit à l’insouciance. Aux yeux de la police, il est coupable d’emblée.
Dans Soumission, Michel Houellebecq entrevoit en France une guerre civile de nature politico-religieuse. En réalité, il convient de se demander si la guerre civile ne couve pas davantage entre la République et sa jeunesse multi-ethnique ostracisée, laquelle se sent bafouée dans son identité française. Une jeunesse qui, chantant la Marseillaise, brandissant l’étendard de l’égalité, se radicalisera de plus en plus au nom de l’Idée suprême qui a fait la grandeur de la France mais que beaucoup vivent comme une illusion.
La guerre civile donc. Elle recouvre pour l’instant des proportions symboliques entre les hordes « barbares » des banlieues [dixit le président de LR Eric Ciotti] et les « patriotes » qui viennent de lever une cagnotte de plus d’un million d’euros en faveur du policier accusé d’homicide volontaire. Ces mêmes « patriotes » se sont organisés en milices nocturnes afin de « sauver la nation ».
Nation. Le mot est lâché pour exclure et séparer. Son usage pernicieux ici nous offre l’occasion de revenir à la magnifique réflexion qu’Ernest Renan a menée autour de ce concept : « Non, ce n’est pas la terre plus que la race qui fait une nation », écrit-il dans Qu’est-ce qu’une nation ?, ouvrage paru en 1882. La terre fournit le substratum […] l’homme fournit l’âme. L’homme est tout dans la formation de cette chose sacrée qu’on appelle un peuple. Rien de matériel n’y suffit. Une nation est un principe spirituel, résultant des complications profondes de l’histoire, une famille spirituelle, non un groupe déterminé par la configuration du sol. » Il poursuit : « Une nation est une âme et un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une […]. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. […] Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. […] Je me résume, Messieurs. L’homme n’est esclave ni de sa race ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagne. Une grande agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s’appelle une nation. »
Il est peu probable qu’Ernest Renan ait eu la France postcoloniale en ligne de mire lorsqu’il écrivait ces mots. N’empêche que son argumentation donne à entendre une définition non figée de la nation, à la fois ancrée dans le passé tout en restant ouverte vers l’avenir telle cette matière en expansion continue qui porte l’univers. Il y a certes « l’héritage indivis », mais celui-ci est toujours appelé à s’enrichir d’agrégats nouveaux. Ainsi la nation française se réclame-t-elle tant des Misérables de Victor Hugo, des sonates de Claude Debussy que des balais nègres de Joséphine Baker ou de la musique rap des banlieues parisiennes et marseillaises. Le mot « indivis » se révèle en cela fondamental. Il dit le caractère inséparable d’un héritage se déclinant en clair-obscur, avec sa face glorieuse (cf. la Révolution française ou l’Appel du 18 juin) et son envers infâme (la traite atlantique, l’esclavage des Noirs, la déportation des juifs, les guerres coloniales). N’en déplaise aux « patriotes », c’est un pur Mensonge historique que de chercher à découpler les héritages nés « des complications profondes de l’histoire » ; un aveuglement suicidaire de refuser d’ausculter les courants souterrains d’une nation en quête de redéfinition.