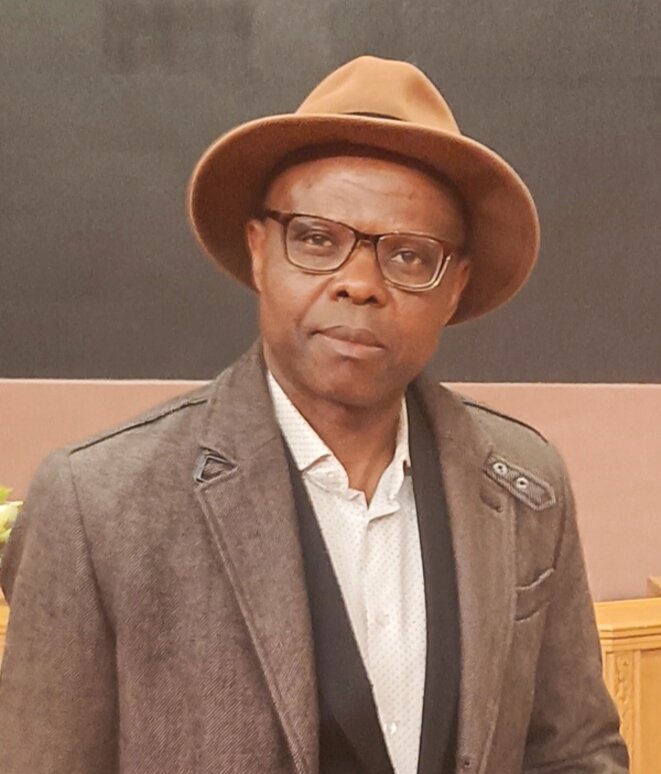Dans un chapitre de mon dernier ouvrage, Méditations senghoriennes : vers une ontologie des régimes esthétiques afro-diasporiques, j’ai proposé une analyse sommaire de la danse oriengo, ce qui était aussi un hommage à son inventeur Kaki Disco :
Pages 180-81, on peut lire :
« Au sujet de la vitalité gestuelle des arts populaires africains, nous allons examiner deux danses contemporaines du Gabon : l’oriengo et le djazzé (déformation du mot jazz). A première vue, l’’oriengo serait une variante du soukouss congolais, lui-même dérivé de la danse traditionnelle kwasa-kwasa. Quant au djazzé, il semble plutôt une adaptation de la danse populaire ghanéenne azonto, à laquelle l’on a adjoint des chorégraphies hip-hop. A propos de l’oriengo, la légende rapporte qu’un handicapé physique aimait les bars populaires et se trouva désemparé le jour où il fut privé de sa canne. Il s’agrippa alors à un arbre pour s’en servir comme support. Quelqu’un l’avait rejoint, avait posé les mains sur ses hanches, puis une chaîne s’était formée derrière le danseur. L’oriengo serait donc né d’une improvisation individuelle et collective. Aujourd’hui, cette danse connaît un franc succès dans les clubs parisiens bien que les contorsions lascives de sa gestuelle aient été expurgées sous l’influence de l’esprit pudibond des sociétés européennes où elle s’exécute désormais par simple balancement des jambes et par des pirouettes stéréotypées.
Une belle démonstration de la danse oriengo est visible sur Youtube à travers un vidéo-clip tourné au Gabon — « Petit modèle » du chanteur Kaki Disco. Le film montre en arrière-plan un arbre dressé sur des racines ramifiées. L’arbre a valeur de témoignage historique. Il rappelle le contexte dans lequel la danse oriengo serait apparue. Il recouvre aussi un sens métonymique car les mouvements chaloupés des danseurs épousent et décrivent les mêmes courbes que les racines. Les corps en deviennent le prolongement grâce à la magie de l’art. On remarque aussi la présence de deux handicapés physiques dans le clip. Ceux-ci parviennent à surmonter les limites de leur mobilité grâce à une extraordinaire performance. Ils subvertissent le geste claudicant, lequel cesse d’être une marque de difformité et se transforme en une signature esthétique intégrée à l’ensemble de la chorégraphie. A la manière des danseurs hip-hop, les handicapés jouent avec leur corps, proposent au public des postures variées et spectaculaires en exécutant des pirouettes avec les bras et les jambes. Ainsi peuvent-ils explorer de nouvelles possibilités de spatialisation et laisser s’exprimer des aptitudes insoupçonnées de leur corps. Leur danse, d’une vitalité surréaliste, orgiaque (d’où sa déconstruction dans la version européenne, qu’on peut qualifier d’apollonienne), découvre une belle élasticité kinesthésique Léopold Sédar Senghor avait donc raison de souligner que l’expression du sublime dans la culture africaine ne se réalise pas sur le mode contemplatif, mais par un langage dynamique. C’est un logos par lequel l’Être se trouve transporté, corps et âme, dans un rite purificatoire, une quête de nouvelles possibilités de jouissance et de célébration de la vie. En effet, la maîtrise du corps désarticulé, moqué, rejeté, déconsidéré sonne comme une revanche sur la société. Ici, la mise en scène du difforme fait penser à l’art surréaliste où la dislocation des formes devait donner lieu à un nouveau canon artistique. L’esthétisation du « grotesque » dans l’oriengo renvoie également au concept que le critique afro-américain Houston Baker, Jr qualifie de « maîtrise de la déformation », propre au langage vernaculaire noir et dont certains poètes de la Renaissance de Harlem, en particulier Langston Hughes, s’étaient appropriés dans leur effort de création d’un genre littéraire alliant modernisme européen et génie afro-américain. »
Marc Mvé Bekale
Maître de conférences, Université de Reims
Chef de département TC
Essayiste