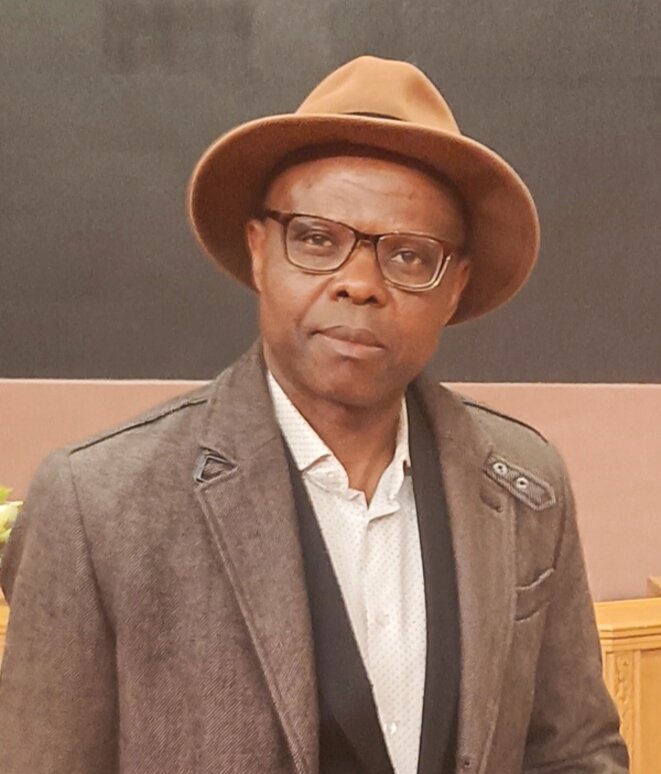Il y a eu la Françafrique politique. En état d’agonie depuis quelque temps, elle semble retrouver vie en se couvrant de nouveaux atours. Intellectuels, ceux-là. A l’origine de cette métamorphose, le philosophe essayiste Achille Mbembe. Adoubé par le journal Le Monde et Emmanuel Macron qui l’a placé à la tête de la Fondation de l’innovation pour la démocratie*, après lui avoir confié l’organisation du Nouveau Sommet Afrique-France en 2021. L’originalité de son statut est qu’au moment où les populations, en France comme en Afrique, exigent le démantèlement de la Françafrique, notre collègue camerounais, lui, semble l’avoir réinventée pour mieux s’y installer. Son argument central : œuvrer au réarmement de la pensée démocratique en vue de la redéfinition des relations entre la France et son ancien pré carré. Ayant ainsi endossé la stratégie du soft power macronien, il apparaît désormais, à travers la Fondation qu’il dirige depuis Johannesburg, comme un des leviers essentiels du dispositif conçu pour le ripolinage de l’image de la France auprès de la jeunesse et de l’intelligentsia africaines.
Mais la Françafrique, quelle que soit sa nature, s’accompagne toujours de revers pour ses thuriféraires, en cela que le rapport de forces économiques et financières, en faveur de la France qui a injecté 50 millions d’euros dans la Fondation sur cinq ans, met souvent la probité à l’épreuve, crée un espace inconfortable quand il s’agit d’examiner des questions délicates. L’on se trouve alors contraint de louvoyer, d’effleurer la vérité, de l’esquiver par un jeu d’équilibrisme rhétorique, lequel se traduit souvent chez Mbembé par le recours à un style précieux, élégant et de haute tenue, qui emprunte des chemins contorsionnés, navigue entre les courants porteurs de vérités, de semi-vérités et de sous-vérités. Pareille stratégie du discours n’aide guère à la clarté du message. L’on devine alors que cette technique stylistique vise à réhausser sa stature de philosophe, dont les écrits sont essentiellement destinés au lectorat du Monde, constitué en majorité d’aristocrates intellectuels européens qu’on retrouve souvent dans les cercles du pouvoir politique et économique. A cet égard, la France gagnerait à écouter un peu plus les activistes aux discours francs, radicaux et directs, véhicules des colères et des aspirations politiques de la jeunesse africaine, plutôt que de privilégier la parole des intellectuels coupés du petit peuple, qui pensent l’Afrique du haut de leur tour d’ivoire à New York, Paris et Johannesburg.
Dans un récent article au Monde, Achille Mbembe cherche à mettre en perspective la crise nigérienne. Cette crise, pense-t-il, se situe dans le long cycle des mutations que connaît l’Afrique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le travail de synthèse apparaît si ambitieux qu’il tombe parfois dans des amalgames, voire des généralisations qui relèvent davantage du désir de construction d’une théorie politique que des faits historiques.
Du faux basculement
Face aux coups d’Etat successifs en Afrique de l’Ouest, Achille Mbembe a recours à la notion de « basculement » ou de « pivotage », occultant le fait que le dernier putsch au Niger relève du déjà-vu tant ce pays est coutumier des changements par les armes – quatre au total depuis le premier réalisé par Seyni Kountché en 1974. Interpréter les évènements se déroulant dans une région spécifique pour en dégager une théorie historique générale confine à une pure synecdoque qui ne correspond guère à la réalité. Car le doute subsiste quant à l’application du concept de grand basculement aux pays d’Afrique centrale où la vie politique semble plombée parce qu’elle reste dominée au Gabon, Cameroun, en République du Congo, en Guinée équatoriale par des partis-états à vocation dictatoriale, crées, pour certains, au lendemain des indépendances. Malgré l’avènement du multipartisme, davantage une cacophonie politique où les voix les plus fortes monnayent leur soutien au régime en place, la paralysie est telle que la nouvelle élite se trouve souvent contrainte, pour des raisons de survie, d’accepter les règles institutionnelles mises en place par une gérontocratie indétrônable. Ici, aucun revirement notable.
Mais si basculement historique il y a, celui-ci a une portée mondiale. Il a été accéléré par la révolution numérique et les mutations démographiques. Outre l’Afrique, l’Inde et de nombreuses autres régions d’Asie en attestent.
Décolonisation inachevée
Le putsch du Niger apparaît symptomatique des derniers soubresauts d’un processus de « décolonisation incomplète », suggère Mbembe. Il convient alors de le parachever si l’on veut voir émerger un nouveau cycle historique dont les ressorts et les dynamiques sont livrés en vrac.
Témoignent de la « décolonisation inachevée », la présence des bases militaires françaises dans plusieurs pays africains, le maintien du franc CFA, l’Agence française de développement et les instituts culturels français. Il aurait pu citer également RFI et France 24 parmi les instruments de domination néocoloniale. Quid de la Fondation de l’innovation pour la démocratie, outil de soft power français dont il a pris la tête, il apparaît assez surprenant de mettre bout à bout tous ces instruments sans opérer un tri quant à leur fonction. Si les installations sécuro-militaires françaises restent des vestiges de domination (à démanteler), il convient de nuancer la présence des institutions culturelles qui apparaissent vitales à la diffusion des savoirs auprès des publics scolaires et universitaires des pays francophones. Au Gabon, en République du Congo ou son voisin RDC, pour m’arrêter à ces exemples, les instituts français sont pratiquement les seuls espaces où l’on peut lire les auteurs locaux.
Critique du néosouverainisme africain
Achille Mbembé montre, avec justesse, l’épuisement des « formats politico-institutionnels » issus des Conférences nationales des années 1990. Comme pour les indépendances, les promesses démocratiques n’ont pas été tenues. De mon point de vue, l’échec procède, en partie, de la nature des dynamiques d’ouverture politique, impulsées de l’extérieur, avant d’être verrouillées par une gérontocratie pénétrée d’un logiciel politique despotique, sous l’œil complaisant des gouvernements successifs français. La démocratie, grâce à la perspective d’alternances, était porteuse d’espérance, de renaissance politique et de valeurs nouvelles. Or sa faillite, doublée de crises économiques, des désillusions d’un début de millénaire qui se voulait africain avec les projets du « Millennium Africa », a conduit à une forme de nihilisme due au vide idéologique, à la « désorientation morale » des populations.
La crise nihiliste (j’assume le mot) à laquelle est confrontée l’Afrique recouvre donc des articulations diverses. Outre l’absence de boussole idéologique, philosophique et morale, elle prend également forme, écrit Mbembe, dans « la montée en puissance du néosouverainisme, version appauvrie et frelatée du panafricanisme. » Il poursuit : « le néosouverainisme est moins une vision politique cohérente qu’un grand fantasme. Aux yeux de ses tenants, il remplit d’abord les fonctions de ferment d’une communauté émotionnelle et imaginaire, et c’est ce qui lui octroie toute sa force, mais aussi son pesant de toxicité. »
Cette charge appelle plusieurs remarques. Terme à la mode depuis quelques années, le néosouverainisme, appliqué au contexte africain, désigne les formes d’activisme ou de militantisme marquées par des discours virulents à l’encontre des puissances occidentales et la volonté de reconquête de la souveraineté politique, économique et culturelle de l’Afrique. Figurent parmi les tenants de ce mouvement dans l’espace francophone, le Franco-Béninois Kémi Séba et l’Antillais Nioussérê Kalala Omotunde, décédé l’année dernière, qui se réclamait de l’école d’égyptologie déconstructiviste de Cheikh Anta Diop.
Le néosouverainisme est qualifié d’avatar fantasmatique du panafricanisme. Le fait est que les revendications de ses partisans, assez audibles sur les réseaux sociaux, n’ont rien d’un fantasme. Elles sont ancrées dans l’expérience historique des populations noires. En effet, depuis le 19ème siècle, les Noirs ont toujours cherché une riposte à leur oppression par des discours de ralliement panafricaniste contre les puissances coloniales. Le premier grand texte à ce sujet parut sous la plume de David Walker. Ce dernier lança, depuis Boston en 1829, « Un appel à tous les citoyens de couleur du monde » pour l’affirmation des droits universels inspirés de la philosophie des Lumières. Vinrent ensuite les écrits de Martin Robinson Delany, activiste partisan d’un nationalisme séparatiste noir, qui avait élaboré avec d’autres penseurs afro-descendants les plans de développement de l’Afrique dans la perspective d’une émigration définitive. William E. B. Du Bois et Richard Wright furent, eux aussi, de fins théoriciens des mécanismes de potentiation (empowerment) politique, économique et sociale de l’Afrique. Dans Black Power: An American Negro Views the African Gold Coast (1954), Wright s’adresse directement à Kwame Nkrumah, l’un des pères du panafricanisme, pour l’exhorter à armer [“AFRICAN LIFE MUST BE MILITARIZED!”] « la vie africaine… non pour la guerre, mais pour la paix ; non pour la destruction, mais pour le service, non pour l’agression, mais pour la production, non pour le despotisme, mais de libérer les esprits de la sorcellerie… Je ne parle pas de dictature militaire. Tu le sais. Je ne dois même pas avoir besoin de te le préciser, mais je le fais pour ceux qui seront assez naïfs pour déformer mes mots. Je parle tout simplement d’une militarisation du quotidien, de la vie sociale du peuple ; je parle de donner forme, une structure, une direction, un sens qui justifie son existence […] Ce que les Européens n’ont pas fait, ne voulaient pas faire parce qu’ils craignaient de mettre à mal leurs intérêts. » Il faut comprendre le mot « militarize » ici dans le sens de « empower » (donner du pouvoir) au cœur de l’idéal néosouverainiste.
Il existe donc une épistémè panafricaniste née des exigences décolonialistes. Elle consiste en une pensée et un discours qui posent l’Afrique comme objet de réflexion théorique en vue de sa libération. Outre les questions de souveraineté, ce discours mobilise également une dialectique subversive, sinon réactive, en cela qu’il cherche à déconstruire les mythes suprémacistes de la science occidentale qui avait exclu l’Afrique de l’histoire. Le souverainisme contemporain, quelque brouillon, frelaté ou toxique qu’il soit, se situe dans la continuité d’un combat que, du haut de nos tours aux vanités, nous regardons avec condescendance en le confinant à un pur « fantasme », à une « communauté émotionnelle et imaginaire ».
Pas étonnant, aveuglés par notre suffisance intellectuelle, de nous voir bégayer lorsque survient un putsch et que les populations, désespérées, en quête de nouvelles significations, brandissent des pancartes de soutien aux pouvoirs voyous.
Quant aux néosouverainistes décriés, eux attirent les foules - Thomas Sankara hier, Ousmane Sonko au Sénégal aujourd’hui - parce qu’ils pensent et sentent avec ceux dont le quotidien est un calvaire. Ils intègrent la douleur du petit peuple dans leur récit. Ils recherchent d’autres dynamiques, probablement utopiques, afin d’échapper au nihilisme qui hante une Afrique sans cesse en faillite.
* L’idée de la Fondation de l'innovation pour la démocratie est née de la volonté d’Emmanuel Macron de créer un fonds d’innovation avec une gouvernance indépendante pour soutenir les acteurs du changement et examiner les questions de gouvernance et de démocratie en Afrique. Il a doté la Fondation de 50 millions d’euros sur cinq ans.