La science procède d’abord et avant tout de la curiosité. Faire science, c’est d’abord se poser des questions. C’est pour cela que dans les rapports entre sciences et religions, les deux choses ne se situent pas du tout sur le même champ : la religion est d’abord question de croyances (même si elle peut aussi comporter une partie de savoirs) alors que la science est questions de savoirs (même si ces savoirs peuvent découler aussi en partie de croyances) Il s’agit d’abord pour la science de démêler ces deux aspects du réel (puisque le « réel » c’est ce qui résiste : ce qui résiste a nos croyances bien entendu, mais aussi qui résiste à notre savoir, d’où d’ailleurs l’utilité de la science)

Mais les savoirs ne sont pas l’apanage de la science : la philosophie, par exemple, est elle aussi une activité qui prétend collationner un savoir, élaboré avec d’autres méthodes et selon d’autres fins que celles des sciences. Et n’oublions pas non plus les ethno savoirs, ces activités de connaissance que nous élaborons quand nous nous livrons a des « bricolages » de connaissances tels qu’ils ont été mis en évidence par la branche de la sociologie appelée « ethnométhodologie » par son créateur, Harold Garfinkel .
Ce qui distingue la science de cette dernière est sans doute en premier lieu le fait que les méthodes utilisées en science sont fortement formalisées, contrairement aux savoirs pratiques qui constituent notre activité sociale quotidienne. Et la différence profonde entre science et philosophie tient sans doute à un objet complètement différent (puisque la science à son origine était conçu comme une « philosophie de la nature », ainsi que le rappelle le nom des scientifiques dans les pays anglo saxons ou ceux-ci sont nommé philosophiæ doctor (PhD)) mais aussi à un rapport différent au temps : alors que les sciences oublient constamment leur passé en l’intégrant, la philosophie rediscute en permanence « à nouveau frais » les concepts hérités du passé.
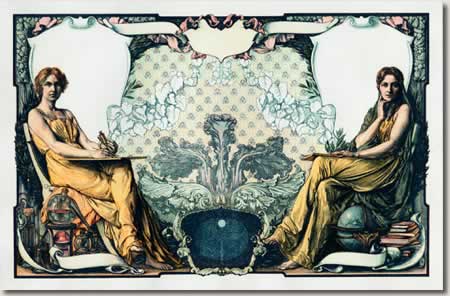
Mais cette activité étrange consistant à se poser en permanence des questions implique également de constituer une méthodologie particuliére sur la façon de se les poser. Ce qu’on appelle « problématique » et qui constitue une étape obligée de toute démarche scientifique.
Pour qu’il y ait recherche, il faut donc qu’il y ait question. Cette question, ou plus généralement cette série de question constitue un hameçon permettant à la personne conduisant la recherche de se saisir de Et la résolution d’une problématique ne dépend pas uniquement de méthodes préétablie (puisque en général, le fait même d’essayer de résoudre un probléme nouveau implique que les « anciennes méthodes » ne fonctionnent plus automatiquement. Quand on parle de « problématique », on parle d’un faisceau de question, mais aussi des méthodes qui seront finalement utilisée pour résoudre celui-ci

La science se défini donc comme l’art (subtil) de poser les bonnes questions (sans d’ailleurs avoir forcément les bonnes réponses) Seront nous capable à notre tour de poser les bonnes questions à la science ?



