
Agrandissement : Illustration 1
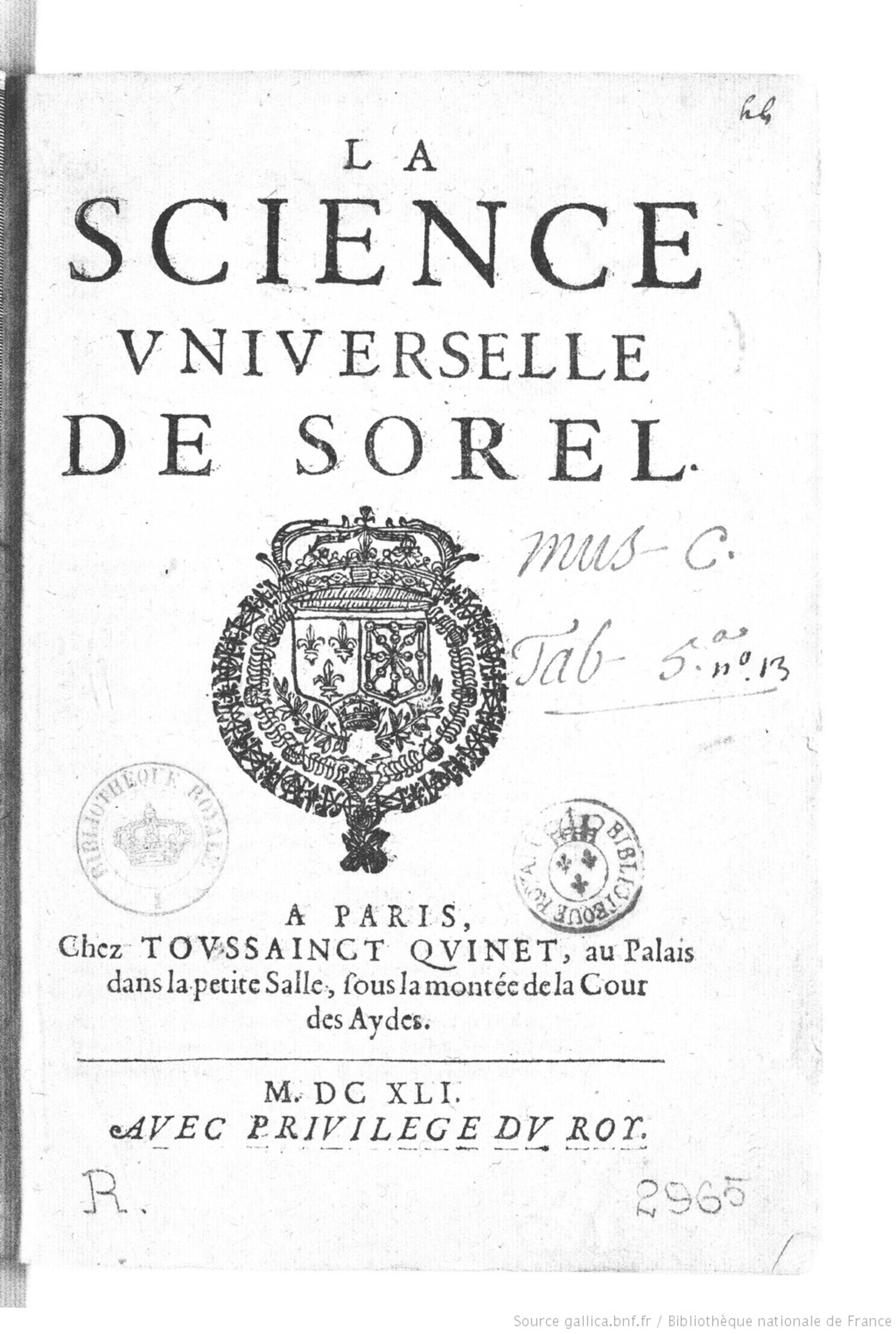
Seulement, les utopies d'autrefois ont cédés à la froide réalité d'aujourd'hui : l'église catholique est en perte sensible de vitesse (et d'influence) La révolution universelle à disparu dans les gouffres post modernes d'un présent éternel, et les internationales ouvrières ne sont plus que de vieux souvenirs d'histoires, plus ou moins oubliés. La notion de progrès est impactée par la crise écologique majeure qui s'annonce à l'horizon de notre siècle. Et les sciences elles mêmes se sentent menacées, frêle radeau de raison sur un océan déchaîné ou flottent les idéologies.
Le principal obstacle à l’acceptation a-critique de la vocation universelle des science semble être le « relativisme » qui s'oppose aux préceptes de la méthode scientifique. Le relativisme a en effet ses farouches détracteurs parmi ceux qui font profession de penser les sciences, philosophes, historiens ou parfois scientifiques eux mêmes ! Mais cette opposition se complique du fait des deux catégories profondément différente du relativisme. Il existe en effet un « relativisme cognitif » (aussi appelé « relativisme épistémologique » par les détracteurs de cette approche) et un relativisme moral, tous les deux étant très différents en terme de méthodologie et de démarche, ce qui n’empêche pas les détracteur du « relativisme » sans adjectif de les confondre dans une confusion typiquement relativiste....

Le « relativisme épistémologique » est attribué au philosophe des sciences « Thomas Samuel Kuhn» On connaît surtout la notion de « paradigme » et de « révolution scientifique » qui y sont attachés, et qui sont développé dans un livre fondateur « la structure des révolutions scientifiques » Pour lui, la science ne progresse pas par l'accumulation de savoir mais par des ruptures dans la vision globale des représentations (les « révolutions scientifiques ») Celles ci passent par des « changement de paradigmes » Or affirme Kuhn, ces ruptures sont tout autant « sociales » (découlant d'une vision du monde ») que « techniques » (découlant de facteurs internes à une disciplines). Cette vision des progrès scientifiques (« avec paradigme ») a eu un très grand succès dans les sciences sociales autant qu'il était décrié par un courant issu des sciences exactes, qui lui reprochait de faire rentrer le loup du social dans la bergerie des sciences exactes. Cette vision allait être encore radicalisée par un ouvrage d'un disciple de Thomas Kuhn, un scientifique, sociologue et musicien nommé Paul Feyerabend qui mettra en doute l'ensemble de la méthode scientifique dans un ouvrage au titre (et au contenu) provocateur : « contre la méthode » (son sous titre a beaucoup fait pour le succès considérable lors de sa première édition en 1970 « esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance ») Les idées défendues par Paul Feyerbabend vont varier au fil des ans et des combats qu'il mènera avec plus ou moins d'aisance, pas sa conviction que si la science est une forme spécifique de connaissance, elle n'a pas a se substituer a toutes les autres formes de connaissances (qui ne sont pas toutes spécifiquement « scientifiques ») Nous reviendrons également sur tout un courant qualifié (parfois un peu rapidement) de « relativiste », celui des historiens et sociologues des sciences issus du « courants fort en sociologie des science » dont l'origine est l'ouvrage fondateur de David Bloor Sociologie de la logique ou les limites de l'épistémologie contient l'idée que c'est le social qui clos les controverses scientifiques. Cette idée est régulièrement attribuée à l'autre grand sociologue de ce courant, Bruno Latour, qui n'a cessé de combattre celle ci (en élaborant une vision plus complexe du fait scientifique appelée « théorie de l'acteur réseau » sur lequel nous reviendrons)
Le relativisme moral lui prône qu'il n'y a pas de critères définitifs du bien et du mal, et qu'il n'est pas possible de hiérarchiser les valeurs morales. Contrairement à ce qui est parfois affirmé, le relativisme ne prétend pas que le mal et le bien n'existe pas, mais entend substituer des critères pragmatiques reliés a des objectifs explicites et communs aux anciens critères absolus fondés en général sur une religion particulière. Il s'agit donc de substituer à une morale religieuse une éthique explicitement laïque. Mais c'est a partir des tenants du « relativisme moral » qu'est issu ce slogan a visée de mot d'ordre « tout se vaut » En général il est appliqué a ceux qui sont traité sommairement de « relativistes » et accusés de défendre le fameux précepte

universalisme occidental ?
Comme les autres universalismes cités (l'universalité religieuse, celle du progrès, celle des valeurs « démocratiques ») l'universalisme des sciences à été rejeté en ce qu'elle faisait la part trop belle à l'universalisme de la science occidentale. La science a été ainsi accusée d'introduire des valeurs typiquement impérialistes sous couvert de progrés des connaissances. La premiére accusation formalisée de ce type de contestation a été émise par Gandhi dans le cadre du processus de libération de l'inde de sa situation coloniale. Cette critique était fondamentalement « morale » : la « science occidentale » étant censé préparer à un amoralisme destructeur. Mais les critiques de la science en inde ont généralisé cet aspect uniquement moraliste. La période ouverte par la mort de Nehru a vu apparaître des mouvements de « science alternative » (à la science occidentale) qui avait ceci de particulier qu'ils comprenaient nombre de scientifiques de haut niveau (de Jagadis Chandra Bose, le physiologiste et physicien, et Srinivasa Ramanujan, le mathématicien à Vandana Shiva une physicienne devenue une des principale oposantes à l'imposition des PGM en inde ) même si la synthése de leur apport a été faite par un sociologue aux intérets variés (de la Science Indienne au Cricket)
Avec Vandana Shiva on passe à une autre approche, puisque la critique des sciences est non seulement marquée comme « occidentaliste », mais qu'elle y adjoint les critiques « féministes » des sciences faites à la même époque. Dans un article analysant ce courant extrémement important de critique de la prétention des sciences occidentales à l'universalité (revue l'indécide - Hypothése : les critiques indiennes de la science occidentale : http://indecise.hypotheses.org/217), on présente ainsi la position de celle ci : « «Les Opinions occidentales contemporaines de la nature sont empreintes de dichotomie ou de dualité entre l’homme et la femme, la personne et la nature …. Dans la cosmologie indienne, en revanche, la personne et la nature (Purusha-Pakriti) sont une dualité dans l’unité» L’argument de Shiva est que la gestion forestière et la révolution verte en agriculture ont été masculins, les projets réductionnistes ont séparé les femmes (et les hommes) de leurs racines naturelles et ont conduit à la destruction des ressources naturelles précieuses. Dans les protestations des femmes rurales, en particulier le mouvement Chipko dans le nord de l’Inde, Shiva voit le «contre-pouvoir» de la connaissance et de la politique des femmes
Science et histoire, un rapport problématique
Une des difficultés pour inscrire les sciences « exactes » dans une recherche de l'universel est leur rapport problématique à l'histoire. Si on prend les sciences expérimentales comme le summum de toute science exacte, alors la contingence les met forcément en crise à partir de l'instant où elle pose un événement comme non reproductible (ce qui est précisément la définition du terme « contingent ».) L'histoire est sans cesse confrontée à cette question : les événements qu'elle étudie sont par nature contingent. Comment tester un événement contingent avec un dispositif expérimental qui impose justement qu'il ne possède pas ce caractère. Mais la difficulté est encore pire quand on aborde un secteur de l'histoire qui a la propriété de mettre les scientifiques en crise : l'histoire des sciences dés lors qu'elle n'a pas de nature hagiographique possède cette qualité de sortir tout scientifique normalement constitué de ses gongs.
C'est l'histoire des science qui a mis a mal toute la vulgate de la physique comme science uniquement « expérimentale » par exemple l'ouvrage fondateur de Peter Galisson « « Ainsi s’achèvent les expériences : la place des expériences dans la physique du xxe siècle » mais aussi un certain nombres d'ouvrages de Dominique Pestre, dont « A contre science, science et pouvoir » donne un certain nombre d'indication sur la tentative de refaire à nouveau frais un certain nombre d'expériences fondatrices de la physique. L'ouvrage de Peter Gallisson présente la particularité d'être écrit par un physicien, doté d'une compréhension interne des enjeux en cause dans les controverses scientifiques, et qui montre que les critères de validité d'une expérience sont variables et ne correspondent pas à un absolu qui serait « la nature » pris comme un élément préexistant et qui impose sa loi.
C'est là ou la sociologie des sciences intervient, et ouvre une période de discussions et de contreverses pas totalement bouclées à l'heure actuelle. En particulier une crise importante va découler de l'ouverture d'une nouvelle façon de considérer les sciences à partir du « programme fort en sociologie des sciences » pour rappel voila comment le « programme fort » est présenté sur Wikipedia :
Le programme fort veut dépasser la sociologie de la science telle que pratiquée par Robert King Merton qui ne s'intéressait qu'aux conditions institutionnelles de la science et pas aux contenus même des énoncés scientifiques. Il est également une réaction contre les approches sociologiques antérieures qui restreignaient leur objet d'étude aux théories scientifiques fausses ou ayant échoué. Selon de telles approches l'échec de théories scientifiques s'expliquerait par des biais tels que les intérêts politiques ou économiques de leurs défenseurs. La sociologie ne saurait expliquer la réussite de théories scientifiques, celle-ci étant attribuable à leur validité intrinsèque. Le programme fort propose de traiter de manière symétrique les théories scientifiques, qu'elles soient « vraies » ou « fausses ». La formation et le devenir de ces deux types de théories sont soumis au même déterminisme, incluant des facteurs sociaux comme le contexte culturel ou l'intérêt personnel au même titre que des facteurs naturels.
Le défenseur principal de cette approche est le philosophe des sciences David Bloor Or de façon quelque peu cavalière on attribue son approche a celle de son principal adversaire et contradicteur, Bruno Latour Résumons les positions : au départ, la problématique posée est celle du « devenir » des théories scientifiques par l'histoire : d'un coté des théories scientifiques qui ont « réussi » et d'autres des théories scientifiques qui ont échoué à représenter le monde physique. Dans le premier cas, on donne des explications « internes » (à la « technique » de recherche employées) et de l'autre des explications « sociales ». Le point de départ du « strong program » c'est d'exiger la symétrie des explications, pour l'un comme pour l'autre. Pour David Bloor, on ne peut pas distinguer de façon absolue « la nature ». Il a une affirmation provocante qui a fait beaucoup pour la popularisation de ses thèses : la nature n'existe pas ! Or Bruno Latour, contrairement à ce qu'affirment ses détracteurs, ne reprend pas du tout cette critique. Au contraire, il lui reproche un coté « pas assez symétrique » : la formule de Latour est encore plus provocante : « si la nature n'existe pas, le social n'existe pas non plus »… C'est là ou il va élaborer avec d'autres sociologues une théorie consistante, la « théorie de l'acteur réseau » qui montre une reconfiguration symétrique du social et de la nature sous le poids de systèmes complexes qui impliquent égalent une « sociologie de la traduction » qui permet également de pouvoir analyser la nouveauté de l'ère techno-scientifique qui reconditionne les échanges entre science et technique. Car la science « découvre » et la technique « invente » : c'est même comme ça qu'on fait la différence entre une découverte (publiable) et une nouvelle technique (brevetable) Mais l'évolution actuelle fait la part belle aux recombinaisons inédites de science et de technique. On peut les voir a l’œuvre avec les promesses des « nano technologies », de la biologie de synthèse ou l'exploitation des « big data » : des révolutions à venir qui reconditionnent de façon extrémement prégnante notre univers mental.
C'est dans ce cadre extraordinairement mouvant que va se situer l'ouverture de la fameuse « guerre des sciences » ouverte par des scientifiques (Sokal et Bricmont ) en guerre contre ce qu'ils désignent comme la « gauche post moderniste » Or ces deux scientifiques montrent une méconnaissance obtuse des textes qu'ils sont censés critiquer et une approche des sciences humaines effroyablement défaillante. On le voit quand ils critiquent Latour pour des positions qu'il n'a jamais eu, voir même quand il dit exactement le contraire de ce qu'ils prétendent (en particulier Latour n'a jamais, mais alors jamais présenté l'activité des scientifiques comme l'invention d'un consensus (à la limite, il est vrai par contre qu'il pense que les découvertes scientifiques sont « construites », mais entre « construites » et « inventés », il y a plus qu'une nuance : un ouvrage architectural est certainement construit, mais on ne peut pas faire n'importe quoi sous peine d'écroulement des magnifiques constructions imaginaires.
conclusion : pour un universalisme modeste
La science ne peut pas, sauf à se renier, renoncer à sa vocation à l'universalisme. Elle doit chercher des vérités générales, qui ne soit pas impactées par les préjugés du temps ou par la culture. Mais elle doit aussi rester modeste, et penser qu'elle tend plus à la véracité qu'a la vérité. Sinon, le malaise bien concret qu'elle suscite déjà ne fera que s'accroitre et s'approfondir...
Bibliographie :
Paul Feyerabend Dialogues sur la connaissance Le Seuil 1996
Peter Gallisson : comment se terminent les expériences Editions la découverte 2002
Ian Hacking : Entre science et réalité : la construction sociale de quoi Edition la Découverte 2004
Hubert Krivine et Annie Grossmann : De l'atome imaginé à l'atome découvert, Contre le relativisme De boek 2015
Bruno Latour : Cogitamus Edition la découverte 2014
Jean Marc Levy Leblond : le grand écart, la science entre technique et culture editions maculia 2013D. Pestre, A contre-science: Politiques et savoirs des sociétés contemporaines, Paris, Seuil 2013
Stephen Shapin : une histoire sociale de la vérité Paris La Découverte 2014



