Dans son dernier ouvrage, Isabelle Stenger prend en considération le mouvement présent dans des secteurs croissants des sciences exactes pour "ralentir les sciences" et donne des pistes pour parvenir a cette visée en liant les objectifs des jeunes chercheurs confronté à la rentabilisation croissante de leur domaine d'activité et ceux du public de plus en plus inquiet des dérives constatée d'une science soumise sans partage aux impératifs du marché.
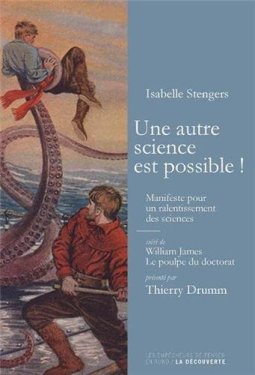
Tout le monde connait les "fast foods", la "mal bouffe" : c'est vite fait, vite mangé, pas trés bon et pas trés digeste. Au même momment, la science voit apparaitre un secteur qu'on pourrait appeler "fast science" sous l'égide des biotech ou des nanotechnologies : c'est rapidement fait, même si les résultats sont largement surestimé.
Face au secteur de la restauration rapide, un mouvement baptisé slow food [restauration lente] s’est alors développé en opposition, depuis une vingtaine d’années. Il ne s’agit pas uniquement de manger moins vite, mais mieux, de façon plus attentive et plus conviviale, c’est-à-dire : beau, bon et sain. C’est un peu la même chose en science. Le fait de mener certaines recherches plus rapidement n’est pas critiquable en soi, mais ça l’est lorsque l’accélération devient une norme. La multiplication des comités de pilotage et l'obligation de résultat entraine une situation malsaine qui elle même entretient un mouvement de contestation ancré dans le devenir de jeunes chercheurs confrontés a la précarisation croissante de leur status et à l'impossibilité d'objectifs de rentabilisation immédiate qui condamnent la science à un déséchement progressif.
Une économie spéculative - avec ses bulles et ses krachs - s'est emparée de la recherche scientifique : les chercheurs doivent intéresser des « partenaires » industriels, participer aux jeux guerriers de l'économie compétitive. Conformisme, compétitivité, opportunisme et flexibilité : c'est la formule de l'excellence. Mais comment poser publiquement la question d'un désastre lorsque l'on ne veut pas que le public perde confiance en « sa » science ? Les mots d'ordre comme « Sauvons la recherche » font consensus, alors qu'ils ne posent surtout pas la bonne question : « De quoi faut-il la sauver ? "

La question qui se pose alors c'est de savoir quelles modalités peut prendre cette mobilisation pour atteindre ses objectifs, et quels alliances elle doit nouer avec le grand public. Isabelle Stengers montre que les chercheurs doivent cesser de se prendre pour le « cerveau pensant, rationnel, de l'humanité », refuser que leur expertise serve à faire taire l'inquiétude de l'opinion, à propager la croyance en un progrès scientifique inéluctable capable de résoudre les grands problèmes de sociétés. Il s'agit pour eux de nouer des liens avec un public potentiellement intelligent et curieux, c'est-à-dire aussi de produire des savoirs dignes de cette ambition.
La question qui fait sens, celle de la rapidité doit elle même etre questionnée. La science progresse t elle de façon si probante depuis le "grand tournant" des grandes mutations techniques (de la "big science" assujettie au secteur de la défense aux mutation de la biotechnologie et du décodage de l'ADN) Les scientifiques doivent se demander s’ils ne participent pas aussi à leur propre asservissement, en se lançant à corps perdu dans les appels d’offres tous azimuts, en s’adaptant aux critères d’évaluation.
Il reste néanmoins des poches de liberté et des marges de manœuvre, on ne doit pas exagérément se considérer comme pris dans un engrenage impitoyable. La question est aussi celle de la démocratisation de la science, de ses espaces d'élaboration et de ses institutions. On peut prendre des initiatives collectives, la recherche peut s’ouvrir aux citoyens avec de l’imagination. Les industriels et les banquiers se promènent dans certaines universités et grandes écoles comme dans leur jardin pour imposer leurs normes en amont et en aval de la formation et de la recherche. Pourquoi les citoyens et les associations n’auraient-ils pas le droit de prendre le temps d’être eux aussi consultés et acteurs ?
Isabelle STENGERS, William JAMES Une autre science est possible !Manifeste pour un ralentissement des sciences, suivi de Le poulpe du doctorat - Les empécheurs de penser en rond/La découverte 2012
Appel de la pétition "pour un ralentissement de la recherche"

Pour un mouvement Slow Science
Chercheurs, enseignants-chercheurs, hâtons-nous de ralentir ! Libérons-nous du syndrome de la Reine Rouge ! Cessons de vouloir courir toujours plus vite pour, finalement, faire du surplace, quand ce n’est pas de la marche arrière ! À l’instar des mouvements Slow Food, Slow City ou Slow Travel, nous appelons à créer le mouvement Slow Science.
Chercher, réfléchir, lire, écrire, enseigner demande du temps. Ce temps, nous ne l’avons plus, ou de moins en moins. Nos institutions et, bien au-delà, la pression sociétale promeuvent une culture de l’immédiateté, de l’urgence, du temps réel, des flux tendus, des projets qui se succèdent à un rythme toujours plus rapide. Tout cela se fait non seulement aux dépens de nos vies – tout collègue qui n’est pas surmené, stressé, « surbooké » passe aujourd’hui pour original, aboulique ou paresseux -, mais aussi au détriment de la science. La Fast Science, tout comme le Fast Food, privilégie la quantité sur la qualité.
Nous multiplions les projets de recherche pour tenter de faire vivre nos laboratoires qui, souvent, crient misère. Résultat : à peine avons-nous terminé la mise au point d’un programme et, par mérite ou par chance, obtenu une subvention, que nous devons aussitôt songer à répondre aux prochains appels d’offres, au lieu de nous consacrer entièrement au premier projet.
Parce que les évaluateurs et divers experts sont eux-mêmes toujours pressés, nos CV sont de plus en plus souvent évalués au nombre de lignes (combien de publications, combien de communications, combien de projets ?), phénomène qui induit une obsession de la quantité dans la production scientifique. Résultat : outre l’impossibilité de tout lire, y compris dans les domaines les plus pointus, outre le fait que de très nombreux articles non seulement ne sont jamais cités mais ne sont jamais lus, il devient de plus en plus difficile de repérer la publication ou la communication qui compte vraiment – celle à laquelle le ou la collègue aura consacré tout son temps pendant des mois, parfois pendant des années – parmi les milliers d’articles dupliqués, saucissonnés, reformatés, quand ils ne sont pas plus ou moins « empruntés ».
Cela va de soi, notre offre de formation se doit toujours d’être « innovante », bien évidemment « performante », « structurante » et adaptée à l’ « évolution des métiers », évolution dont on a par ailleurs bien du mal à cerner des contours perpétuellement mouvants. Résultat : dans cette course effrénée à l’ « adaptation », la question des savoirs fondamentaux à transmettre – savoirs qui, par définition, ne peuvent être inscrits que dans la durée – n’est plus à l’ordre du jour. Ce qui compte, c’est d’être dans l’air du temps, et surtout de changer sans cesse pour suivre cet « air » tout aussi changeant.
Si nous acceptons des responsabilités gestionnaires (conseils d’université, direction de départements ou de laboratoires), comme nous sommes tous tenus de le faire au cours d’une carrière universitaire, nous voilà aussitôt contraints de remplir dossier après dossier, en donnant souvent les mêmes informations et les mêmes données statistiques pour la nième fois. Bien plus grave, les effets d’une bureaucratie envahissante et de la réunionite – ce dernier phénomène permettant de sauver les apparences de la collégialité tout en la vidant généralement de son essence – font que plus personne n’a de temps pour rien : nous devons nous prononcer sur des dossiers reçus le jour même pour une mise en œuvre le lendemain ! Certes, nous caricaturons un peu les choses en écrivant cela, mais nous n’en sommes hélas pas loin.
Cette dégénérescence de nos métiers n’a rien d’inéluctable. Résister à la Fast Science est possible. Nous pouvons promouvoir la Slow Science en donnant la priorité à des valeurs et principes fondamentaux :
- À l’université, c’est principalement la recherche qui continue à nourrir l’enseignement, malgré les agressions répétées de tous ceux qui rêvent de secondariser en partie cette institution. Il est donc impératif de préserver au moins 50% de notre temps pour cette activité de recherche, qui conditionne la qualité de tout le reste. Très concrètement, cela implique le refus de toute tâche qui empiéterait sur ces 50%.
- Chercher et publier en privilégiant la qualité demandent que chacun puisse se consacrer exclusivement à ces tâches pendant un temps suffisamment long. À cette fin, revendiquons le bénéfice de périodes régulières sans charge d’enseignement ou de gestion (un semestre de droit tous les 4 ans par exemple).
- Cessons de privilégier la quantité dans les CV. Des universités étrangères donnent déjà l’exemple, en limitant à 5 le nombre de publications que peut mentionner un candidat à un poste ou à une promotion (Trimble S.W., 2010, « Reward quality not quantity », Nature, 467:789). Ceci suppose que, de manière collégiale et transparente, nous nous dotions de méthodes et d’outils pour que nos dossiers ne soient plus évalués en fonction du nombre de publications ou de communications, mais en fonction du contenu de celles-ci.
- Nourri de la recherche, l’enseignement est la mission par excellence des universitaires : il s’agit de transmettre les savoirs acquis. Il faut laisser les enseignants-chercheurs enseigner, en améliorant leurs conditions de travail (combien de temps gaspillé à résoudre des problèmes pratiques et souvent triviaux qui ne relèvent pas de leurs missions ?), en allégeant leurs tâches administratives et en réduisant le temps passé à « monter des maquettes ». Ces fameuses « maquettes », notamment, pourraient se borner à définir le cadre pédagogique propre à la discipline dans l’université considérée, sans qu’il soit nécessaire de changer ce cadre tous les quatre ans (ou cinq ans), comme c’est le cas actuellement.
- Dans nos tâches de gestion, exigeons tout le temps nécessaire pour étudier les dossiers qui nous sont soumis. Désormais, dans l’intérêt de tous, travaillons uniquement sur les contenus et rejetons cet ersatz de démocratie ou de collégialité qui consiste à voter sur des dossiers que, dans le meilleur des cas, nous n’avons pu que survoler. Rien ne nous oblige à nous soumettre à l’idéologie de l’urgence dont se gargarisent le Ministère et les « gestionnaires responsables ».
- Plus généralement, il n’est pas inutile de rappeler que notre vie ne s’arrête pas à l’Université et qu’il est nécessaire de garder du temps libre pour nos familles, nos amis, nos loisirs ou… pour le plaisir de ne rien faire.
Si vous êtes d’accord avec ces principes, signez le texte d’appel à la fondation du mouvement Slow Science. Mais, surtout, prenez votre temps avant de décider de le faire ou pas !
Joël Candau, 29 octobre 2010 (texte publié le 17 juillet 2011)
Egalement :
Vous pouvez allez consultez l'article princept de Eugéne Garfield "Fast science vs. slow science, or slow and steady wins the race" ici
Eugene Garfield est un des scientifiques américains fondateurs de la bibliométrie et de la scientiométrie.




