Vos livres documentent le combat contre la pensée critique et les menaces pesant sur les libertés académiques, en montrant qu’ils n’épargnent pas les démocraties. Les exemples de la France et des États-Unis sont particulièrement éclairants. Pouvez-vous revenir sur la genèse de votre projet d’écriture ?
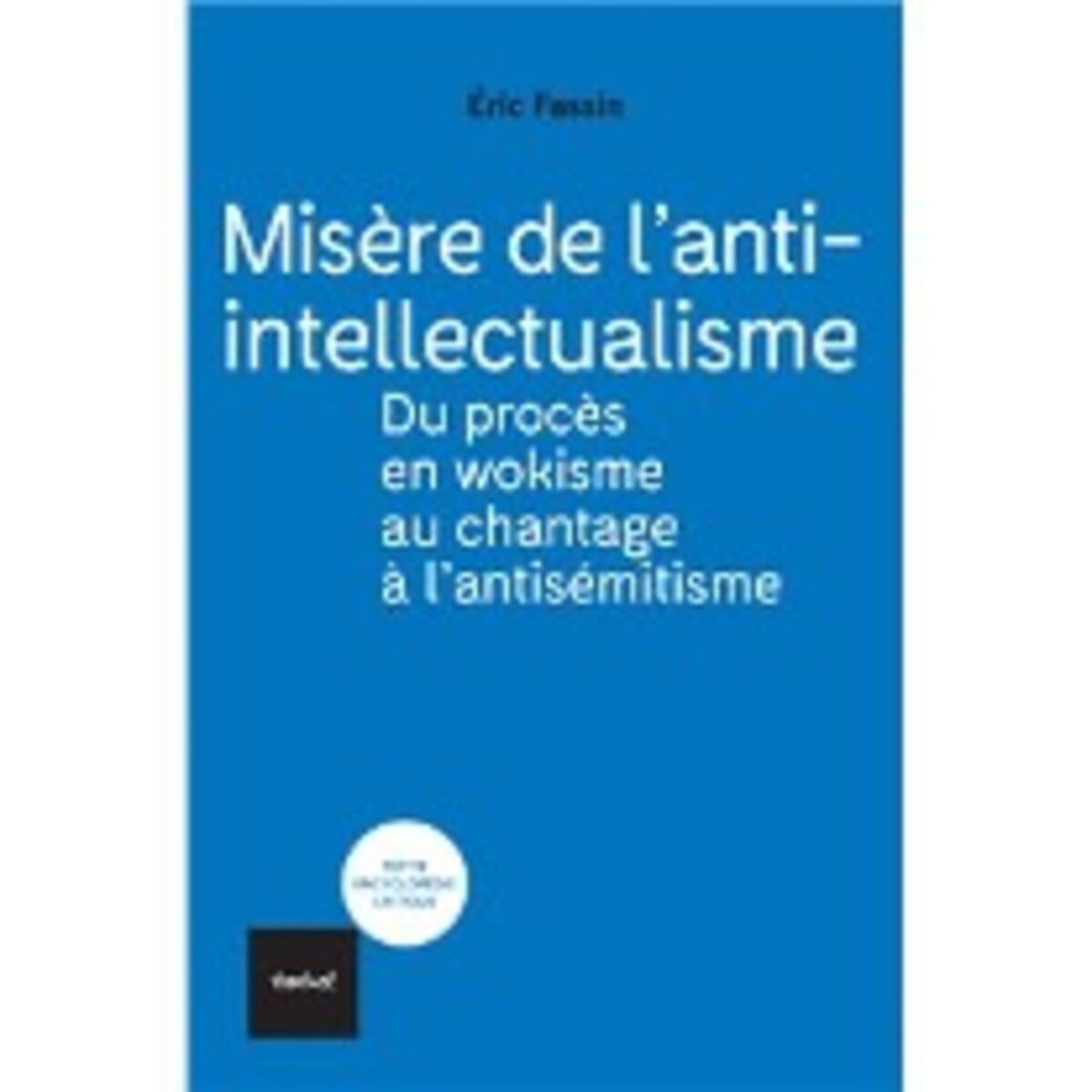
En 2024, j’ai en effet publié deux livres sur « l’anti-intellectualisme » : l’un, au printemps, est en anglais ; l’autre, à l’automne, est en français. Le premier répond à une commande de l’Université Centrale Européenne qui publie 30 essais pour fêter ses 30 ans. Cela m’importait d’autant plus que cette institution, créée à Budapest grâce à un financement de George Soros au lendemain de l’effondrement de l’empire soviétique pour défendre une « société ouverte », en a été chassée par la politique illibérale du premier ministre Viktor Orbán ; elle est désormais basée à Vienne. Cette attaque frontale contre les libertés académiques a commencé par les études de genre, dont l’accréditation a été révoquée en 2018. Cette université s’est donc installée à Vienne l’année suivante.
Engagé depuis le début des années 2010 pour la défense des études de genre, et plus largement des libertés académiques, j’ai jugé important de publier un livre sur l’anti-intellectualisme avec cette maison d’édition. Toutefois, et c’est inhabituel dans ce contexte d’Europe Centrale, il porte sur « la France illibérale ». Au lieu de reconduire l’opposition entre Europe de l’Est et de l’Ouest, censément libérale, pour moi, l’enjeu est de montrer un continuum illibéral. Voilà pourquoi ce qui se passe en France peut intéresser aujourd’hui à l’étranger. Ce livre présente une deuxième singularité pour une presse universitaire : c’est un recueil d’interventions publiques, dans la presse et sur mon blog, traduites et présentées en anglais. Cela participe d’une double revendication intellectuelle : d’une part, articuler travail savant et engagement politique ; d’autre part, prendre pour objet l’actualité en temps réel, puis reprendre ces interventions, comme je l’avais fait en 2012 dans Démocratie précaire, pour dessiner une histoire en train de prendre forme.
La comparaison n’a rien de fortuit. En effet, la dérive illibérale ne date pas d’aujourd’hui. Mais on a vu dans les années 2010 que, depuis les campagnes en Europe et en Amérique latine contre « l’idéologie du genre » (en France, la « théorie du genre »), puis avec celles contre la Critical Race Theory (en France, l’intersectionnalité), et contre le wokisme (en France, l’islamo-gauchisme), c’est le monde universitaire qui est la cible – en Hongrie et en Russie, mais aussi en France et aux États-Unis, en Turquie, au Brésil et aujourd’hui en Argentine. Or, au moment même où sortait mon livre en anglais, on a assisté à une nouvelle salve d’attaques. Depuis le 7 octobre 2023, tant aux États-Unis qu’en France, si les cibles restent les mêmes (la gauche académique et les savoirs critiques), le « procès en wokisme » redouble avec un « chantage à l’antisémitisme ». L’extrême droite conquérante, à l’instar de Donald Trump, s’enhardit jusqu’à prétendre être le meilleur défenseur des juifs.
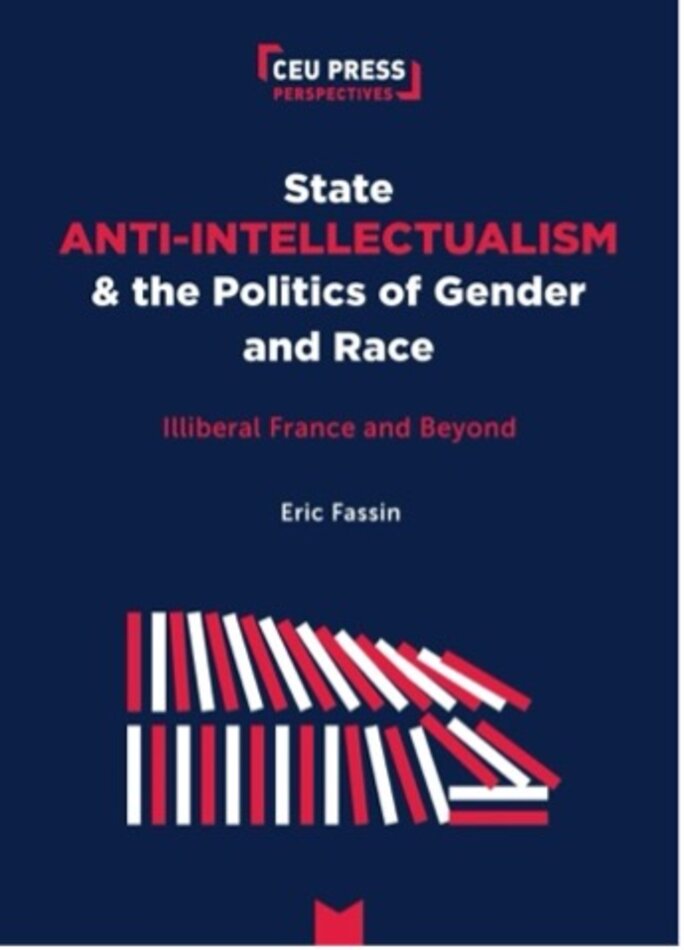
Après avoir publié un texte dans AOC sur les auditions des présidentes d’université à la Chambre des représentants, qui ont acculé trois d’entre elles à la démission, puis rédigé un texte sur les auditions en miroir à l’Assemblée nationale et au Sénat, après « l’affaire de Sciences Po » en mars 2024, il m’a donc paru nécessaire de publier un second livre, non plus rétrospectif mais en temps réel sur l’actualité, comparant la France et les États-Unis (avec l’Allemagne en contrepoint). Il a été rédigé dans la fièvre électorale de l’été. Je souligne que, dans ce domaine aussi, l’histoire ne commence pas le 7 octobre. L’offensive recycle les acteurs et les thèmes qui ont précédé ; mais elle va de plus en plus loin. Liberté d’expression et libertés académiques sont également menacées. Je l’écris en ouverture : hier, c’était « on ne peut plus rien dire » ; aujourd’hui, c’est « taisez-vous ! »
Comment comprendre le procès en « américanisation » régulièrement fait à Sciences po et aux universités françaises ? Vous expliquez, en outre, que rien n’est très nouveau dans la séquence polémique de ces derniers mois. Que nous enseigne-t-elle sur les circulations transatlantiques des idées depuis 40 ans ?
En juin 2020, Emmanuel Macron a lancé son offensive contre le « séparatisme », en accusant dans Le Monde les universitaires d’être « coupables », parce qu’ils encourageraient « l’ethnicisation de la question sociale », de « casser la République en deux ». On sortait alors du premier confinement, et la politique revenait dans la rue avec les grandes manifestations autour du comité Adama Traoré contre les violences policières que le président refuse même de nommer. L’inquiétude du pouvoir, c’est en effet de perdre la jeunesse. Et c’est bien le cas aujourd’hui à propos de Gaza – comme dans beaucoup d’autres pays. Il est vrai que la « démocratisation » de l’enseignement supérieur veut dire que même les jeunes des quartiers peuvent s’emparer d’outils critiques découverts pendant leurs études et s’en servir dans leurs luttes : ainsi, je suis frappé d’entendre les mots « racisme systémique », venus du monde académique, dans des manifestations. Mais il ne s’agit pas d’américanisation : les violences policières contre les jeunes hommes noirs ou arabes, c’est une réalité française dénoncée par le Défenseur des droits.
En France, « l’Amérique » est une figure de rhétorique dans le débat public : c’est « l’épouvantail américain ». Au début des années 1990, j’ai commencé à écrire sur les polémiques états-uniennes et leur écho en France. Il est vrai qu’il y a une circulation internationale, et des mouvements sociaux (Black Lives Matter et #MeToo), et des savoirs critiques (genre, race, intersectionnalité, etc.). Mais chaque pays s’empare de ces combats et de ces mots en fonction de son contexte. L’Amérique latine en est un bon exemple : #NiUnaMenos prend des formes (la chorégraphie de Las Tesis) et des références régionales (comme Rita Segato). Si l’on peut parler d’américanisation, c’est plutôt dans l’importation des polémiques : ainsi, les auditions parlementaires françaises sont une copie des auditions étatsuniennes, comme la campagne contre la cancel culture avait été importée des États-Unis. Pour lutter contre la gauche, c’est surtout la droite qui s’américanise. Mais je mesure le chemin parcouru depuis une trentaine d’années, ainsi que la différence entre la France et les États-Unis. Les néoconservateurs s’engageaient alors dans la bataille culturelle pour l’hégémonie ; aujourd’hui, alors que les médias et l’édition ne cessent de perdre en indépendance, le néolibéralisme autoritaire, soit la convergence des néolibéraux et des néofascistes, tente de réduire la résistance résiduelle d’un monde universitaire exsangue.
Acheter les deux livres :
State Anti-Intellectualism and the Politics of Gender and Race. Illiberal France and Beyond (Central European University Press, 2024)
Misère de l’anti-intellectalisme. Du procès en wokisme au chantage à l’antisémitisme (Textuel, 2024).
Voir aussi le dernier article d’Eric Fassin dans la « Revue des droits de l’homme » (n° 26, 2024), intitulé « Libertés académiques et démocratie : tout dire, mais pas n’importe quoi ».



