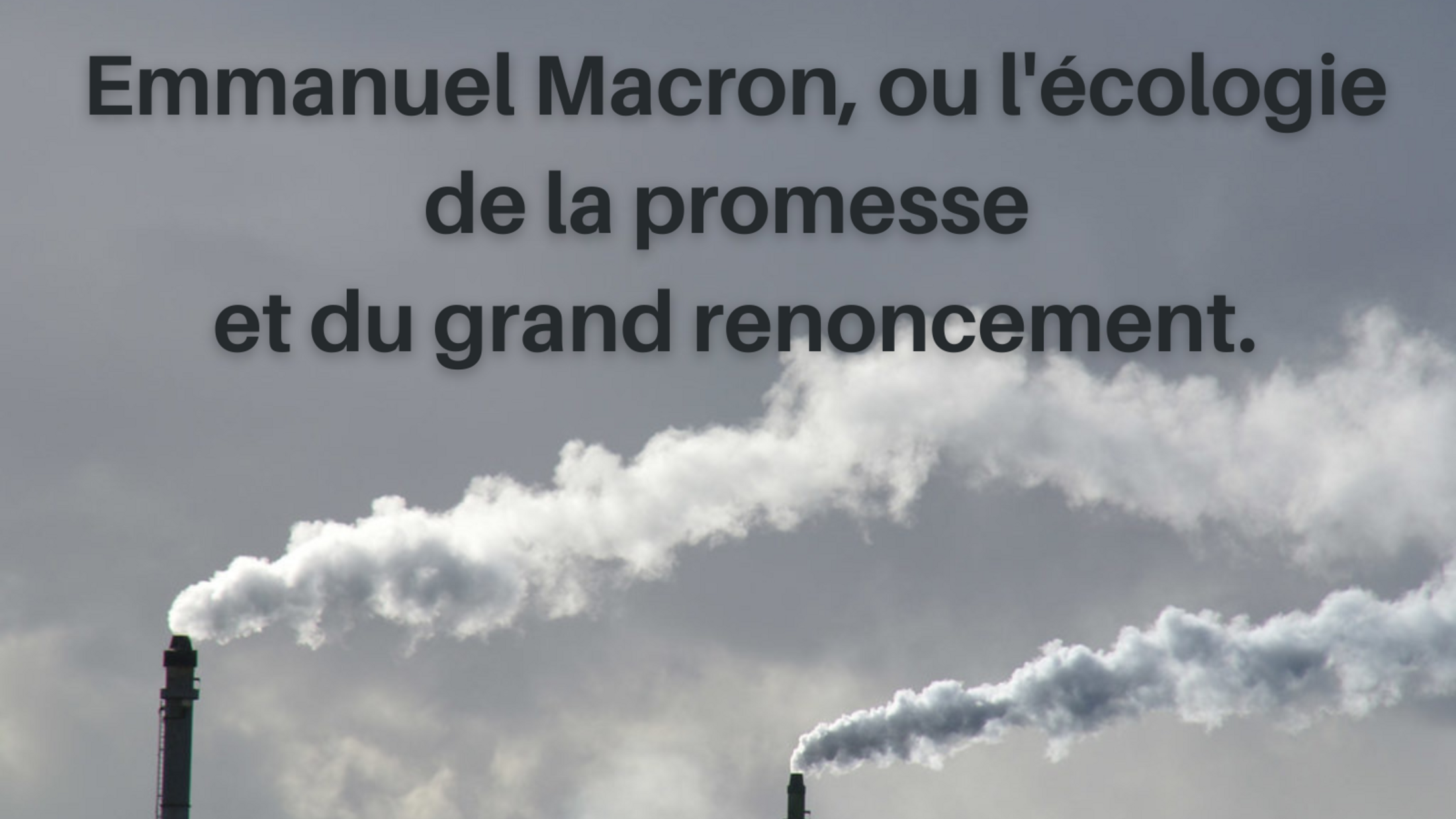Ce billet, rédigé avant les annonces de ce lundi 25 septembre, aurait pu s'intitulée « De quelle écologie Emmanuel Macron est-il le nom ? ».
Ce dimanche 24 septembre, interviewé conjointement pour les JT de 20 heures de TF1 et de France 2 par Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse, Emmanuel Macron nous a montré ce que l'écologie est pour lui : une promesse, parfois ambitieuse, accompagnant ou précédant un grand renoncement.
En témoigne l'annonce, l'une des seules un peu tangibles de cette interview en matière d'écologie, sur la fermeture des centrales à charbon d'ici à … 2027. Eradiquer le charbon est vital. Mais cette annonce est un tour de passe-passe. Elle revient en effet à recycler celle datant de la campagne électorale de 2017 qui programmait la fin du charbon pour la fin du quinquennat, soit 2022. Cette promesse n'a pas été tenue, puisque l'exécutif a décidé de relancer par deux fois, au cours des étés 2022 puis 2023, les deux dernières centrales à charbon françaises. Ainsi, le 24 août dernier, l'exécutif prolongeait encore leur fonctionnement, et E. Macron vient d'annoncer qu'il se poursuivrait jusqu'en 2027. Présenter cette annonce comme une mesure exemplaire en Europe alors que l'arrêt du charbon aurait du être effectif depuis 2022 est plus que saugrenu : c'est un report de 5 ans, au moins.
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, les promesses, parfois ambitieuses en matière écologique, ont systématiquement été suivies de grands renoncements :
- promesse du MakeOurPlanetGreatAgain en réponse à Donald Trump décidant de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, mais grand renoncement à faire du climat la priorité n°1 de la diplomatie française ;
- promesse de l'interdiction du glyphosate d'ici à 2020 puis grand renoncement à l'appliquer sous la pression des lobbys industriels et agricoles (lire cette tribune) ;
- promesse de la Convention citoyenne sur le climat mais grand renoncement par l'enterrement en bonne et due forme de la quasi-totalité de ses mesures les plus volontaristes et efficaces
- annonce d'un second « quinquennat écologique » mais négation de l'urgence climatique autour de la phrase « « Qui aurait pu prédire la crise climatique ? » (lire ce post de blog)
- etc
En parallèle, Emmanuel Macron et son gouvernement ont multiplié les formules oratoires visant à rendre compte de leur vision de l'écologie : « écologie de production », « écologie du quotidien », « écologie de l’apaisement », « écologie de proximité », « écologie positive », etc. Ce dimanche 24 septembre, c'est une « écologie à la française, une écologie de progrès » qui a été mise en avant par E. Macron, poursuivant cette perpétuelle recherche de signifiants positifs visant à ce que l'opinion publique adhère au projet.
Derrière ces formules qui, la plupart du temps, ne signifient pas grand chose et cachent mal les double-discours, on retrouve quelques-uns des principes supérieurs qui ont guidé la politique écologique d'E. Macron depuis 2017 et qui bloquent toute avancée majeure :
- l’impératif de croissance est non-négociable,
- les normes contraignantes envers les industriels (pétro-chimie, agro-industrie, finance etc) et les entreprises multinationales ne sont pas envisageables,
- la compétitivité-prix est indépassable,
- la croyance en de nouvelles technologies salutaires est sans limite,
- la confiance dans le marché et les entreprises est démesurée,
- une responsabilité individuelle indifférenciée est confiée à chacun d'entre nous, que l'on soit milliardaire ou smicard, trader ou tricard,
Dans la réalité, cela ne fonctionne pas. Parce que la procrastination, les hésitations et les renoncements nourrissent des échecs patents. Mais aussi, et surtout, parce que ces principes incarnent le refus manifeste, entêté et coupable de changer de logiciel idéologique face à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité.
Dès que les enjeux deviennent sérieux, dès qu’il s’agit de prendre des décisions qui vont toucher à la puissance des lobbies, aux pouvoirs et droits acquis des multinationales ou aux règles qui organisent l’économie, Emmanuel Macron et son gouvernement tergiversent, reportent à plus tard ou limitent leurs ambitions en se conformant aux exigences des acteurs économiques et financiers. Aux promesses succèdent des grands renoncements.
Or, quand les équilibres de la planète sont prêts à rompre, quand le seuil de l’irréversible est sur le point d’être franchi, quand les catastrophiques climatiques et écologiques s'empilent, on attend des chefs d’Etat et des élus des pays prétendant être à la pointe du combat écologique et climatique qu’ils prennent des décisions courageuses et visionnaires, quitte à perturber le jeu économique. On attend un véritable sursaut politique.
Mais le sursaut ne vient pas. A toujours repousser à demain ce qui devrait être fait aujourd’hui, à ne jamais prendre les précautions et les régulations qui s’imposent, à toujours conforter les idées reçues, l'écologie d'Emmanuel Macron, si fondamentaliste dans son obsession de ne surtout pas perturber le jeu économique et les droits acquis des acteurs économiques, nous enferre dans une impasse.
Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait fait de la transition écologique le « combat du siècle » promettant que « le quinquennat serait écologique ou ne serait pas » (16 avril 2022, Marseille). On a donc le droit de croire, comme l'on croit en Dieu ou aux esprits, que la planification écologique présentée ce lundi 25 septembre va enfin changer la donne. L'expérience tirée de sept années d'Emmanuel Macron nous enseigne le contraire.
Il est pourtant urgent de proposer aux jeunes d'être la première génération de protecteurs face aux destructions en cours : protéger la biodiversité et le vivant, lutter contre le réchauffement climatique, réduire les pollutions, prendre soin des plus précaires et vulnérables. Voilà un horizon et une espérance collective légitimes avec laquelle embarquer la jeunesse et la population.
Maxime Combes, économiste et auteur de Sortons de l'âge des fossiles ! Manifeste pour la transition (Seuil, 2015) et co-auteur de « Un pognon de dingue mais pour qui ? L’argent magique de la pandémie » (Seuil, 2022).
Vous pouvez me retrouver ici sur Twitter, ici sur Facebook, ici sur Instagram et ici sur Linkedin ici sur Mastodon, ici sur Bluesky, ici sur Telegram
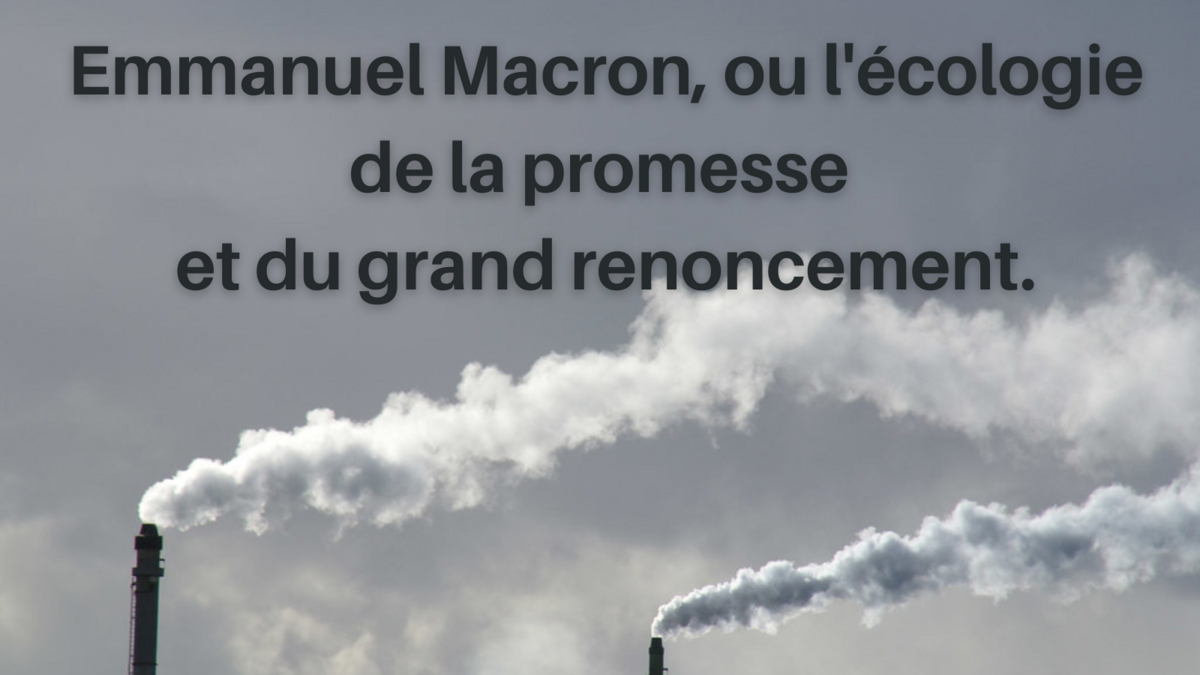
Agrandissement : Illustration 1