En ouverture de la conférence environnementale, lundi 25 avril, François Hollande a déclaré que la France allait « développer le marché des green bonds, des obligations vertes », et que l'Etat demanderait « aux banques publiques, la Caisse des Dépôts, l’AFD, mais aussi la Banque Publique d’Investissement (BPI), de lancer des obligations vertes, dédiées à des projets d’investissements environnementaux ». Les collectivités sont invitées à « faire de même ». Pascal Canfin, directeur général de WWF France s'est réjoui dans les médias en disant que « Paris pourrait devenir leader de la finance verte » et les médias – notamment l'AFP – ont emballé le tout avec ce titre, « la France premier pays à émettre des "obligations vertes" ».

Agrandissement : Illustration 1

La France n'est PAS « le premier pays à émettre des obligations vertes »
Débarrassons-nous d'abord de l'anecdotique. Quelle que soit la façon dont on regarde le secteur des obligations vertes, non, la France n'est définitivement pas le premier pays à en émettre. Par exemple, la Banque agricole de Chine, qui est une banque détenue par l'Etat chinois1 et qui joue un rôle d'investisseur public dans l'économie chinoise (tout comme la Caisse des dépôts ou la BPI), a émis sa première obligation verte, cotée sur le London Stock Exchange, en octobre 2015. La Nouvelle banque de développement, basée à Shangai et adossée aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ainsi que la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, adossée à l'Etat chinois, se sont également engagées à venir rapidement sur le marché des obligations vertes. Par ailleurs, si on élargit aux « climate bond », qui sont une forme d'obligations vertes, l'AFD elle-même a levé un milliard d'euros en 2014. Emettre une obligation verte n'est donc pas nouveau pour les institutions publiques ou para publiques.
Il est vrai que le gouvernement planchait sur la possibilité d'émettre des obligations vertes souveraines, c'est-à-dire que le Trésor finance une partie du budget national par l'émission directe de ces obligations d'un nouveau type, avec la signature de l'Etat français. Malgré de nombreux rendez-vous entre le ministère de l'environnement et Bercy, et malgré de premières annonces (voir cet article des Echos), François Hollande n'a pas annoncé lors de la conférence environnementale un emprunt d'Etat vert ou l'émission d'obligations vertes souveraines.Le Trésor y est plutôt défavorable et c'est contraire aux principes d'organisation du budget de l'Etat qui fonctionne selon un principe intangible : que ce soient les impôts collectés ou les emprunts contractés, ils ne peuvent être affectés à des dépenses précises, ciblées. Ce qui rend impossible l'émission d'obligations dont il serait bienvenu de savoir précisément ce qu'elles financent, si on leur accole le terme "vert".
Si l'on regarde maintenant l'ensemble des acteurs financiers d'un pays, c'est également la Chine qui est en tête au premier trimestre 2016, selon un rapport de l'agence Moody's publié récemment. Les institutions chinoises ont émis 7,9 milliards de dollars d'obligations vertes au premier trimestre, soit près de la moitié du total mondial (16,9 milliards). En deuxième place, on retrouve les Etats-Unis avec 3,4 milliards de dollars d'obligations vertes, soit 20 % du volume total mondial. La France arrive beaucoup plus loin.
Qu'est-ce qu'une obligation verte et que représente le marché ?
Une obligation verte est une obligation classique : un acteur de marché emprunte auprès d'investisseurs contre le paiement d'un intérêt jusqu'à la date prévue pour le remboursement intégral de la somme empruntée. Seule différence, cette obligation est dite verte, ou climat (les « climate bonds »), car elle est supposée orienter les investissements privés vers des projets compatibles avec la protection de l'environnement ou du climat. C'est un (petit) marché en plein essor. Alors qu'il ne représentait qu'à peine 4,5 milliards de dollars en 2012, le marché obligataire « vert » aurait atteint 42,4 milliards de dollars en 2015 et pourrait accrocher les 70 milliards en 2016, selon Moody's. Ce qui reste néanmoins une goutte d'eau au regard du volume du marché obligataire international évalué à près de 100 000 milliards de dollars.

Agrandissement : Illustration 2

Une obligation verte est-elle vraiment verte ?
(le reste de l'article est très largement extraite du livre Sortons de l'âge des Fossiles, manifeste pour la transition, Seuil, Octobre 2015)
Les promoteurs des obligations vertes les présentent comme des instruments adaptés et efficaces pour financer la transition énergétique et la lutte contre les dérèglements climatiques2. À y regarder de plus près, ce n'est pas aussi simple. À ce jour, il n'existe pas de critères clairement établis, universellement acceptés et contraignants, permettant de distinguer les projets compatibles avec l'environnement ou le climat de ceux qui ne le sont pas. Seuls des engagements volontaires non contraignants ont été rédigés, pour les obligations vertes3, ou sont en cours de rédaction4, pour les obligations climat. Les entreprises, les banques de développement et les collectivités qui se financent grâce aux obligations vertes font donc un peu ce qu'elles veulent. Aucune garantie n'existe sur le fait que ces financements aillent au bon endroit : chaque émetteur peut déterminer tout seul ce qui est vert de ce qui ne l'est pas.
Ces engagements volontaires – ou standards pour utiliser le terme du milieu – appliquent leurs propres critères. Difficile donc de comparer les projets, d'identifier clairement les objectifs et de s'assurer que les résultats annoncés sont bien atteints et contrôlés de façon indépendante. Un manque de cohérence qui est aujourd'hui décrié par les investisseurs eux-mêmes. Ainsi, au moment de la COP21, 27 investisseurs mondiaux, représentant quelque 11 200 milliards de dollars d’actifs gérés, ont cosigné la « Déclaration de Paris sur les obligations vertes » réclamant un standard mondial pour les obligations vertes. De son côté, Moody's vient ainsi de rendre public une méthodologie spécifique pour « noter » les obligations vertes : comme pour chaque obligation, une note sera donnée en fonction de la capacité de l'émetteur de rembourser sa dette obligataire tandis qu'une simple « opinion » (« Green bond assessment »), à la demande de l'émetteur, pourra être rendue publique par l'agence de notation. Moody's semble d'ailleurs avoir du mal à trouver des secteurs « verts ».
EXEMPLE : GDF-Suez, nouvellement Engie, s'est vanté de battre tous les records en 2014 avec une émission obligataire verte de 2,5 milliards d'euros. Les investisseurs éthiques ou socialement responsables se sont jetés sur l'occasion. Malaise. En plus d'être une des entreprises françaises les plus polluantes, Engie pourrait utiliser ce financement pour les grands barrages qu'elle construit en Amazonie (Jirau, bassin du rio Tapajós, etc.) et qui n'ont vraiment rien d'écolo (voir cet article de l'Observatoire des multinationales). Déforestation, non-respect des droits humains, désastres environnementaux en aval et en amont (inondations, assèchement de rivières, etc.), les conséquences de ces grands barrages sont dramatiques pour les populations et les écosystèmes locaux. Le vert, à la moulinette de la finance, pourrait donc prendre d'autres teintes.
Faut-il confier la transition écologique aux marchés financiers ?
À peine lancé, le marché des obligations vertes est donc déjà sous le feu des critiques. Il n'apporte aucune garantie aux projets qui sont supposés être financés. Les obligations vertes sont un véhicule idéal pour que les multinationales sales mènent de vastes opérations d'écoblanchiment – comme le montre le cas d'Engie – tout en refusant de faire basculer une part significative de leurs activités et de leurs financements vers une économie post-fossile.
Plus important encore. La finance verte ne s'arrête pas aux obligations puisque la titrisation de prêts verts, à travers les ABS (Asset Back Securities)5 bas carbone, est soutenue par les institutions6. Il s'agit également de financer les innovations « vertes » par des fonds de capital-risque issus de l'ingénierie financière traditionnelle, ce qui revient à vouloir confier le développement de solutions innovantes à des vautours de la finance qui réclament des taux de rentabilité financière totalement insoutenables.
La crise financière débutée en 2007-2008 aurait dû délégitimer les capacités de la finance à s'occuper de climat et de transition écologique. C'est tout l'inverse qui se produit et se renforce. Comme l'a montré la longue histoire des crises financières – il y a des krachs financiers tous les quatre ans en moyenne – l'innovation financière est sans limites. Y compris en matière de climat et de transition. Tolérer le développement des marchés financiers dans des domaines clefs tels que l'énergie et le climat paraît insensé. C'est la force de l'illusion financière que de laisser entendre que la transition écologique pourrait être mise en œuvre à l'aide de nouveaux dispositifs de marché, innovants bien sûr. Le capital s'étend à la nature, à travers une conception utilitariste des écosystèmes dans lesquels nous vivons. La nature devient « capital naturel » et cela tombe bien car le capital naturel est vert, comme le dollar.
Maxime Combes, économiste et membre d'Attac France.
Auteur de Sortons de l'âge des fossiles ! Manifeste pour la transition, Seuil, coll. Anthropocène. Octobre 2015
@MaximCombes sur twitter
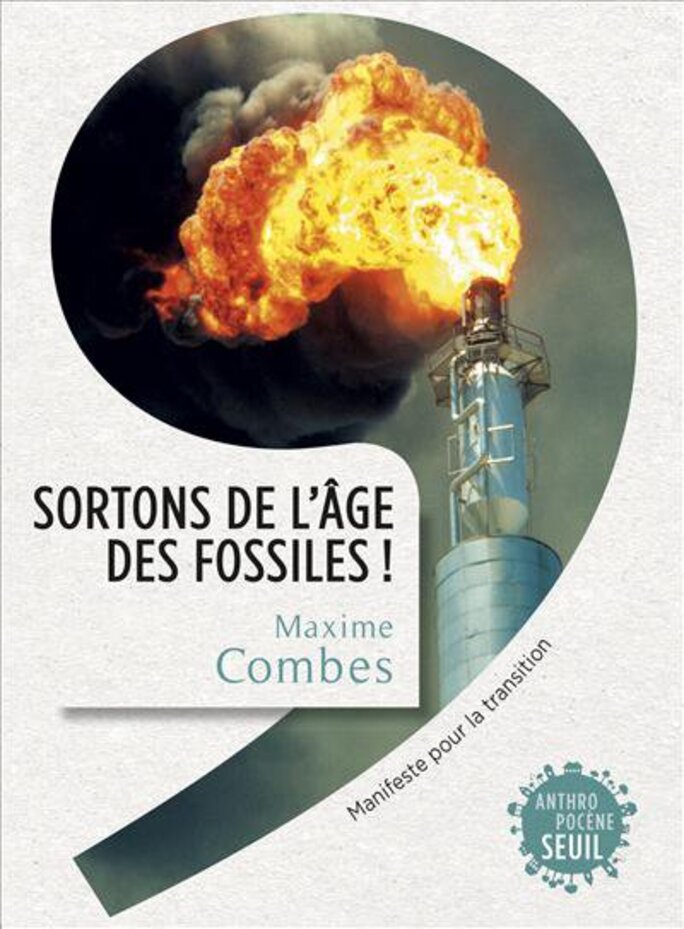
NOTES :
1Elle est détenue notamment à 41% par le Central Huijin Investment Ltd. (entreprise d'investissement détenue par le gouvernement) et à 40 % par le ministère des finances chinois, etc.
2Marc-Antoine Franc, « Financer la transition énergétique grâce aux “green bonds”», Le Monde.fr, 22 novembre 2014, www.lemonde.fr/idees/ article/2014/09/22/financer-la-transition-energetique-grace-aux-green- bonds_4492339_3232.html.
3« Green Bond principles 2014 : voluntary process guidelines for issuing Green Bonds», 13 janvier 20104, www.ceres.org/resources/reports/green- bond-principles-2014-voluntary-process-guidelines-for-issuing-green-bonds/ view.
4Climate Bonds initiative, « Climate Bonds Taxonomy », www.climate- bonds.net/standards/taxonomy.
5Un Asset Backed Security (ABS) est une valeur mobilière dont les flux sont basés sur ceux d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs. La titrisation est le principal vecteur de création de ces actifs.
6Rachida Boughriet, « Conférence environnementale : cap vers la Confé- rence Paris Climat 2015 », Actu-Environnement, 26 novembre 2014, www.actu- environnement.com/ae/news/table-ronde-conference-environnementale- sommet-climat-paris-2015-23326.php4.



