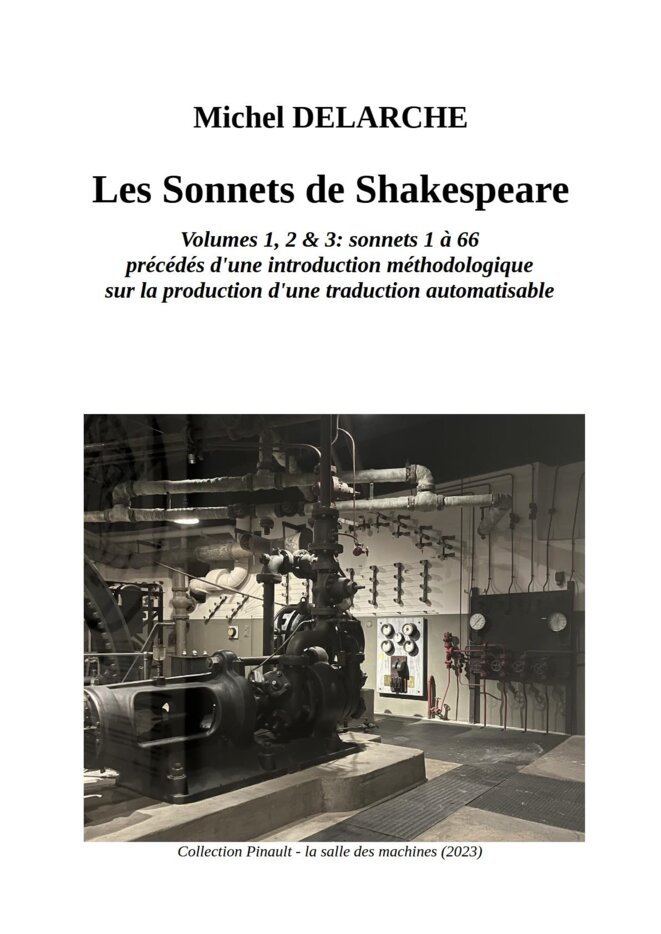Cet ouvrage utilise les techniques de la micro-histoire, exploitant les archives judiciaires et notariales pour se concentrer sur quelques parcours de vie, ce qui fait à la fois son intérêt et sa limite, dans la mesure où il est difficile de savoir dans quelle mesure les exemples proposés sont suffisamment représentatifs d'une situation générale en un lieu et à un moment donné.
Néanmoins il permet de percevoir la dynamique de l'émancipation et ses fluctuations selon les rapports de forces politiques, les périodes et les lieux.
En effet entre les premières mesures libératrices prises lors des assemblées de 1813 et l'abolition totale et définitive de l'esclavage avec la Constitution libérale d'Alberdi en 1853, il s'est écoulé pas moins de 40 ans (et l'on peut rappeler au passage qu'au Brésil voisin l'esclavage ne fut aboli qu'en 1888.)
L'émancipation commença par la loi dite "des ventres libres" stipulant dès 1812 au Chili et 1813 en Argentine que les fils et filles d'esclaves seraient libres de naissance, mais que par respect du sacro-saint droit de propriété et du principe juridique de non-rétroactivité, les esclaves acquis et leurs descendants nés avant la promulgation de cette loi resteraient la propriété de leurs maîtres et garderaient donc le statut d'esclave.
En réalité, les nouveaux-nés bénéficièrent jusqu'à leur majorité d'un statut intermédiaire de "liberto": leurs mères restant esclaves, les enfants restaient soumis à l'autorité du patron et devaient à partir de 14 ans jusqu'à leur majorité lui fournir des services domestiques afin de compenser le coût de leur entretien.
Pour les adultes, le statut de "liberto" pouvaient s'acquérir de différentes manières: par émancipation à titre gratuit (des propriétaires philanthropes acquis aux idéaux universalistes des Lumières payaient d'exemple en émancipant leurs esclaves) mais ils étaient loin de constituer la majorité et la plupart des libérations se négociaient contre rémunération (les couvents catholique faisaient partie des propriétaires d'esclaves exigeant d'importantes sommes d'argent en échange d'une "lettre de liberté" attestant du changement de statut). Ceci donna lieu à diverses opérations dont les archives conservent la trace: des hommes libres payant la libération des femmes esclaves qu'ils comptaient épouser, par exemple, et des contestations étaient portées devant les tribunaux sur le montant à verser, car le paiement se faisait souvent en quotas étalés sur plusieurs années et les documents en attestant pouvaient s'être perdus.
L'autre principale façon de conquérir la liberté était de servir dans les guerres d'indépendance, mais il fallait cinq ans de service pour devenir libre. Les soldats noirs étaient généralement ségrégés dans des bataillons distincts, à la notable exception des fameux "gauchos de Güemes" qui mêlaient toutes les races et où la bravoure et la dextérité à cheval comptaient davantage que la couleur de la peau.
L'abolition de la traite à partir de l'Afrique fut décidée au même moment et fut assortie de mesures interdisant l'import-export indirect d'esclaves depuis les pays, et en particulier le Brésil ou l'Uruguay, qui maintenaient un important trafic transatlantique, d'une part, et où fonctionnaient des circuits de revente plus ou moins clandestins vers Buenos Aires ou Rosario, d'autre part.
Ansi, Candioti mentionne une action en justice entamée par une esclave nommée Petrona, originaire de Santa Fe, et que sa propriétaire voulait emmener avec elle à Montevideo. Petrona s'appuyait sur les interdictions de transfert vers des pays où les conditions dont les esclaves bénéficiaient étaient moins favorable qu'en Argentine pour contester le droit de sa patronne à la faire changer de pays.
Inversement, un certain nombre d'esclaves brésiliens profitèrent de la situation pour s'évader et se réfugier en Argentine où ils devenaient automatiquement libres.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser au vu de l'aspect physique de la population actuelle de l'Argentine, qui reflète à la fois l'immigration européenne massive des années 1870-1920 à Buenos Aires et dans les autres grandes villes, et le métissage avec les Amérindiens dans les campagnes des provinces du Nord, les Noirs étaient nombreux dans le vice-royaume de La Plata: selon les provinces, ils représentaient à la veille de l'indépendance de 30 à 50% de la population totale et seulement une fraction (environ 10% de la population) étaient des esclaves, les autres étant des Noirs libres vivant dans les zones rurales comme dans les villes.
La liberté chèrement acquise, qu'elle fût payée en pesos ou au prix du sang, ne signifiait pas forcément l'égalité des droits: de nombreuses provinces comme Santa Fe refusèrent aux Noirs, même libres, le droit de voter aux élections et cela donna lieu à des controverses au fil des années 1820 et 1830 entre les libéraux (au sens politique) et les conservateurs.
Quant au droit de se porter candidat à une élection, il n'était accordé qu'aux citoyens pouvant se prévaloir du statut de propriétaire, ce qui revenait à interdire l'expression politique autonome des classes populaires, dont faisaient partie la très grande majorité des anciens esclaves.
L'assimilation des Noirs libres progressa néanmoins: Candioti donne l'exemple d'un ancien militaire noir devenu officier nommé Antonio Porobio qui avait acquis des biens immobiliers et le titre honorifique de "Don" synonyme alors d'un statut social assez élevé.
Des réseaux d'entraide fonctionnaient également au sein des "nations africaines" et les archives témoignent que pendant au moins deux générations la mémoire des origines s'était conservée, soit à l'échelon d'une région (les deux principales étant l'Angola et la Guinée) soit même à l'échelon des "nations" c'est-à-dire des groupes ethno-religieux dont certains des Noirs se réclamaient (avec des mentions telles que "negra libre de nacion lubolo" qualifiant la seconde épouse de Porobio).
Dans les années 1840, le débat idéologique au sein des classes dominantes blanches s'intensifia et malgré les combats d'arrière-garde des plus conservateurs, le libéralisme finit par l'emporter, suivant l'exemple donné par les mesures d'abolition déjà prises dans d'autres pays d'Amérique Latine puis en Europe entre 1820 et 1850 (Chili dès 1821, Costa Rica, Mexique en 1830, Uruguay, puis Angleterre et France).
On peut voir que la précocité de l'abolition définitive dépendait du poids économique de l'esclavage et donc de l'influence des groupes de pression cherchant à le maintenir le plus longtemps possible: ainsi, les planteurs des Antilles convainquirent Napoléon de le rétablir en 1802, alors qu'au Chili ou au Mexique, contrairement aux puissances coloniales européennes, il n'existait pas un lobby esclavagiste puissant.