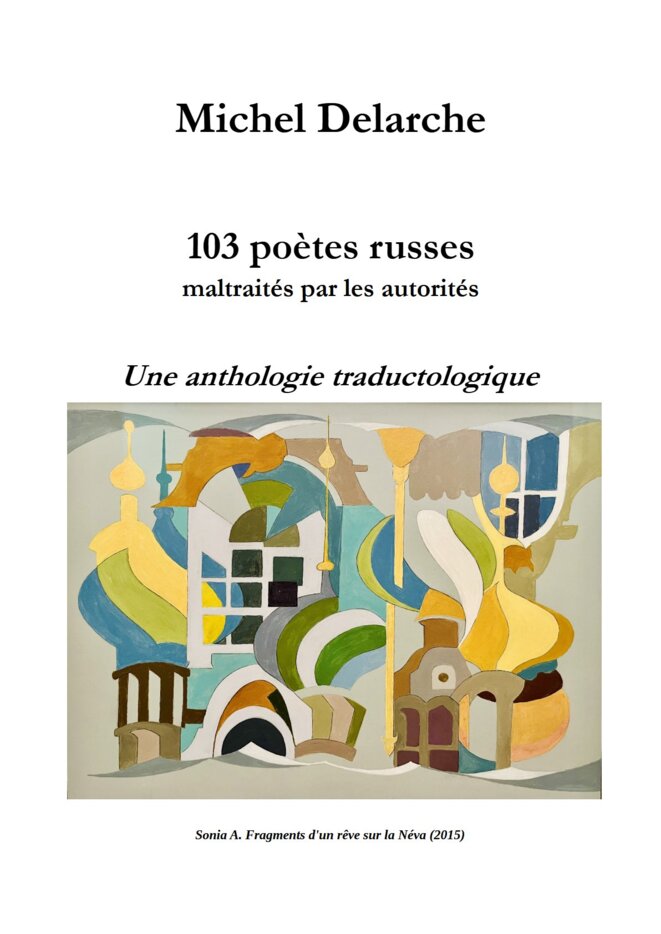Au début de "La Raison populiste" Laclau reprend pour s'en démarquer deux critiques usuelles du populisme:
1°) le populisme ne propose pas une idéologie structurée mais un schéma simpliste qui obscurcit l'analyse des rapports sociaux,
2°) le discours populiste est toujours "vague" et "ambigu" dans ses déterminations et donc démagogique et confusionniste par nature
Laclau explique que la rationalité du populisme provient de sa nature éminemment politique: la simplification et la polarisation du débat n'est en soi ni de droite ni de gauche, mais répond à une motivation stratégique de cristallisation et de clarification des enjeux que l'on juge essentiels dans une conjoncture politique donnée: le point commun entre un populiste de droite et un populiste de gauche est la mise en place d'une extrémisation de la rhétorique du clivage (Laclau cite l'exemple du slogan péroniste "Ou Braden ou Peron"). Il s'ensuit que, pour susciter une large adhésion par-delà les autres conflits qui traversent le corps social le discours populiste doit rester par ailleurs nécessairement sous-déterminé, d'où l'impression de vague et de flou, voire de confusion qu'il suscite.
Dans cet ouvrage, Laclau fait sienne sans la citer explicitement une vision brutalement schmittienne du politique comme étant avant tout le moment de la désignation de l'ennemi. Par rapport aux analyses plus subtiles proposées par Chantal Mouffe dans "The Democratic Paradox" à la fin des années 90s (par exemple la distinction qu'elle opère entre le "politics without enemies" qu'elle promeut et le "politics without adversaries" qu'elle reproche au blairisme) cette approche du populisme par Laclau privilégie un schématisme régressif.
En voulant à toute force embrasser conceptuellement toutes les formes de pratiques discursives populistes selon un seul et même paradigme schmittien, Laclau se prive de penser la distance qui les sépare du modèle de démocratie vivace envisagé par Mouffe. Or ce qui différencie le discours populiste de droite du discours populiste de gauche, c'est précisément le choix de l'ennemi et le caractère inclusif ou exclusif des variétés de populisme qui en découlent: un populiste de gauche ciblera toujours l'étroite minorité des dominants économiques (les 0,01 % d'Occupy Wall Street, ou bien les 500 familles évoquées par G. Filoche l'autre jour sur Arte, ou encore les "banksters" honnis par la gauche britannique) alors qu'un populiste de droite aura tendance "à ratisser large" et à définir l'ennemi de manière beaucoup plus multi-dimensionnelle (et non pas essentiellement selon des critères socio-économiques).
Le schéma de clivage proposé par le discours populiste de droite comporte toujours une forte composante nationaliste ("les vrais Français", "Braden ou Peron", "Il poppolo d'Italia" dans la rhétorique de Mussolini) ou bien inclut dans sa définition de l'ennemi de plus ou moins larges pans de la population générale sur une base ethnique, religieuse ou idéologique (les Juifs, les Francs-Maçons, les Rouges, les Arabes, les cathos, les petits blancs...). En ce sens, certains discours "de gauche" comme les éructations de Mélenchon à l'encontre des "Bonnets Rouges" relèvent à mon avis bel et bien du populisme de droite (plus généralement, toute condamnation anathématique ne procédant pas d'une analyse argumentée est pour moi un discours de droite par nature quelle qu'en soit l'intention).
Evidemment lorsque le discours nationaliste vient recouper la rhétorique anti-impérialiste, l'ambigüité va jouer à plein et le populiste de droite pourra passer un temps (voire longtemps) pour un populiste de gauche (mais pour moi "Braden ou Peron" demeure un slogan de droite là où "Rockfeller (ou Dupont ou Morgan...) ou Peron" aurait pu être un slogan de gauche: car même si l'ambassadeur américain Braden promouvait les intérêts des capitalistes américains, il représentait aussi la nation américaine dans son ensemble.)
Bref, la vision implicitement schmittienne du politique que Laclau adopte d'emblée brouille les repères au lieu de lui permettre d'enrichir et d'affiner son analyse. En revanche, l'idée que le manque de détermination fine du discours populiste soit indissociable de la pratique politique me semble tout à fait recevable, mais cette propriété de l'instance du politique (afin de pouvoir s'adapter à l'instabilité des rapports de force et à la fluidité des situations) ne me semble pas spécifique aux populistes.
Enfin, il reste concevable d'adopter un discours politique clivant sans le réduire à une rhétorique populiste.