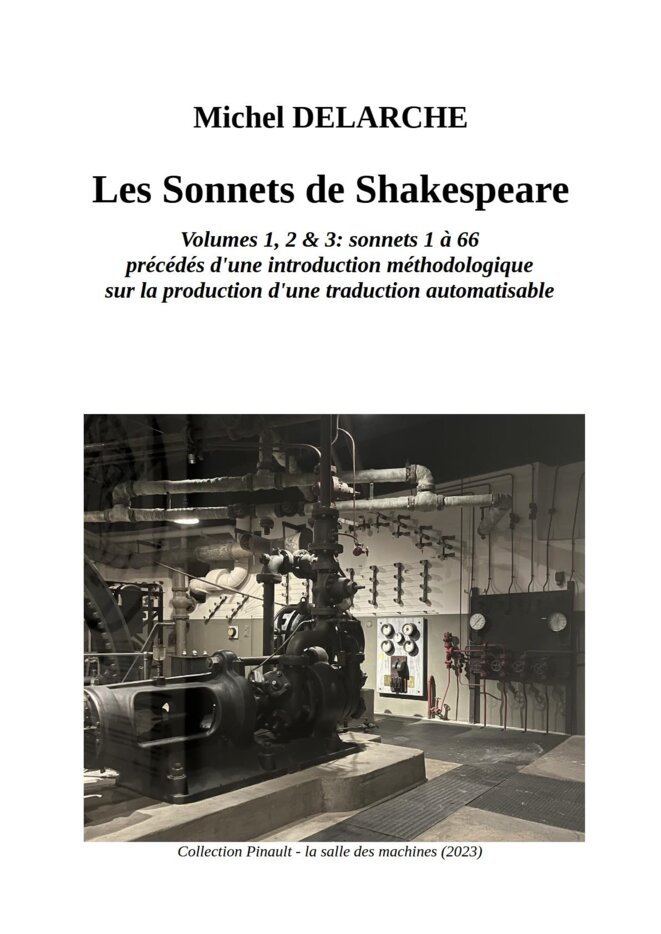La vision militariste de la politique qui a nourri les modalités d'action les plus brutales de ses multiples dictatures du 20ème siècle mais aussi de leurs opposants révolutionnaires plus ou moins tiers-mondistes plonge ses racines dans une tradition réactionnaire de type national-catholique dont les chantres locaux (Galvez, Lugones, Marechal et bien d'autres) furent les équivalents de Barrès ou Maurras chez nous à la même époque.
Dès le début des années 1920, les ultras de la droite catholique antisémite et anti-libérale agitent volontiers l'épouvantail bolchévique et des groupes de jeunes nationalistes de bonne famille vont sans complexe patrouiller dans les quartiers et faire le coup de feu aux côtés des policiers et militaires lors de la Semaine Sanglante de 1919 et des périodes ultérieures de répression sauvage des manifestations ouvrières contre les bas salaires et les mauvaises conditions de travail.
Bien que la révolution russe ait été perçue avec une certaine sympathie par les ouvriers argentins, les plus politisés d'entre eux n'étaient non pas communistes mais socialistes ou anarchistes (la plupart étaient des immigrants de première ou seconde génération d'origine italienne ou espagnole).
Le communisme, tout comme le rugby, n'est jamais devenu un sport populaire en Argentine: le PC n'a jamais dépassé 1% des voix et son influence est restée confinée aux milieux intellectuels (artistes et universitaires). Jusqu'à l'émergence du péronisme, la masse des ouvriers argentins était peu politisée et l'influence du catholicisme conservateur et patriarcal facilitera son adhésion idéologique au fascisme dans sa version péroniste.
Un premier tournant se produit dans la seconde partie des années 20 et se développe tout au long des années 30 sous l'influence des « modèles » proposés par les premières dictatures fascistes européennes (Primo de Rivera, Mussolini, Salazar) et le catho-nationalisme des élites s'ouvre à la plèbe et commence à intégrer la problématique de la « question sociale » sur un mode corporatif-paternaliste fondé sur une vision organique de la société (vision également très influencée par ce qu'est alors la doctrine sociale de l'Église).
Il produit les même discours que l'on trouve encore chez nous dans certains groupes l'extrême-droite prônant comme Peron une « 3ème voie » entre capitalisme et communisme (et mobilisant les termes de « travaillisme » ou « solidarisme »), s'appuyant sur un État fort, pour remplacer la lutte des classes par une gestion verticalisée des syndicats, d'une part, et le suffrage universel par des corps intermédiaires corporatifs (comme dans l'Italie de Mussolini, le Portugal de Salazar ou l'Espagne de Franco), d'autre part.
Un autre élément-clé du discours nationaliste est un anti-impérialisme virulent (lorsque les fascistes argentins organisent leurs propres défilés du 1er mai, un de leurs rites favoris est de brûler des drapeaux britanniques).
Les méthodes para-militaires de l'extrême-droite se renforcent à partir des années 30 avec la dictature d'Uriburu et les jeunes voyous en chemises grises de l'Alliance Libératrice Nationale (ALN) obtiennent même pendant un temps le privilège d'aller s'entraîner le dimanche au maniement des armes dans les casernes et consacrent le reste de leurs loisirs à alterner propagande de rue, défilés en uniforme et provocations diverses visant à « casser du judéo-bolchévique » selon la terminologie en usage, comme plus près de nous un Longuet, un Madelin, un Devedjian et autres petits fachos d'Assas et d'ailleurs.
L'ALN est le vivier d'extrême-droite nationaliste d'où sortiront tous les principaux adeptes d'une militarisation violente de la vie politique argentine: la triple A de sinistre mémoire, mais aussi les guévaristes de l'ELN-ERP, les Montoneros ou les autres groupes ultra-nationalistes des années 60 (Tacuara etc.) sont tous des héritiers de ce groupement (qui n'a jamais dépassé 10 000 adhérents mais à qui ses liens étroits avec la hiérarchie militaire et l'oligarchie conservatrice ont garanti une forte influence et une longue impunité au cours des années 40 et 50, jusqu'à la chute de Peron.)
Pour comprendre par quels processus certains de ces nationalistes initialement proches du fascisme et du nazisme se sont pour certains transformés en révolutionnaires tiers-mondistes, il faut abandonner nos grilles européennes de lecture et prendre en compte la profonde hostilité envers l'impérialisme anglais et américain du nationalisme argentin, hostilité habilement exploitée par Peron qui incarna un temps l'idéal du chef nationaliste.
Peron fit rapidement passer l'ALN sous contrôle péroniste, de même que son aile lycéenne l'UNES (Union Nationale des Étudiants du Secondaire) et ce groupe de choc para-militaire devint, avec la complicité des militaires, des dirigeants syndicaux péronistes et de la police fédérale un des instruments d'intimidation et de brutalisation physique de l'opposition démocratique.
Une première rupture entre une partie des « nationaux-populaires » et le pouvoir péroniste se produisit lorsque Peron, pour se faire pardonner sa complaisance envers les nazis, décida de céder aux pressions des Américains et de signer les accord de défense de Chapultepec en 1946.
C'est à ce moment-là qu'un Rodolfo Walsh, par exemple, quittera l'ALN (qu'il décrira lucidement plus tard comme « la principale organisation nazie en Argentine ») après sa « normalisation » péroniste, puis se rapprochera ultérieurement des péronistes de tendance révolutionnaire (devenu un des dirigeants des Montoneros, il mourra assassiné en 1977).
Certains fondateurs du groupe politico-militaire guévariste ERP-ELN et de ses premières guerillas de type « foquiste » (implantées dans la région de Cordoba) comme Santucho ou Masetti, étaient également issus de l'ALN.
Une seconde rupture entre péronisme et ultra-nationalistes interviendra lors du conflit entre Peron et l'Église catholique en 1954-55, certains membres « historiques » de l'ALN rejoignant alors l'opposition cléricale au péronisme, en une sorte de retour au bercail national-conservateur.
Mais beaucoup de membres de l'ALN resteront fidèle au péronisme « orthodoxe » et donneront ultérieurement naissance à la triple A.
Ce petit résumé est forcément très schématique; les lecteurs intéressés par le sujet pourront se reporter aux travaux d'Alain Rouquié sur le nationalisme argentin et à de nombreux autres livres en espagnol, parmi lesquels je ne recommande malheureusement pas le plus récemment paru (en 2014) intitulé « Puños y pistolas » par Rubén Furman qui est un ouvrage extrêmement brouillon et répétitif.
Quelles leçons tirer aujourd'hui de toute cette histoire ?
Premièrement, il me semble évident que la combinaison entre le « national » et le « populaire » est toujours intrinsèquement instable, surtout dans des environnements ou le romantisme révolutionnaire et le culte catholique du martyr tiennent lieu d'analyse politique (soyons encore plus clair: je tiens les péronistes « de Droite » pour des crapules et les péronistes « de Gauche » pour des imbéciles).
Deuxièmement, je considère que les tentatives de certains idéologues post-marxistes comme Laclau de promouvoir la figure du leader national-populaire (cf. « La Raison populiste ») comme un ingrédient indispensable à la constitution du peuple en tant qu´acteur politique constituent une illusion nocive. Cette vision-là du politique comme agrégation fusionnelle autour d'un homme providentiel chargé de produire et d'incarner le clivage entre « peuple » et « ennemis du peuple » nous renvoie à Carl Schmitt ou Julius Evola bien plus qu'à Antonio Gramsci, quoique prétendent Laclau et ses épigones.
La reconstruction du « Prince Moderne », entendu comme intellectuel collectif dont la réflexion se nourrit des pratiques sociales et contribue à les orienter dans le sens de l'émancipation individuelle et collective devrait à mon avis rester le principal objectif de ce qui reste de la Gauche, à l'opposé de la fragmentation identitaire multidimensionnelle qui domine aujourd'hui.
Troisièmement, pour saisir certaines évolutions et trajectoires individuelles qui nous paraissent aujourd'hui complètement illogiques, il faut accepter de se replonger dans ce qu'étaient la confusion idéologique et les frustrations sociales de l'époque. À cet égard, certaines oeuvres de fiction aident à la compréhension globale du « zeitgeist » parfois davantage que les plus minutieuses des analyses politico-historiques.
Par exemple, la lecture des deux romans majeurs de Roberto Arlt (Les Sept Fous, Les Lance-flammes) permet de saisir comment la soif d'action directe trouvait à s'étancher sous une grande diversité de formes. Un des personnages des Sept Fous s'exclame quelque chose comme: « fascisme, communisme, peu importe, pourvu que ça pète » (je cite de mémoire car je n'ai pas l'ouvrage sous la main).
En conclusion, lorsque je vois que certains contributeurs de Médiapart semblent attendre avec impatience l'arrivée au pouvoir du Front National pour que « ça pète », je me dis que le génie d'Arlt n'a hélas pas encore épuisé toute sa capacité de prémonition...