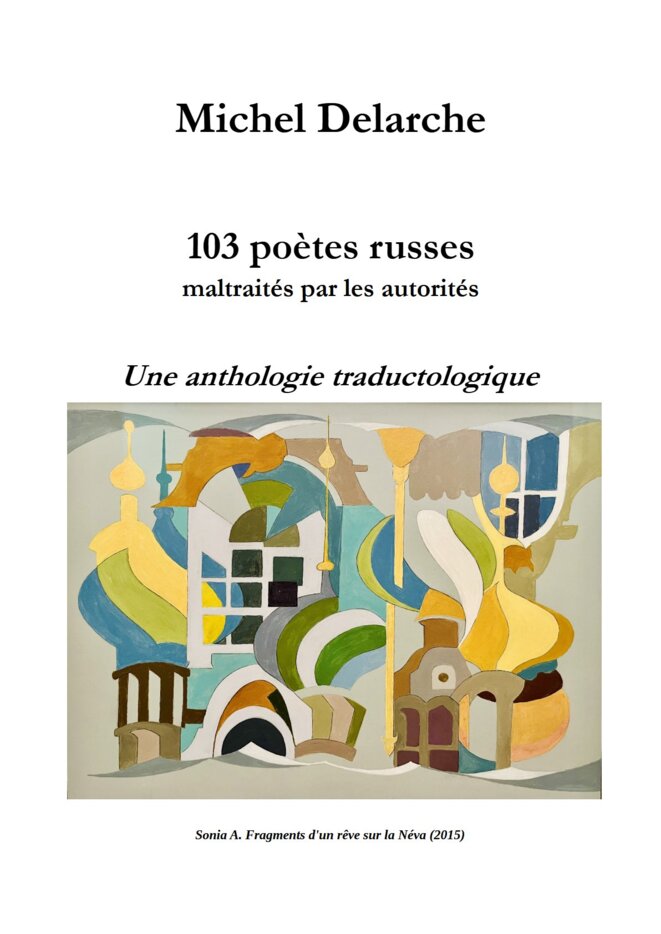Le chiffre officiel de l'inflation mensuelle d'octobre de 2,7% est loin de correspondre à la réalité vécue au quotidien par les consommateurs.
Il y a plusieurs raisons à cela, dont certaines nous rappellent des débats similaires en France.
L'Indice des Prix à la Consommation (IPC) est une construction statistique qui se veut moyenne. Or la pondération des éléments de la consommation populaire ou de certains segments de la population s'écarte significativement des moyennes: le poids du logement ou de la nourriture est plus lourd dans le budget d'une famille modeste (l'INSEE calcule d'ailleurs un indice distinct correspondant au premier quintile de l'échelle des revenus) ; le budget médicaments et soins médicaux est plus élevé pour les personnes âgées et les familles ayant des enfants en bas âge etc.
À ces écarts techniques communs à tous les IPC, s'ajoutent deux biais que le pouvoir politique n'a pas très envie de corriger car ils permettent de sous-estimer l'évolution du coût de la vie:
- la flambée des loyers causée par la déréglementation des contrats de location n'est pas prise en compte dans le panier de biens et services de l'INDEC (homologue argentin de l'INSEE) qui détermine seulement l'évolution du coût de la construction et n'inclut pas l'évolution des loyers dans son IPC ;
Le panier des biens et services et leurs pondérations dans l'IPC sur lequel s'appuie l'INDEC date de 2004-2005 et ne correspond plus à la réalité de la consommation, en particulier pour des dépenses fortement contraintes comme les services de transport, de santé ou de télécommunications.
Une enquête de consommation remontant à 2017-2018 aurait pourtant permis de rendre le calcul de l'IPC plus réaliste, mais aucun des gouvernements qui se sont succédés depuis, du néolibéral Macri au libertarien Milei en passant par le péroniste Fernandez, n'a voulu aller dans ce sens car minimiser la réalité de l'inflation les arrangeait tous; des économistes ont calculé que la chute moyenne du pouvoir d'achat qui s'établit à un peu plus de 6% sur la base des pondérations de 2004-2005, passe à plus de 11% avec celles de 2017-2018 (et sans doute encore davantage si, comme l'INSEE, l'INDEC révisait ses pondérations tous les ans). Il convient aussi de préciser que cette perte moyenne recouvre de grandes disparités: en un an de politique libertarienne, les retraites ont perdu entre 25 et 30% de pouvoir d'achat.
Cette année, malgré la violente récession induite par la politique de coupes budgétaires du gouvernement Milei-Caputo (6% de chute du PIB) l'inflation officielle sera de l'ordre de 110 à 115% et l'inflation réellement subie par les classes populaires sera plutôt de 125 à 140% selon les profils de consommation.