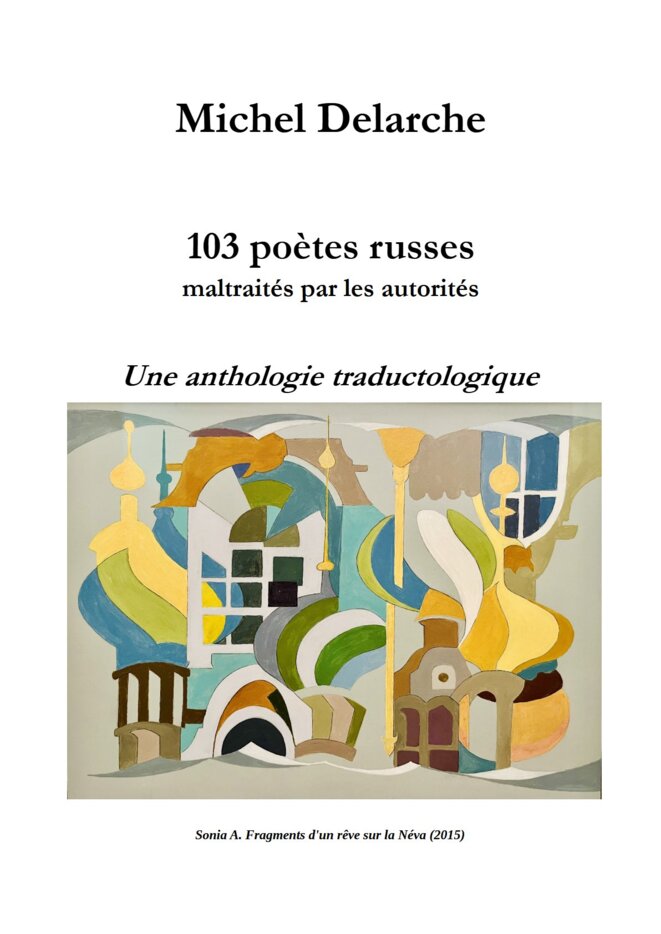Le seuil de rentabilité : une notion à géométrie variable
De nombreux spécialistes plus ou moins auto-proclamés s’entre-déchirent à propos du seuil de rentabilité des nouveaux acteurs pétroliers étatsuniens et les estimations varient du simple au quadruple (de 15-25 dollars par baril à 90 et plus). En fait, ils ont tous tort (ou tous un peu raison) car il y a plusieurs définitions du seuil de rentabilité.
Un article de synthèse publié fin 2016 par un groupe d’experts du MIT CEEPR (‘‘Tight Oil Development Economics: Benchmarks, Breakeven Points, and Inelasticities’’) permet d’y voir un peu plus clair dans la définition du seuil de rentabilité des investissements (le fameux ‘breakeven’).
Je vous en résume ci-après les principaux éléments avant de discuter les variations récentes de la production de pétrole non-conventionnel à la lumière de cet éclairage.
Techniquement, le seuil de rentabilité d’un projet se définit par la différence entre les investissements à consentir pour mener ce projet à bien et les revenus qu’on espère en tirer. Comme les investissements précèdent les revenus, on actualise les flux financiers sur la base d’un taux d’escompte qui permet de ramener la valeur des flux futurs à la date de départ du projet en inversant la formule des intérêts composés (par exemple, si le taux d’escompte est de 10 %, un revenu de 100 euros arrivant dans 3 ans voit sa valeur actualisée ramenée à 72,9 euros aujourd’hui). On calcule ainsi la Valeur Actuelle Nette (VAN) du projet et le seuil de rentabilité correspond à une VAN égale à zéro.
Selon les auteurs de cet article, il convient de définir le seuil de rentabilité de l’extraction du pétrole de schiste de plusieurs façons différentes, qui reflètent quelles étapes du cycle de développement sont prises en compte.
Selon que l’on inclut ou non les phases amont d’exploration, de délimitation des zones exploitables et de mise en place des infrastructures de base (routes, réseau d’oléoducs, énergie électrique, construction de bases-vie…) nécessaires pour commencer à exploiter un champ non-conventionnel dans des zones dont certaines sont au milieu de nulle part et donc dépourvues de tout équipement préalable, le seuil de rentabilité varie énormément.
Du point de vue de l’économie générale du secteur, et en particulier de la comparaison avec l’exploitation conventionnelle, l’amortissement des dépenses sur le cycle complet donne une valeur de seuil qui peut varier entre 60 et 90 dollars/baril en fonction de l’étendue du champ, de ses caractéristiques géologiques et du prix de revient des autres ressources à mobiliser (salaires du personnel, coût des équipements...) Autrement dit, au prix actuel du pétrole (60 dollars pour le WTI) seuls les champs les plus productifs sont capables de rentabiliser l’intégralité des capitaux engagés pour une mise en exploitation ex nihilo. C’est ce que les auteurs de l’article appellent ‘full cycle breakeven’, seuil que l’on peut encore relever en y ajoutant les éventuels impôts et taxes (‘fiscal breakeven’) voire la gestion des accidents et les travaux à mener en fin d’exploitation pour la remise en état du terrain, la dépollution etc. (‘externalities breakeven’).
Mais une fois qu’un champ a commencé à être mis en exploitation, des investissements additionnels peuvent prendre en compte seulement le forage, le chemisage et le cimentage pour la préparation de nouveaux puits (les infrastructures déjà en place à l’échelon du champ se trouvant alors déjà partiellement amorties et mutualisées, ce qui est le cas dans des zones déjà équipées d’une infrastructure conventionnelle d’exploitation comme le champ texan d’Eagle Ford). On a ainsi une deuxième définition du seuil de rentabilité que les auteurs de l’article appellent ‘half-cycle breakeven’, qui varie entre 40 à 60 dollars/baril.
La répartition des coûts entre la phase de forage et la phase d’extraction (on parle de stimulation pour décrire l’injection d’eau, de sable et de solvants chimiques permettant de fracturer la roche pour en extraire le pétrole) est du type 50-50, ce qui est très différent de l’exploitation conventionnelle (y compris celle des champs situés en mer) où l’essentiel des dépenses concerne le forage, les coûts de la stimulation par injection étant faibles ou inexistants (sauf pour de vieux puits en voie d’épuisement dans lesquels on injecte de l’eau salée pour faire remonter le pétrole qui reste).
Le dernier seuil de rentabilité est celui qui correspond au coût marginal d’exploitation d’un puits productif (appelé ‘operating cost’ dans l’article) et il est souvent mis en avant par les plus ardents partisans de la théorie selon laquelle les gains de productivité du pétrole non-conventionnel vont lui permettre à terme de rivaliser avec l’extraction conventionnelle.
D’après les travaux de l’EIA, les principaux champs non-conventionnels étatsuniens (Bakken et Eagle Ford) ont un coût marginal du baril extrait qui varie entre 10 et 35 dollars/baril. Mais ces chiffres ne reflètent qu’une fraction du coût total et ce d’autant plus que le coût du capital pour ces projets à la rentabilité globale aléatoire est très élevé. Du fait de la grande volatilité des cours du pétrole et de l’incertitude qui règne sur les cours (y compris à un horizon de temps de seulement 3 ou 5 ans, ce qui est la durée de vie typique d’un puits non-conventionnel): les financiers apporteurs de capitaux achètent les obligations émises par les exploitants les plus endettés seulement si on leur offre des taux annuels de l’ordre de 7 à 9 %, s’agissant d’obligations classées comme « junk bonds ».
Or forer un nouveau puits et le mettre en exploitation coûte entre 6 et 8 millions de dollars, et du fait de l’épuisement rapide des puits, il faut périodiquement lancer de nouveaux forages pour maintenir le niveau de production, d’où le besoin récurrent d’argent frais des exploitants. Seule une faible proportion des exploitations non-conventionnelles parviennent à auto-financer leurs coûts complets (c’est surtout le cas dans le champ d’Eagle Ford qui se trouve à proximité de l’infrastructure pré-existante développée au Texas pour l’extraction conventionnelle). L’exploitation à perte reste la règle pour la plupart des producteurs nord-américains et cette situation ne peut se maintenir que grâce aux baisses des taux de prêts que parviennent à négocier les moins endettés d’entre eux : on peut dire que le fort développement depuis quelques années de la production de pétrole de schiste aux USA est un des sous-produits de la bulle financière créée par la politique de « quantitative easing » de la Banque Fédérale.
En dehors des Etats-Unis, l’exploitation non-conventionnelle n’a pas atteint le même degré de maturité, et les conditions géographiques et économiques sont souvent plus difficiles : que ce soit dans les champs de Vaca Muerta en Argentine ou même dans le nord de l'Angleterre, les difficultés pour déployer l’infrastructure requise et aussi pour attirer, former et retenir les compétences humaines nécessaires impliquent des surcoûts par rapport aux Etats-Unis, qui en sont à un stade plus avancé de leur courbe d’apprentissage.