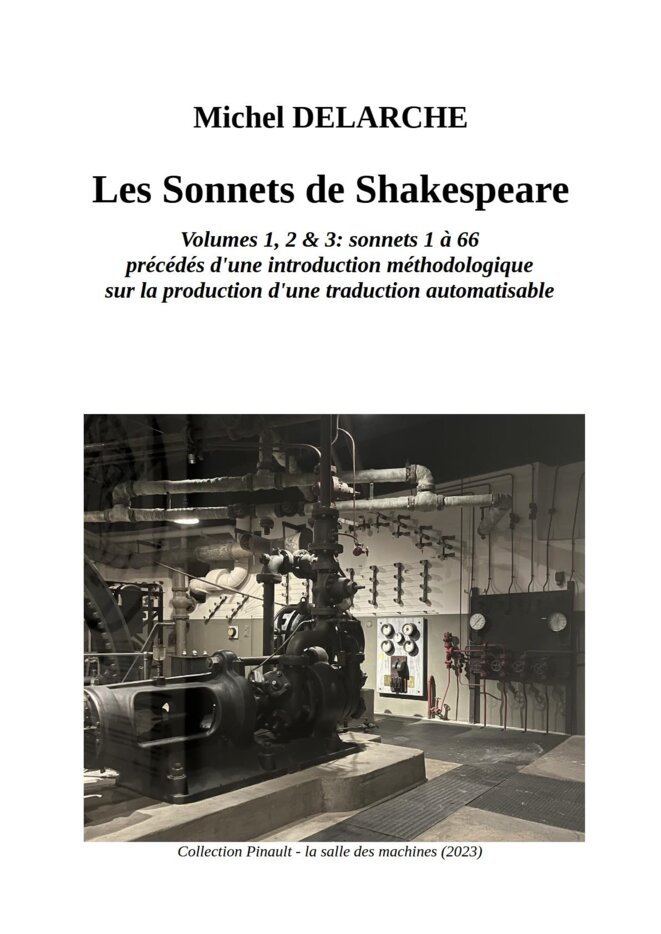Marina Tsvetaïéva (1892-1941) est, avec Anna Akhmatova et quelques autres poétesses moins connues comme Barkova ou Gnéditch, une des plus fortes voix féminines de la poésie russe au 20ème siècle. Fille du Directeur du Musée des Beaux-Arts de Moscou et d'une musicienne, elle est initiée très tôt aux arts et aux langues étrangères. De 1901 à 1905, accompagnant sa mère tuberculeuse, elle vit en Italie puis en Suisse. Après le décès de sa mère à Yalta en 1906, elle passe l'été seule à Paris en 1909. Au début des années 1910, elle publie ses premiers recueils de poésie.
Mariée à Sergueï Efron en 1912 elle en a la même année une première fille, Ariadna (appelée Alia). Une seconde fille, Irina, naît en 1917 et périra en 1920 dans un orphelinat où sa mère l'a abandonnée.
Pendant la guerre civile, Efron est officier dans l'Armée Blanche de Dénikine, Après la défaite des Blancs, il part pour Prague en 1921. Marina part l'y retrouver via Riga et Berlin. En 1925 naît son fils Georges, surnommé "Murr" par allusion au chat Murr d'Hoffmann) et la famille s'installe en France où elle vit dans la pauvreté. Tsvetaïéva écrit surtout de la prose.
L'idéologie eurasiatique d'Efron l'amène à se rallier au régime soviétique et à devenir un agent extérieur du NKVD. En mars 1937, malgré l'opposition de sa mère, Alia rentre en URSS. Elle est suivie par Efron en octobre qui doit quitter la France car il est compromis dans l'assassinat de l'agent Ignasz Poretsky (dit Reiss) commandité par ses employeurs soviétiques.
Marina ne rentre en Russie qu'en 1939, au moment où la guerre est sur le point d'éclater. Sa fille et son mari sont arrêtés l'une en août, l'autre en octobre. Efron sera fusillé en 1941 et Ariadna passera quinze ans dans les camps du Goulag.
Tsvétaïeva ne peut publier et vit de traductions. Quand la guerre commence, elle et son fils sont évacués vers Chistopol avec d'autres écrivains. Peu après son arrivée, sans travail, malade et déprimée, elle se pend après avoir laissé des notes demandant à des proches de prendre soin de son fils (il sera tué sur le front de Biélorussie en juillet 1944.)
Ахматовой
О, Муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты чёрную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.
И мы шарахаемся и глухое: ох! —
Стотысячное — тебе присягает: Анна
Ахматова! Это имя — огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.
Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами — то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.
В певучем граде моём купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий…
И я дарю тебе свой колокольный град,
— Ахматова! — и сердце своё в придачу.
À Akhmatova
Ô Muse des pleurs, des Muses la plus parfaite!
Ô toi, de la nuit blanche engeance déjantée !
Toi qui sur la Rous' lance une noire tempête,
Tes cris tel des flèches en nous se sont plantés.
Puis nous nous écartons, et un "Oh!" assourdi,
Ils sont cent mille te prêtant serment, Anna
Akhmatova ! Ce nom, énorme soupir qui
Tombe dans un gouffre gardant l'anonymat.
C'est notre sacre d'avoir avec toi foulé
La même terre, avec sur nous le même ciel!
Celui qui par ton destin fatal est blessé,
Sur son lit de mort déjà devient immortel.
Les coupoles scintillent dans ma ville chantante,
Et un aveugle errant loue le radieux Sauveur...
Et moi je t'offre ma ville carillonnante,
- Akhmatova! - et en plus je t'offre mon cœur.
Notes sur le texte et la traduction:
Ces quatre quatrains datés du 19 juin 1916 constituent le premier d'un groupe de 13 poèmes dédiés à Akhmatova. La dernière rencontre entre les deux poétesses eut lieu à Moscou en octobre 1940.
Les dodécasyllabes russes sont à rimes croisées (seule la dernière paire de rimes y est orpheline, tout en bénéficiant de l'assonance pré-finale de бродячий et придачу), mais, comme le montre la traduction ici proposée, ces vers peuvent être transposés en alexandrins français, moyennant quelques petites distorsions et remaniements syntaxiques, qui sont de toute façon nécessaire, compte tenu de la syntaxe particulièrement tortueuse de l'original.
déjantée: шальное appartient au registre familier de dénotation adjectivale de la folie (pour le traduire, les dictionnaires donnent 'timbré' ou 'toqué' en plus de 'fou'); j'ai choisi 'déjanté' pour la triple allitération avec 'engeance' et 'blanche', afin de transposer en français la triple allitération en ш et ч (шальное исчадие ночи) du vers russe.
Rous': les traducteurs précités traduisent ici Русь par 'Russie''. Mais ce nom désigne spécifiquement la Rous' de Kiev, cette principauté moyenâgeuse que la Russie de Poutine, comme auparavant celle des tsars, placent au fondement de leur récit national. L'attachement de Tsvétaïéva aux traditions culturelles de l'ancienne Russie m'incite à conserver cette référence historique.
Anna / Akhmatova: l'enjambement séparant le prénom du nom se justifie par le fait que le prénom peut être compris comme un vocatif émis par l'auteur alors que le nom de famille fait partie d'un cri intérieur de ralliement pour une foule dont les soupirs sont voués à rester anonymes.
soupir qui: l'ajout de ce relatif permet de lever l'ambiguïté sur le sujet de 'tombe' qui n'est pas le nom mais le soupir; en effet, dans l'original russe, c'est le pronom masculin он ajouté devant le verbe падает qui lève l'ambiguïté pouvant se poser entre le neutre имя (le nom) et le masculin вздох (le soupir) regardant le choix du sujet ; la fusion des genres neutre et masculin en français rendrait "il" ambigu en français, d'où mon choix d'une construction relative.
gardant l'anonymat: le texte dit littéralement: "laquelle est anonyme" ; en russe le mot глубь (profondeur, gouffre, abîme) est du genre féminin ce qui évite toute ambiguïté sur la détermination de l'antécédent du relatif féminin которая, malgré la distance, impossible en français, qui sépare les deux mots. La suppression de cette construction relative dans la traduction est la contrepartie de l'introduction d'une relative au vers précédent, afin d'éviter la lourdeur que créerait l'enchaînement de deux subordonnées relatives.
C'est notre sacre: le texte dit "nous [sommes] /couronnés/sacrés/".
fatale: l'adjectif du texte est dérivé de "mort", mais j'ai préféré éviter de répéter "mortelle".
devient: le verbe сходит (littéralement "descendre") a plusieurs autres sens possibles selon le contexte (quitter, passer, devenir, disparaître), qui font mieux sens avec l'instrumental de fonction бессмертным (passer à l'immortalité, devenir immortel, disparaître dans l'immortalité.)
Le sens littéral de "descend" ne convient pas bien ici, car en français, dans un tel contexte empreint de religiosité, on parlerait plutôt de s'élever à l'immortalité.
La traduction proposée par V. Lossky remplace "[celui] qui" par "nous", s'écartant ainsi du texte sans nécessité ; la traduction de N. Struve respecte la troisième personne du singulier et veut se caler sur la notion d'un mouvement descendant, mais son étoffement par: "Goûte à l'immortalité en s'étendant sur son lit de mort" altère par sa lourdeur le rythme du poème, d'autant que "s'étendant" ne correspond pas vraiment à сходит (on aurait plutôt лежит ou ложится).
carillonnante: l'adjectif колокольный renvoie ici aux cloches, en écho à певучем (chantante) au premier vers. La surtraduction par N. Struve "aux mille clochers" est élégante (et fait sens par métonymie) mais elle perd la possibilité de faire le lien entre les deux adjectifs.
et en plus je t'offre mon cœur: le texte dit seulement "et mon cœur en plus". La répétition du verbe est ici utile à la fois à l'équilibre du vers et au marquage rhétorique du don, qui est un thème récurrent chez Tsvétaïéva.