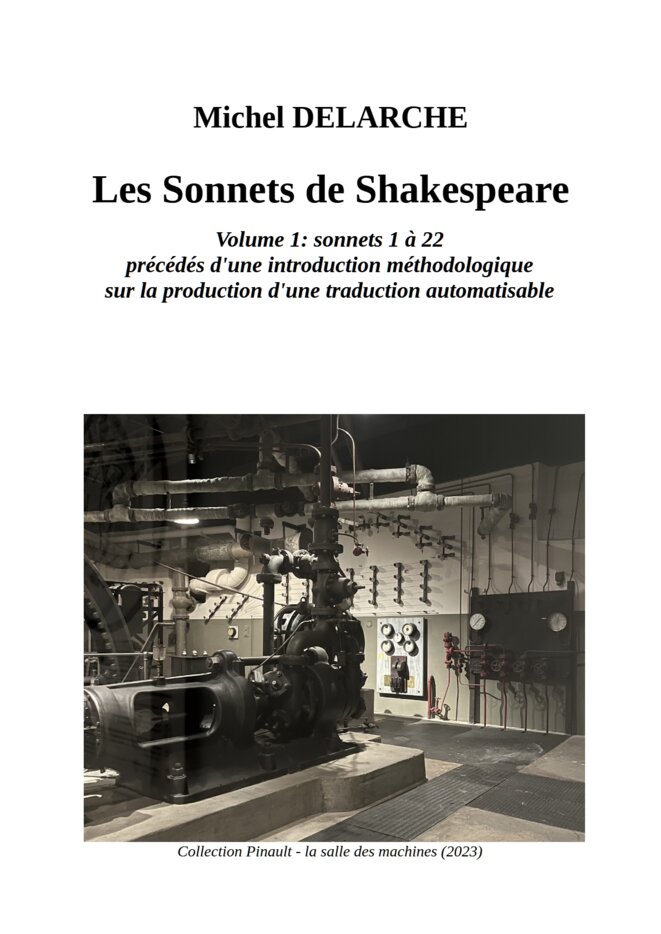Mikhaïl Lermontov (1814-1841), que ses proches francophones n’appelaient que Michel, est dans son pays considéré avec Pouchkine et Tiouttchev comme un des grands poètes romantiques russes. Il est surtout connu en France par son récit Un Héros de notre temps, inspiré par sa vie d’officier dans le Caucase où il avait été envoyé en exil pour avoir fait circuler La Mort du poète, un poème à propos de la mort de Pouchkine où il maltraitait férocement la cour impériale.
Il fut beaucoup critiqué pour ses débauches et son caractère instable, mais aussi salué pour sa bravoure dans la guerre menée par la Russie tsariste contre les Tchétchènes. Comme Pouchkine, il mourut tué en duel. Il s’agissait en réalité d’un suicide assisté, Lermontov se contentant de continuer de manger des cerises pendant que son adversaire le mettait en joue (anecdote rapportée par André Markowicz dans Le Soleil d’Alexandre.)
Ce poème est extrêmement connu en Russie, où il a même été mis en musique. Il a déjà été plusieurs fois traduit en français, entre autres par la poétesse russe Marina Tsvétaïéva et plus récemment par le traducteur contemporain André Markowicz. Je l'ai choisi comme exemple pour mener une étude de cas, en faire en quelque sorte un support de travaux pratiques, afin de vous faire partager mes méditations traductologiques sur les gains et les pertes d’un processus de traduction et aussi, ce qui en surprendra peut-être certains et certaines, sur ce que pourrait être une approche algorithmique visant à progresser vers la traduction (semi-)automatique de la poésie.
Pour commencer, je vous en propose strophe à strophe une pseudo-traduction quasiment mot à mot respectant au maximum la syntaxe de l’original tout en ouvrant l’éventail des choix possibles sous forme d’options de traduction séparées par des barres obliques pour certains mots, avec des précisions optionnelles mises entre crochets.
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
Je /m’en vais/pars/ [à pied] seul moi sur /la route/le chemin/la voie/ ;
à travers /la brume/le brouillard/ /la route/le chemin/la voie/ de silex /étincelle/brille/luit/ ;
[La] nuit [est] /silencieuse/calme/douce/tranquille/paisible/. Le désert /est attentif à/écoute/ Dieu,
et /l’/une/ étoile avec /l’/une/ étoile /parle/bavarde/cause/devise/.
Notes : Выхожу est un imperfectif de mouvement où le préfixe Вы indique l’éloignement sans autre précision (cf. l’opposition Вход/Выход pour entrée/sortie).
Дорога et путь sont ici synonymes mais ne sont pas toujours interchangeables (par exemple l’expression figée железная дорога désigne le chemin de fer). La principale différence entre les deux est que путь peut s’employer aussi dans un sens abstrait (un s-pout’-nik c’est étymologiquement un compagnon de route).
L’adjectif кремнистый pourrait se traduire par ‘siliceux’ dans un contexte plus technique (par exemple, un manuel de géologie) mais ici il qualifie simplement comme étant des silex les cailloux qui brillent à la surface de la route.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?
Dans les cieux, /solennellement/triomphalement/ et /merveilleusement/miraculeusement/ !
La terre dort dans un/e/ /rayonnement/éclat/halo/auréole/brillance/ /bleu clair/d’azur/...
Pourquoi suis-je ainsi malade et ainsi fatigué ?
Qu’est-ce que j’attends ? /Qu’est-ce que je regrette/De quoi suis-je désolé/ ?
Notes : l‘expression В небесах peut signifier aussi « au Paradis » mais ici le contexte exclut cette interprétation.
Земля désigne le sol par opposition à l’air, ou la terre ferme par rapport à la mer, mais aussi ici la planète Terre. La lumière bleutée évoque un clair de lune. On pense ici au célèbre vers d’Eluard : « La terre est bleue comme une orange ».
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Déjà je n’attends de la vie vraiment rien moi,
Et je ne regrette pas le passé pas du tout ;
Je [re]cherche la liberté et /le/du/ :repos/calme [de] la /paix/tranquillité/ !
Moi je voudrais /me perdre/oublier/ et /m’endormir/perdre conscience/ !
Notes : заснуть est une forme verbale en -нуть qui implique un aspect sémelfactif (c’est-à-dire représentant une occurrence unique d’une action (comme крикнуть : pousser un cri).
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
Mais pas de ce froid sommeil-là /de la tombe/du caveau/ du tombeau/…
Moi je /voudrais/souhaiterais/désirerais/ /à jamais/pour toujours/ ainsi m’endormir ;
/Afin/pour/ que dans /la poitrine/le sein/ /somnolent/sommeillent/ les forces de la vie,
/Afin/pour/ que /la respiration/un souffle/ soulève doucement la poitrine ;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.
/Afin/pour/ que toute la nuit, tout le jour mon /ouïe/oreille/ /caressant/choyant/
Au sujet de l’amour pour moi une douce voix chante
Que sur moi /à jamais/pour toujours/ /vert/verdoyant/
Un sombre chêne se penche et /fasse du bruit/chante/ronronne/bruisse/.
Note :La traduction adéquate de шумел est ici ‘bruisse’. Pour automatiser la réduction de l’éventail des options, il y aurait deux solutions :
1°) disposer d’un vaste corpus parallèle de phrases déjà traduites à partir duquel on puisse identifier de manière statistique la traduction la plus probable. Mais dans un cas comme celui-ci, où les occurrences de la bonne traduction sont probablement peu nombreuses, l’approche statistique nous orientera vers la traduction standard ‘fasse du bruit’ qui est pertinente dans 90 % des cas.
2°) développer un algorithme déterministe s’appuyant sur deux bases de données servant d’outils de filtrage : a) un dictionnaire dans lequel les entrées multiples soient associées à leur contexte d’usage. Ainsi, dans mon vieux dictionnaire papier de Chtcherba et Matoussevitch, à l’entrée décrivant le verbe шуметь, la traduction ‘bruire’ est suivie des précisions suivantes données en russe entre parenthèses : (о леревьях, ветре, волнах) c’est-à-dire : (s’agissant des arbres, du vent, des vagues). Pour assurer la corrélation automatique, encore faut-il que le chêne du texte soit identifié comme un arbre. Le deuxième outil requis est donc b) un dictionnaire monolingue de définitions des mots (dans la langue-cible ou dans la langue-source) permettant d’obtenir le chaînon manquant chêne→arbre. Pour ce cas, on trouve dans le Petit Larousse le début de définition suivant : « arbre commun dans les forêts d’Europe... ». Ce petit exemple montre à quel point la correction d’une traduction ne peut être complètement assurée que par la disponibilité d’une riche ontologie, c’est-à-dire d’une représentation du monde encodant toute une masse de savoirs implicites que les traducteurs humains ne se soucient pas d’expliciter puisqu’ils sont partagés avec leur public, comme le fait que le chêne soit un arbre. Ceci ne résout cependant pas tout: en français, on rencontre l'expression "la foule bruisse" (d'impatience, de rumeurs etc.) mais l'expression russe толпа шумит ne renvoie qu'au sens le plus courant du verbe (faire du bruit). Inversement, la liste donnée par le dictionnaire n'est probablement pas exhaustive; par exemple, on trouve en russe l'expression ручей шумит qu'on traduirait volontiers en français par "le ruisseau bruisse" dans la plupart des contextes, mais si ручей n'est pas répertorié dans le dictionnaire russe-français comme compatible avec 'bruire', l'aiguillage vers la bonne traduction ne se fait pas et l'ambiguïté subsiste...
Le but du jeu est maintenant de produire à partir de ce charabia une traduction respectant à la fois le sens et les rimes entrelacées de l’original, tout en offrant des vers d'une longueur comparable à ceux de Lermontov. Aussi bien Tsvetaïéva que Markowicz et d'autres ont traduit en français les vers de Lermontov par des ennéasyllabes ou des décasyllabes, ce qui est le choix le plus logique pour ces vers russes qui font de 8 à 10 syllabes.
J’ai choisi de produire des décasyllabes avec des rimes entrelacées, pour rester fidèle à la structure du poème original.
Techniquement, en partant de l’éventail d’options précédemment déployé, on peut commencer par sélectionner les variantes les plus proches du rythme du texte-source. Par exemple, traduire Ночь тиха par ‘nuit calme’ ou ‘nuit douce’ correspond à la fois au sens et au rythme, même si la traduction la plus exacte dans un contexte prosaïque imposerait d’ajouter ici un déterminant et un verbe-copule : « La nuit est calme ».
D’autres traductions possibles comme « La nuit est tranquille » qui transforme trois syllabes russes en cinq syllabes françaises, compliquent le respect de la longueur totale du vers. Dans une approche algorithmique, on peut donc trier les options par ordre de proximité décroissante au rythme du texte-source.
L’explicitation de l’éventail des possibles permet aussi de repérer des candidats potentiels à la production des rimes. On peut ainsi relever ‘route’ et ‘écoute’ dans le premier quatrain. C’est d’ailleurs le schéma de rimes en français qui fut retenu par Marina Tsvétaïeva, mais elle s’écarta considérablement de la lettre du texte :
Je m’en vais tout seul sur la grand’route
Le silex reluit dans le brouillard.
Dieu énonce — et le désert écoute,
L’astre à l’astre lance un long regard.
Les deux derniers vers sont assez loin du texte-source : la nuit tranquille a disparu, et ici Dieu parle, alors que l’original nous dit seulement que le désert écoute et que ce sont les étoiles qui conversent entre elles au lieu de s’entre-regarder.
Enfin, le lien entre le second vers et le premier n’est pas évident dans cette mise en français, car la présence du silex dans la chaussée n’est pas explicitée dans la traduction, contrairement au кремнистый путь de l’original.
Cette traduction souffre d’autres défauts mineurs : ‘reluisent’ ne colle pas très bien ici car il s’agit plutôt de reflets fugitifs du clair de lune sur des cailloux, et ‘brume’ irait mieux que ‘brouillard’ pour traduire туман si l’on veut conserver l’idée que les reflets de la lune sur les cailloux parviennent à passer au travers.
Bref, selon le critère aujourd’hui essentiel de la fidélité au sens du texte, cette traduction quoique correctement versifiée, est franchement mauvaise, avec l’excuse qu’à l’époque (le premier tiers du vingtième siècle) les traducteurs avaient encore coutume de prendre beaucoup de liberté vis-à-vis des auteurs qu’ils traduisaient.
Mais il ne suffit pas de critiquer ses prédécesseurs, encore faut-il démontrer qu’on peut s’y prendre autrement ; pour cela, je vais détailler sur ce premier quatrain l’approche technique que j’ai adoptée pour aboutir à ceci:
Je m’en vais seul sur le chemin pierreux
Les silex à travers la brume luisent.
Nuit calme. Le désert écoute Dieu.
Et l’étoile avec l’étoile devise.
Je me suis en premier lieu imposé de traduire au plus près du texte-source le troisième vers, qui est techniquement le plus contraignant, choix qui pose immédiatement une contrainte sur la rime à placer au premier vers.
L’ajout de l’adjectif ‘pierreux’ permet de faire d’une pierre deux coups (c’est le cas de le dire!) : a) il crée le lien (qui manque chez Tsvetaïeva) entre la route et les silex brillants ce qui permet de ne pas répéter ‘la route’ au second vers, et b) il fournit la rime avec Dieu.
Le second vers ainsi allégé admet encore plusieurs variantes compatibles avec le rythme décasyllabique :
à travers /le brouillard/la brume/ les /cailloux/silex/ /brillent/luisent/
J’ai conservé les silex de l’original en les déportant en tête de vers pour renforcer le lien avec ‘pierreux’ et comme déjà expliqué plus haut j’ai choisi ‘la brume’ plutôt que ‘le brouillard’.
Pour le verbe qui se trouve à la rime le choix entre ‘brillent’ et ‘luisent’ est contraint à son tour par la compatibilité avec les traductions qu’on peut choisir pour говорит : ‘luisent’ rime avec ‘devise’ qui fonctionne parfaitement parce cette idée d’une conversation tranquille et sans éclats de voix s’intègre bien avec l’atmosphère de tranquillité créée par les vers précédents, alors que ‘brillent’ ne pourrait s’apparier qu’avec ‘babille’ dont la connotation de frivolité ne conviendrait pas ici.
On voit que le processus de traduction s’apparente à la résolution d’un problème de mots-croisés où chaque solution partielle envisagée doit être rendue compatible avec tout un réseau d’autres contraintes qu’il faut résoudre de proche en proche, avec parfois des retours en arrière.
Sans davantage de détails explicatifs, voici le résultat final de cet exercice, qu'on peut certainement polir et rendre plus fluide en acceptant de s'éloigner davantage de la sémantique du texte-source :
Je m’en vais seul sur le chemin pierreux
Les silex à travers la brume luisent.
Nuit calme. Le désert écoute Dieu.
Et l’étoile avec l’étoile devise.
Dans les cieux, merveille triomphale.
La terre dort dans un rayon bleuté
Pourquoi suis-je si fatigué, si mal ?
Qu’est-ce que j’attends ? Qu’ai-je à regretter ?
Moi je n’attends vraiment plus rien de vivre,
Je n’ai nul regret du tout du passé.
En quête de repos et d’être libre,
Je voudrais m’endormir et oublier !
Mais pas d’un froid sommeil de nécropole...
Moi je voudrais dormir ainsi sans fin,
Qu’en moi les forces de la vie somnolent,
Qu’un léger souffle soulève mon sein ;
Que chante l’amour une voix légère
À mon ouïe, jour et nuit la caressant,
Qu’un chêne sombre restant toujours vert
Sur moi se penche avec un bruissement.