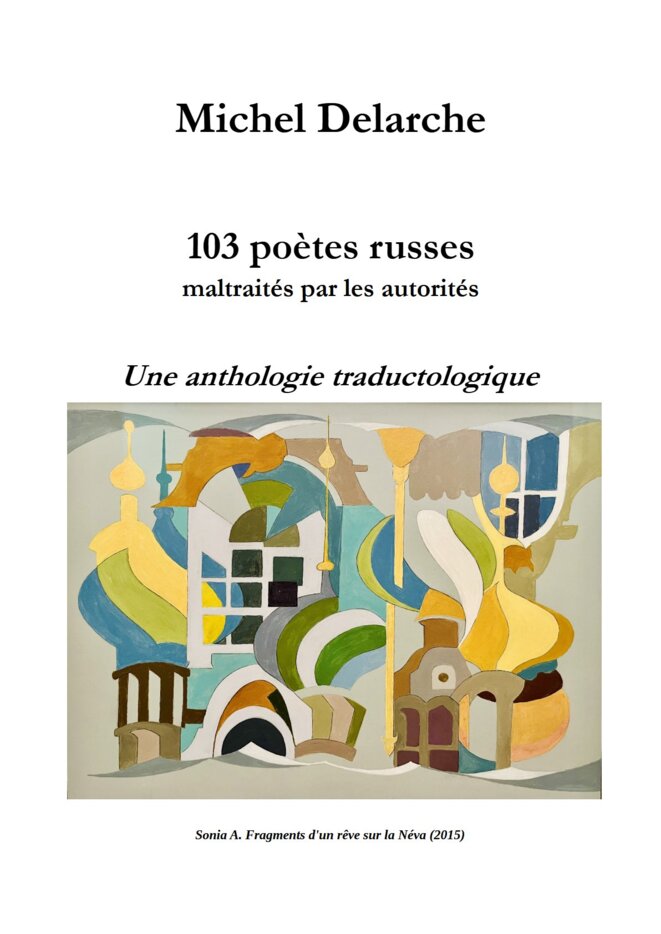Ce billet fait suite aux remarques introductives postées hier sur ce même blogue.
Aucun dirigeant politique français ne prendra jamais la décision de procéder à un désarmement nucléaire unilatéral du pays parce que l'existence de cette “force de frappe” remplit deux fonctions:
a) une fonction politique de maintien du statut de la France en tant que (petite) “grande puissance” et membre permanent du Conseil de Sécurité;
b) une fonction stratégique d'autonomie relative vis-à-vis de nos alliés comme de dissuasion vis-à-vis de nos adversaires potentiels plus puissants (dissuasion dite “du faible au fort”).
Contrairement à ce que prétendent certains partisans du désarmement nucléaire unilatéral, cette doctrine a fait la preuve de son efficacité, comme le rappelle Fred Kaplan dans “Rethinking Nuclear Policy”, un article clair et décapant paru dans le numéro de septembre-octobre 2016 de “Foreign Affairs”; par exemple, il rappelle qu'une querelle frontalière entre la Chine et l'URSS dans la région du fleuve Amour (sic !) fut sur le point de dégénérer en guerre ouverte, mais que les quelques bombes nucléaires que possédaient alors la Chine suffirent à dissuader l'URSS de poursuivre l'escalade.
Le désarmement nucléaire unilatéral est d'autant moins à l'ordre du jour dans la période qui s'ouvre qu'à ces deux fonctions traditionnelles pourraient s'ajouter deux fonctions émergentes à l'horizon 2025:
c) spécifier la contribution de la dissuasion française à une doctrine européenne de défense post-OTAN ;
d) compléter l'actuelle doctrine stratégique de dissuasion du faible au fort par une dissuasion du faible au faible, du fait de l'accroissement des tensions au Proche-Orient et de ses lourdes conséquences potentielles sur l'Europe.
Les forces nucléaires stratégiques françaises ont actuellement deux composantes:
a) une force océanique stratégique de 4 sous-marins équipés chacun de 16 missiles M51 à longue portée (8 000 km) et à têtes multiples (6 têtes nucléaires par missile)
b) une force aérienne constituée d'une quarantaine d'avions (Mirage 2000N et Rafale) équipés de missiles Air Sol Moyenne Portée Améliorés (ASMPA) d'une portée maximale d'environ 500 km.
Plutôt que de raisonner directement sur ce qu'il faudrait ajouter ou retrancher à l'existant, il me semble préférable de clarifier les missions des forces stratégiques dans le cadre géopolitique esquissé précédemment pour en déduire l'enveloppe des moyens requis, car dans l'article de “Foreign Affairs” déjà mentionné, Kaplan rappelle que mener un exercice à partir du principe “budget base zéro” est la seule façon de s'abstraire des groupes de pressions militaro-industriels pour définir les besoins réels.
Géopolitiquement, quelle que soit l'évolution de la coopération militaire entre les États-Unis et l'Europe, la France continuera de faire partie de l'Europe occidentale et de ce fait, quelle que soit l'évolution des relations entre la Russie et l'Europe, la dissuasion française continuera de jouer un double rôle: maintenir une autonomie de décision politique par rapport à ces deux puissances principales dont l'une, la Russie, continuera de représenter une menace militaire directe sur l'Europe de l'ouest.
Inversement, il faut avoir la lucidité de reconnaître que nous ne sommes, économiquement et politiquement, qu'un vassal parfois frondeur des États-Unis (mais cela se produit de moins en moins souvent, le dernier écart significatif remontant à la guerre d'Irak de 2003). De ce fait, notre relation avec les deux puissances dominantes n'est pas symétrique: la Russie représente encore une menace militaire stratégique pour l'Europe (et l'annexion de la Crimée n'a fait que raviver les inquiétudes européennes à ce sujet) alors que les États-Unis, même redevenus si isolationnistes qu'ils n'auraient plus de présence militaire opérationnelle en Europe, resteraient un allié par rapport à cette menace russe. La Chine constitue potentiellement une nouvelle menace stratégique pour les USA dans le Pacifique, mais elle n'en est pas une pour l'Europe, et, de ce point de vue, une sortie formelle de l'OTAN (et pas uniquement du commandement intégré) nous garantirait de pouvoir nous tenir à l'écart d'un conflit entre les États-Unis et la Chine.
Ce que propose présentement Trump n'est pas de retirer complètement les forces américaines d'Europe, mais d'en réduire significativement le nombre et de faire payer aux Européens le prix fort pour le maintien du reste. Cependant, une fois cette dynamique enclenchée, l'obsession anti-chinoise de Trump, et le rapprochement avec la Russie qui en résulte, pourraient conduire, plus vite qu'on ne l'imagine présentement, à la fermeture de la plupart des bases américaines d'Europe. L'existence d'une dissuasion française technologiquement indépendante des États-Unis (contrairement à celle du Royaume-Uni dont les missiles Polaris et maintenant Trident sont développés par Lockheed Martin) représentera également un atout face aux trop prévisibles chantages financiers de Trump.
Si l'on veut conserver une dissuasion suffisante vis-à-vis de la Russie en cas de réduction voire de disparition de toute protection américaine pour l'Europe, 5 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) seraient suffisants (afin d'en avoir au moins deux en permanence en patrouille au lieu d'un seul actuellement). Kaplan explique que les USA qui ont un déploiement dans l'Atlantique (face à la Russie d'Europe) et un autre dans le Pacifique (face à la Chine et à la Russie d'Asie) auraient besoin de seulement 9 sous-marins pour remplir ces deux missions... alors que les militaires américains en ont actuellement 14 et en réclament 12 nouveaux ! Il conviendra cependant de réévaluer régulièrement le nouveau risque que les nouveaux drones maritimes font peser sur l'indétectabilité des sous-marins.
Si l'on veut munir la France d'une capacité minimale de dissuasion face au risque potentiel d'extension d'une crise proche-orientale, un SNLE supplémentaire (pouvant patrouiller en Méditerranée ou dans le nord de l'Océan Indien) pourrait être envisagé, mais mettre en place des missiles à longue portée à bord de navires de surface patrouillant en Méditerranée ou dans le nord de l'Océan Indien serait une solution moins coûteuse pour remplir une telle mission de dissuasion du faible au faible.
Pour remplir une mission de dissuasion stratégique au sens strict, il n'est pas utile de maintenir les Forces Aériennes Stratégiques (FAS) sous leur forme actuelle: les avions des FAS pourraient être à terme reversés à la FATAC (Force Aérienne Tactique, rebaptisée et dédoublée en FAC et FAP, sans doute pour créer des postes d'officiers supérieurs) où ils viendraient renforcer les capacités de projection conventionnelle, ce qui constitue d'ailleurs déjà l'essentiel de leur activité: une telle décision ne ferait qu'officialiser au niveau de la doctrine le rôle actuel de cette flotte.
Car la composante aérienne actuelle présente à mes yeux quatre défauts majeurs, deux défauts "techniques" et deux défauts de doctrine:
1°) son déploiement à partir de bases fixes la rend intrinsèquement vulnérable à une attaque conventionnelle, attaque à laquelle il serait impossible de riposter nucléairement, parce que le rôle dual des FAS (nominalement stratégique mais pratiquement tactique) ne permettrait pas de qualifier avec certitude l'attaque comme stratégique,
2°) malgré l'augmentation de portée de la version ASMPA du missile, la portée globale de ces vecteurs reste trop limitée (et l'allongement de la portée globale requiert la mise en place d'une complexe et fragile logistique de ravitaillement en vol) et leur lenteur (du fait d'un transport en vol subsonique jusqu'à distance de tir) est rédhibitoire,
3°) son statut hybride, mi-stratégique mi-tactique, serait aussi une source potentielle de confusion sur les intentions de la France en cas de décollage de ces avions lors d'une crise internationale aigüe, et crée donc un risque de dysfonctionnement de la dissuasion,
4°) la doctrine d'emploi de l'ASMPA comme “pré-stratégique” ou “de dernier avertissement” crée dans la logique de la dissuasion une “zone grise” qu'on peut considérer indésirable (des critiques similaires avaient aussi été émises dans les années 70 à l'encontre des missiles nucléaires tactiques Pluton, dont la nature même était contradictoire avec la notion de dissuasion stratégique.)
Plutôt que de ressusciter les missiles du plateau d'Albion dont l'implantation fixe souffrait du même défaut technique que les FAS, déployer à quelques douzaines d'exemplaires un Missile de Croisière Mobile à Longue Portée (MCMLP ayant une portée 4 à 5 000 km en vol supersonique) strictement dédié à la dissuasion nucléaire stratégique, serait une façon plus efficace de se protéger contre le risque de perte d'indétectabilité des sous-marins. Un autre avantage d'un tel système serait de pouvoir être au besoin transféré sur des navires de surface pour étendre le rayon d'action de la dissuasion nucléaire française à d'autres régions du globe, même si cela n'est pas actuellement un besoin stratégique identifié.
Dans un scénario “post-OTAN”, l'investissement minimal à réaliser lors du prochain quinquennat comprendrait donc un SNLE supplémentaire, soit un coût de 4,5 milliards d'euros, armement compris (coût à étaler sur une dizaine d'années) et le prototypage d'un MCMLP à déployer progressivement dans la période suivante (2022-2027) pour un coût total de programme de l'ordre de 1 milliard d'euros (compte tenu des acquis techniques et opérationnels des systèmes ASMPA et M51.)
Mon prochain billet sur la politique de défense et de sécurité sera consacré aux forces conventionnelles
(à suivre)