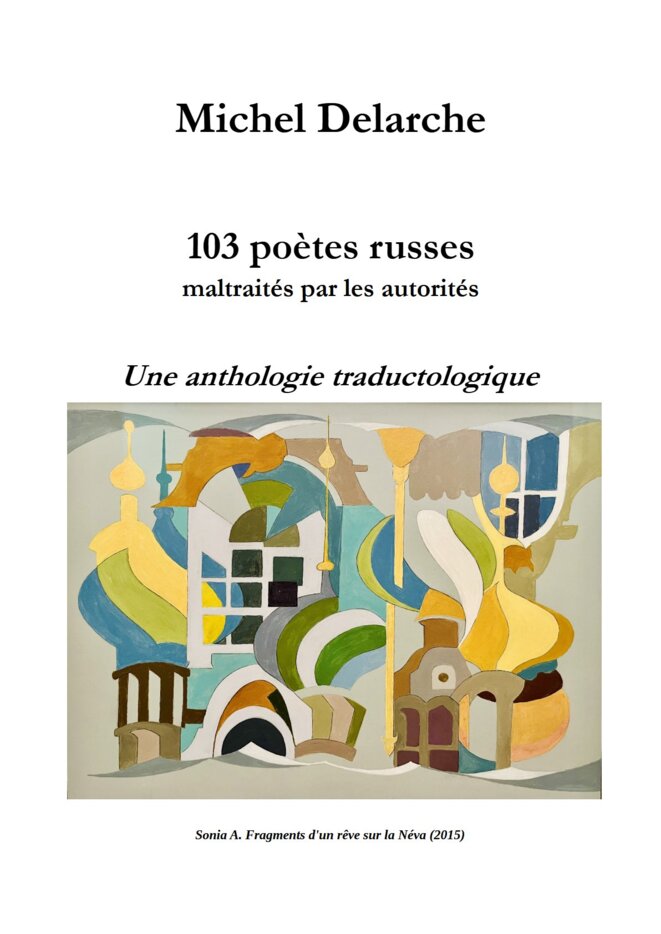Je poursuis ici mon analyse critique de l'ouvrage de Laclau "La Razon populista" sur un autre point qui m'a surpris: son usage sélectif et biaisé des concepts gramsciens.
Dans ce livre, Laclau reprend la terminologie gramscienne de l'hégémonie et explique fort bien que la démarche de construction d'une hégémonie politique et idéologique implique une certaine dose d'ambigüité dans les mots d'ordre (et ce n'est d'ailleurs pas spécifique aux mouvements populistes) mais une notion-clé, qui chez Gramsci permet de donner une armature stratégique au processus de construction politique et culturelle d'une large alliance au service du peuple, n'apparaît jamais chez Laclau, c'est le Prince Moderne ("il moderno principe") inspiré à Gramsci par le célèbre ouvrage de Machiavel (et d'ailleurs, les pages où Gramsci introduit ce thème dans ses cahiers de prison s'appellent "notes sur Machiavel"). Pour Gramsci, le Prince Moderne de son temps est évidemment le Parti Communiste, mais le concept peut s'entendre comme la nécessité, pour organiser et renforcer dans la durée un mouvement populaire émancipateur, de créer un intellectuel collectif présent dans tous les domaines où les luttes sociales, politiques et idéologiques doivent converger pour s'entre-consolider.
C'est un concept plus large et plus souple que la notion léniniste de "parti d'avant-garde" et c'est à mon avis un constituant essentiel de la pensée stratégique de Gramsci. Laclau se place dans un tout autre schéma où les organisations populaires se cristallisent dans un processus affectif d'adhésion/identification au chef charismatique.
Chez Laclau, le problème est résolu avant d'être posé, puisque le chef est là pour penser à la place de tout le monde, d'une part, et puisque la fragmentation du peuple en une multiplicité de groupes d'intérêt interdit de penser une planification stratégique des luttes en termes de priorités, d'autre part. Il critique vertement (et à mon avis injustement) Zizek lorsque celui-ci refuse que tous les éléments à prendre en compte dans le cadre de la lutte hégémonique soient mis sur un pied d'égalité et insiste (comme un paléo-marxiste qu'il est, selon Laclau) sur la primauté des rapports de production capitalistes et le caractère indéfiniment digestible par le système des autres dimensions de la lutte hégémonique (revendications multiculturelles, conflits de genres etc.). Dans une note de bas de page (p 296) Laclau indique même que J. Butler et lui-même n'avaient pas obtenu de réponse de Zizek quand à l'identification du sujet émancipateur et la ligne stratégique générale qu'il proposait.
Ici, il me semble que ce sont les cadors du post-modernisme qui se fourrent le doigt dans l'oeil et Zizek qui fait preuve de lucidité: on voit bien que les progrès émancipateurs réalisés sur certains fronts (reconnaissance des langues régionales en Europe, mariage homosexuel en France, "sexe indéterminé" dans l'Etat-Civil allemand, répression légale des discours racistes et discriminatoires...) restent parfaitement compatibles avec le talon de fer du capitalisme néo-libéral (même s'ils se heurtent à des oppositions dans certaines couches sociales traditionalistes; a contrario, les porte-drapeaux du capitalisme mondialisé que sont The Economist et The Financial Times n'ont aucun problème pour faire dans le progressisme sociétal...) En revanche toutes les tentatives de toucher si peu que ce soit aux mécanismes d'accumulation et de circulation du capital (taxe Tobin, politiques d'internalisation des coûts environnementaux par la taxe carbone, régulations bancaires...) se sont heurtées depuis des décennies à l'opposition résolue de l'oligarchie capitaliste et de ses porte-coton médiatiques.
Ce qui justifie cependant une attention soutenue à toutes les luttes culturelles que certains marxistes sommaires ont tendance à étiqueter comme "secondaires" (au sens de "subalternes") c'est que toutes les facettes de l'inégalité sociale ont tendance à se renforcer les unes les autres et que toutes les luttes doivent donc être coordonnées et articulées.
D'autres critiques de Laclau adressées cette fois à Hardt et Negri (immanentisme, radicalité sans contenu...) me semblent quant à elles plutôt justifiées.
En conclusion, il me semble que le rôle du Prince Moderne (qui reste à bâtir collectivement à l'échelon national et européen voire mondial) sera de promouvoir toutes les luttes qui contribuent à l'émergence de la société des producteurs selon des critères de sobriété écologique: il y a pour moi une convergence évidente entre le mouvement "locavore", le "slow food", la lutte tous azimuts contre le consumérisme et les multinationales qui l'alimentent (de Apple à Zara), la réduction drastique des chaînes d'intermédiation (dans lesquelles la plupart des maillons n'ont d'activité que purement virtuelle et spéculative, sans rapport avec la réalité du système productif) et la réinternalisation de tous les coûts non pris en compte par le système actuel. Je voyais la semaine dernière un reportage télévisé montrant des pourceaux hollandais engraissés et abattus en Belgique puis découpés en Roumanie avant d'être vendus en France, avec au centre de cette toile d'araignée un trader hollandais installé derrière une batterie d'écrans d'ordinateur; construire la société des producteurs consistera précisément à éliminer ce type de fonctionnement absurdement gaspilleur de ressources (et en prime créateur dans cet exemple de risques sanitaires évidents et de perte de traçabilité).
On peut penser que c'est justement l'absence du Prince Moderne qui explique l'épuisement si rapide de tous les mouvements récents contestant réellement, sincèrement mais fragmentairement (à la fois en terme de représentativité sociale et d'objectifs visés) l'ordre économique établi, d'ATTAC à Occupy Wall Street en passant par los Indignados.
Je terminerai sur quelques lignes de Gramsci à méditer (que je vous traduis au plus près du texte à partir de l'édition critique de référence publiée par V. Gerratana chez Einaudi dans les années 70) sur la formation d'un parti au sens de Machiavel, c'est-à-dire un groupe de citoyens oeuvrant de concert pour atteindre un même objectif (et en même temps au sens moderne que veut aussi lui donner Gramsci):
"En vérité, on peut dire qu'un parti n'est jamais complet et formé, au sens où chaque nouveau développement crée de nouvelles tâches, et dans le sens que, pour certains partis, se vérifie le paradoxe que ceux-ci sont complets et formés quand ils n'existent plus, c'est-à-dire quand leur existence est devenue historiquement inutile. Ainsi, puisque chaque parti n'est qu'une nomenclature de classe, il est évident que pour le parti qui se propose d'annuler la division en classes, sa perfection et sa complétude consiste à ne plus exister parce que les classes et donc leurs expressions n'existent plus." (volume III, p 1732-1733)