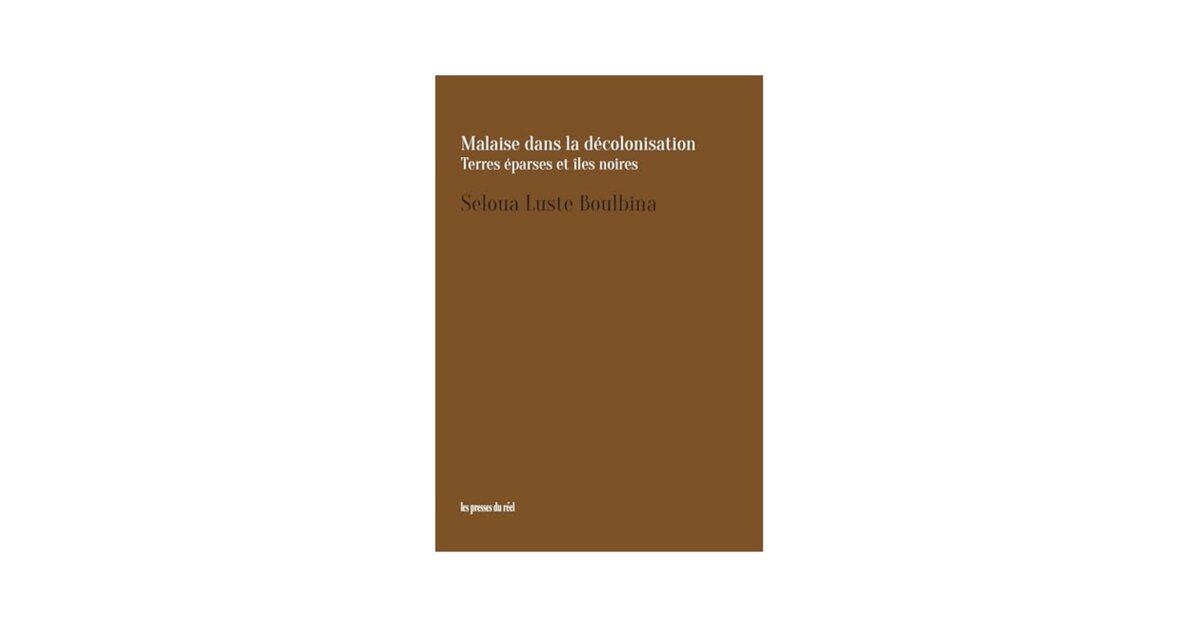
Agrandissement : Illustration 1
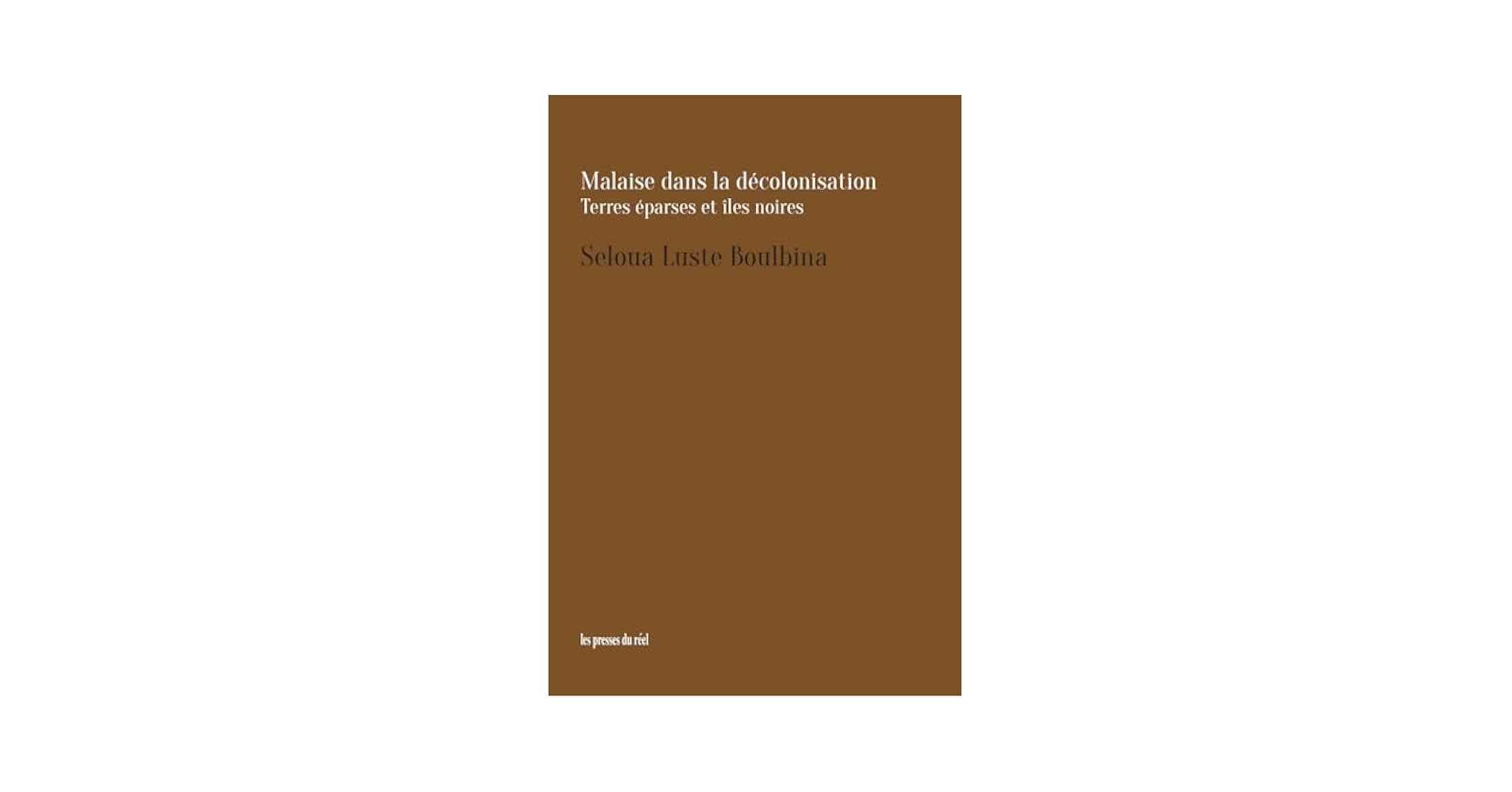
Pourquoi l'exemple de la société kanak en Nouvelle-Calédonie est-il particulièrement révélateur du « malaise » de la décolonisation ?
La Nouvelle-Calédonie fut une colonie pénitentiaire, une colonie de peuplement, et l’unique colonie française de réserves. L’enfermement des kanak (qui signifie « être humain ») dans les réserves, entamé en 1868, prend officiellement fin en 1946. Les kanak votent pour la première fois en 1957 seulement. Il faut attendre 1964 pour que des kanak obtiennent le baccalauréat : ils ont été écartés de l’enseignement proposé aux Européens. Il faut attendre 2024 pour qu’un kanak obtienne un doctorat de sciences politiques. L’hôpital psychiatrique ne devient civil (et non pas militaire) qu’en 1989. Dans les années 80, le racisme des Blancs assis sur la tradition de l’anthropologie physique faisant des Mélanésiens – melanos signifie noir - des êtres inférieurs au « Noir d’Afrique » est toujours publiquement affiché. Aujourd’hui, il est culturalisé, comme si les kanak appartenaient à une autre « espèce » humaine. Tout ce qui se rapporte à l’histoire et à la politique est, s’agissant des kanak, rattaché, à Nouméa, à la « culture kanak ». Les kanak seraient pauvres « à cause » de leur « culture ». En revanche, quand il s’agit de culture, on y parle de « coutume ».
La persistance de la colonialité sous le masque de l’égalité républicaine.
Aujourd’hui, l’apartheid social et la discrimination caractérisent le pays (qu’on nomme « territoire » en NC). En particulier à Nouméa. C’est moins vrai à la campagne (on dit « en brousse »). Les kanak occupent des emplois peu qualifiés (même s’ils ont fait des études supérieures). On préfèrera par exemple, à Nouméa, employer comme professeur de philosophie un non diplômé (mais « blanc ») à quelqu’un qui est doté d’un master de philosophie et d’un master d’anthropologie (« mais » kanak). La conformité à la norme blanche l’emportera sur la compétence professionnelle. On s’étonnera, par exemple, de la composition des détenus de la prison, le Camp Est, dont la presque totalité est kanak, sans intégrer la pénalisation sociale et politique du comportement des kanak. Des kanak « caillassent » : ils sont dangereux. Des milices blanches armées de fusils, à l’inverse, sont regardées comme garantes de la sécurité. C’est ce qu’on nomme « colonialité ». À cet égard, les rapports officiels – publics, mais peu lus - émanant de la république française ressemblent beaucoup, dans un autre style, aux écrits dits décoloniaux. Ils disent une réalité qu’on tait et qu’on nie en Nouvelle Calédonie. L’existence de kanak « riches » suffirait à « démontrer » que la colonialité a disparu.
Entre statu quo et revendication : privilèges blancs et précarité kanak.
Les non-indépendantistes défendent le statu quo. La majorité des Blancs et assimilés (car blanc ne désigne pas ici une carnation mais une position sociale) jouit de privilèges historiques qu’elle entend conserver. Elle veut la France sans ses impôts ni ses lois sociales. L’impôt sur le revenu n’apparaît en Nouvelle Calédonie qu’en 1981 alors qu’il date de 1914 en France hexagonale. Le Revenu de Solidarité Active (RSA), en vigueur depuis 2009 en France hexagonale, n’existe pas en Nouvelle-Calédonie quand, selon l’Isee, un Calédonien sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La précarité touche principalement la population kanak. Des amis kanak me parlent d’un plat de viande quand ils ont cuisiné une boîte de corned-beef. L’abolition des privilèges a bien eu lieu le 4 août 1789 dans un petit pays d’Europe mais non dans ses colonies. C’est le moteur de la révolution haïtienne, le vecteur des revendications indépendantistes. L’arrogance blanche assise sur une supériorité présumée et sur des privilèges matériels avérés procure, dans l’économie libinale calédonienne, d’intenses plaisirs narcissiques.
Selon vous, la décolonisation ne se limite pas à la conquête de l'indépendance politique. Vous établissez une distinction importante entre l'indépendance politique et la décolonisation. Pourriez-vous développer cette distinction ?
Trop nombreux sont ceux qui emploient le terme de « décolonisation » sans en explorer les significations, les enjeux, le contenu. D’autant que le terme est utilisé par les historiens pour désigner une période, l’accession à la souveraineté et surtout, de façon eurocentrée, la « perte » des colonies. L’originalité, en Nouvelle Calédonie, sous l’impulsion de Jean-Marie Tjibaou, était de faire de la « décolonisation » en Kanaky un préalable à l’indépendance. Je le comprends : mon père, né « indigène » en Algérie en 1928 a passé son bac puis fait des études supérieures. En 1954, seuls 488 « Français musulmans » poursuivaient des études supérieures pour une population de 13 millions d’habitants. C’est peu mais en NC c’était pire. En Martinique, Aimé Césaire, né en 1913, entre à l’ENS en 1935. C’est exceptionnel bien sûr mais le cas existe. Le lobby colonial calédonien, soutenu par l’État français – ou l’État français, soutenu localement par le lobby colonial – ne permet à aucun kanak d’obtenir le baccalauréat avant 1964. Or, pour l’indépendance, un personnel formé et compétent est nécessaire. C’est ce qui permet de prendre la mesure de la politique publique dite de « rééquilibrage » qui se heurte encore cependant à la structure raciale-coloniale archaïque de la Nouvelle Calédonie.
Nouvelle-Calédonie, Afrique du Sud : des indépendances inachevées.
J’ai plutôt examiné la décolonisation dans le cadre des indépendances ayant bénéficié aux autochtones, comme en Afrique, à l’exception de l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud ressemble plus à l’ancienne colonie, et à l’ancienne métropole, que les autres pays africains, en particulier l’Algérie, ancienne colonie de peuplement que les Européens ont quittée. Je les distingue des Amériques – à l’exception de Haïti – où les indépendances, plus anciennes, ont bénéficié aux Européens, ni en revanche aux autochtones, ni aux populations africaines déportées et asservies. Bien sûr, un certain nombre de problèmes y sont aigus, en particulier en matière de démocratie. La Nouvelle Calédonie ressemble structurellement à l’Afrique du Sud, mais sans indépendance. La décolonisation ne saurait donc se concevoir de façon exclusivement formelle comme accession à la souveraineté politique. Elle est une conquête de la dignité d’abord – comme le soutiennent les kanak – et de l’égalité : cela implique de se défaire des liens de subordination, des échanges asymétriques, des emprises hégémoniques, de l’idéologie moderniste, de la subalternisation culturelle. Pour le dire d’un mot, se décoloniser c’est, en reprenant Césaire, retrouver la saveur de soi.
Décolonisation : un travail quotidien entre incertitudes et héritages.
Mais il ne s’agit ni d’un processus, comme on a tendance à le dire en adoptant le point de vue de Sirius, ni d’un idéal à atteindre. Il s’agit d’un travail difficile, puisqu’il s’agit au fond de gagner toutes les indépendances réelles – toujours relatives – au jour le jour. De gagner sur l’adversité. Travail frappé d’incertitude car, comme le disait Assia Djebar, on ne sait pas si on avance ou si on recule, sachant que les obstacles internes et externes sont multiples. Les anciennes puissances coloniales n’ont pas disparu, la division économique du travail ne s’est pas éteinte : aux uns l’extraction des matières premières (comme le nickel en NC), aux autres la production et le commerce. Les hiérarchies culturelles ne se sont pas non plus miraculeusement dissipées. Les héritages, également, se sont transmis, laissant des traces ineffaçables. C’est pourquoi il faut intégrer la subjectivité – sa dimension inconsciente incluse - dans la conception de la décolonisation, repérer les traumatismes et les répétitions, les freins internes. J’ai ainsi dégagé, dans L’Afrique et ses fantômes (2015), trois grandes lignes quand il s’agit de sauver sa peau : l’histoire comme architecture intérieure, la langue comme politique interne, l’espace sexué car il ne faut pas oublier que les femmes sont les principales perdantes du capitalisme colonial. Les violences sexistes en NC en sont la marque.
Vous mobilisez plusieurs types de sources primaires : des archives coloniales officielles, des archives historiques écrites, des sources iconographiques et cartographiques, ainsi que des témoignages oraux. La partie biographique occupe une place centrale et originale dans l'ouvrage. Quelle est leur fonction dans votre méthodologie et comment contribuent-elles à nourrir votre analyse critique ?
Je crois en effet que les approches transversales – ou transgenres - tant sur le plan des « terrains » que des « disciplines » sont fécondes. Pour éviter trop d’angles morts. En particulier dans le langage. Formée à la philosophie et aux sciences politiques, je constate que les philosophes ne font pas toujours assez cas des situations particulières, en particulier lorsqu’ils sont normatifs ; alors que les politistes – suivis en cela par les journalistes - ne sont souvent pas suffisamment attentifs aux catégories auxquels ils recourent, et à leurs impensés, occupés qu’ils sont par les cas particuliers. Quand on dit « décoloniser » par exemple, à qui s’applique l’impératif ? Ne faut-il pas commencer par soi-même, surtout quand on est français, homme, et blanc par exemple ? Les puissants disposent généralement de plus de crédit (symbolique, imaginaire, réel) que les invaincus (catégorie que j’emprunte à Jacques Rancière). Ceci est une façon de dire qu’il existe des normes coloniales partout, et que les savoirs sont inévitablement situés. C’est la raison pour laquelle j’indique dans Malaise dans la décolonisation, comment je suis – nécessairement autobiographiquement et comme sujet et comme autrice – située. À l’opposé de celles et ceux qui ne se situent pas, parce qu’ils sont objectivement et subjectivement conformes à la norme coloniale.
Pourquoi la réparation reste une exception ?
Le titre est un clin d’œil à Freud, qui, hésitant entre « bonheur » et « malheur », choisit « malaise » pour dire la « civilisation ». Comment aborder, en effet, l’agressivité, l’hostilité, la cruauté ? La liberté et la conscience morale ? Comment penser, pour ma part, la colonialité, la décolonisation, la restitution, la collection, la race, la réparation ? C’est ce que je m’efforce de faire dans Malaise dans la décolonisation. J’ai consacré trois chapitres à la race, comme phénomène et rapport social, en examinant la littérature anthropologique ; la littérature et sa description des issues individuelles trouvées pour échapper à l’emprise raciale ; la question des morts et des vivants (quand la vie ne vaut rien, les morts comptent beaucoup). Pour le dire vite, la colonialité, la collection (objets d’art et restes humains), la race (ses hiérarchies imaginaires et ses discriminations concrètes) sont la règle. La décolonisation, la restitution des biens aux invaincus, la réparation demeurent des exceptions à cette « règle » de fait, tant et si bien que la décolonisation, pour nécessaire qu’elle soit, est quasi impossible, mais il faut partir de là ; que la restitution s’effectue au compte-goutte, surtout en France où elle est confondue avec le prêt ; qu’enfin, la réparation est colonialement comprise comme la réconciliation des invaincus avec ceux qui les ont opprimés, pour faire table rase du passé, sur le modèle « mémoire et réconciliation ».
Penser l’histoire au-delà du tête-à-tête colonial
J’ai souhaité ne pas rester moi-même cantonnée au « cas d’espèce » et proposer une vision globale. En effet, la situation coloniale renvoie au face à face : un pays colonisé ou postcolonial est isolé de sa région et n’est regardé qu’à partir de sa relation ou son rapport à la métropole (comme on le dit colonialement à Nouméa), ou à l’ancienne métropole impériale. Le comble du face-à-face postcolonial est incarné par le rapport France-Algérie : la France n’a jamais « digéré » la victoire gagnée par des « inférieurs », les Algériens, comme elle n’a jamais accepté la victoire antérieure d’autres « inférieurs », les Haïtiens. Tout se passe comme si l’Algérie devait, comme Haïti par le passé, s’acquitter d’une dette envers la France. Elle « humilierait » la France : le langage est grotesque. Du reste, ce qui est fait en Nouvelle Calédonie a déjà été fait en Algérie, où il n’existait ni justice sociale, ni justice sur le plan judiciaire, ni police impartiale (c’est une contradiction dans les termes). Par conséquent, il est impératif de s’extraire du face à face. L’histoire coloniale, en ce sens, est, comme la politique coloniale, une négation de la géographie.
Voir autrement : l’expérience vécue est une ressource.
Je souhaite en général, également, ne pas me priver de ressources : en retenant exclusivement, par exemple, pour des raisons de prestige, d’allégeance ou de révérence, des références académiques. Et j’aime les mises à plat car ce sont elles qui font apparaître, à mon sens, les reliefs de la réalité. C’est pourquoi je n’ai pas de références privilégiées et apprends beaucoup, quoique différemment, de la littérature et des arts visuels. Il me semble en effet, aussi, que l’observation mérite d’être cultivée et qu’il faut l’étendre de l’expérience vécue aux textes canoniques. L’observation – la perception – est bien sûr intrinsèquement liées à l’activité intellectuelle. Quand je vois le regard noir d’une voisine porté, à Nouméa, sur une militante indépendantiste kanak que je reçois chez moi et qui, à ce moment-là, lui tourne le dos, c’est la preuve par le fait qu’un.e kanak n’a pas de place dans ce « monde-là » et qu’elle n’a pas à y pénétrer. Cela équivaut à une intrusion. Profession de la voisine ? Institutrice. J’observe aussi qu’un autre voisin, homme politique dit « loyaliste » invite uniquement des « Blancs ». Un autre voisin encore, pilote, me dit travailler avec des kanak mais n’en fréquenter aucun hors de son activité professionnelle, non par animosité, mais comme s’il s’agissait d’une « loi de la nature ».
Décoloniser l’État qui ne s’est jamais décolonisé
C’est d’un grand enseignement. Cela me rappelle les « on s’entendait bien avec eux », « on vivait ensemble », des « pieds-noirs » qui ont envie de me parler – aujourd’hui encore - pour me confier combien « l’entente » était bonne. Sans que quasi jamais ils ne disent que l’ordre colonial était à leur profit. Sans que jamais ils ne disent combien ils médisaient : mépris, paternalisme, infériorisation, disqualification. Dans la société française, cette médisance historique se perpétue dans les propos ordinaires, les discours politiques, les commentaires médiatiques, dans et hors des institutions. Comment, par conséquent, « décoloniser » la Nouvelle Calédonie quand la France ne s’est pas et n’est pas elle-même décolonisée, au plus haut sommet de l’État ? Au point que le premier ministre actuel autrefois chargé des « Outre-Mers », puis des Armées, se réclame d’un Pierre Messmer, qui fut lui aussi chargé des Armées et des « départements et territoires d’Outre-Mer », puis premier ministre. Messmer s’était formé à la pensée et à la pratique coloniale à l’École nationale de la France d’outre-mer. Administrateur colonial, il est responsable d’atroces exactions au Cameroun et participe aux mauvais coups français, en particulier au Biafra. Quant à l’Algérie, il a déclaré : « Je ne suis jamais retourné en Algérie et je n’y retournerai jamais. Ce pays sanguinaire me fait horreur ». No comment.
Note bio et bibliographie

Agrandissement : Illustration 2

Seloua Luste Boulbina est spécialisée en études postcoloniales, en philosophie et en sciences politiques. Elle est connue pour ses travaux sur la décolonisation des savoirs, l'empreinte postcoloniale en Afrique et les questions intellectuelles et culturelles liées aux anciens territoires colonisés. Elle a été directrice de programme au Collège international de philosophie et a publié plusieurs ouvrages parmi lesquels :
1. L'Afrique et ses fantômes : Écrire l'après – 2015 - Présence Africaine.
2. Dix penseurs africains par eux-mêmes (dir.) - 2016 - Chihab éditions
3. Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs (art, littérature, philosophie) – 2019 - Les Presses du réel.
4. Le Singe de Kafka et autres propos sur la colonie – 2019 - Les Presses du réel.
5. Alger-Tokyo – Des émissaires de l'anticolonialisme en Asie - 2022 - Les Presses du réel.
6. Sortir de terre : une philosophie du végétal – 2025 - Zulma.
7. Malaise dans la décolonisation : terres éparses et îles noires – 2025 - Les Presses du réel.



