
Au cœur des univers des musiciens cairotes
Dans son ouvrage Farah 1, musiciens de noces et scènes urbaines au Caire1, le chercheur en anthropologue Nicolas Puig 2 nous entraîne au cœur du « micro-monde » des musiciens des cafés de l’avenue Mohamed-Ali, ancien centre névralgique de la musique égyptienne. À travers une démarche à la fois anthropologique et ethnographique, il explore les contextes de vie, les univers intimes, les cultures professionnelles et les espaces relationnels d'un groupe de musiciens spécialisés dans l'animation des mariages de rue (afrah baladi 3). Ces cérémonies, qui se tiennent sur des estrades dans les quartiers populaires ou dans les cafés d'artistes de cette avenue du vieux Caire, autrefois appelée Sultan Hassan, perpétuent une tradition festive présente depuis plus d'un siècle, faisant de ce lieu un point de ralliement incontournable pour les musiciens égyptiens.
Héritiers lointains de cette tradition, ces artistes partagent des références communes façonnées par leur métier et les lieux où ils se produisent, principalement dans des milieux populaires pour un public modeste, animant un large éventail d'événements : fêtes de rue, mariages, circoncisions, célébrations de réussite scolaire, fiançailles, naissances, anniversaires, petites soirées privées dans des appartements, mais aussi cabarets et clubs intimistes.
L’enquête de terrain brosse le portrait d’un univers social et culturel majoritairement masculin dans lequel l’activité musicale se heurte à deux enjeux majeurs : la transformation des conditions de travail et une forte stigmatisation sociale. Ces éléments génèrent chez les musiciens un sentiment d'absence de reconnaissance, tant sur le plan professionnel que social. Ils ont de plus en plus de mal à perpétuer leurs pratiques collectives, en raison de la précarité et du manque de moyens.
Du terrain et de la méthode…
Dans l’introduction de l’ouvrage, intitulée Un terrain en musique, Nicolas Puig dévoile les savoir-faire et savoir-être méthodologiques qui ont guidé sa démarche. Sur une trentaine de pages, il nous entraîne dans les coulisses de son enquête de terrain, détaillant les outils ainsi que les moyens matériels et humains mobilisés pour la mener à bien.
S’appuyant principalement sur l’observation participante 4, il a accompagné les musiciens dans leurs lieux de performance et dans les diverses situations de leur vie quotidienne. Cette immersion lui a offert un accès direct à leurs pratiques musicales et sociales, ainsi qu’aux relations et interactions qu’ils entretiennent entre eux, avec leur public, leurs familles, leurs voisins, etc. Comme il l’explique lui-même : « J’envisageais ainsi de suivre les artistes dans leur quotidien pour restituer les différentes situations dans lesquelles, en prise avec autrui, ils modulaient les éléments de la présentation de soi et s’adaptaient au contexte de l’interaction ».
Parallèlement, l’auteur a recueilli la parole des musiciens sur leur vie professionnelle, dans le but de comprendre le fonctionnement du marché musical à travers leurs expériences. Ces échanges, adaptés au parcours de chaque interlocuteur, ont été transcrits sous forme de récits de vie. Les entretiens ont pris des formes variées — discussions informelles, rencontres formelles — et se sont déroulés au sein de deux cercles d’interlocuteurs : un noyau d’une dizaine d’informateurs privilégiés, rencontrés dans un appartement, d’une part. Et d’autre part, un groupe plus large de musiciens rencontrés dans différents contextes : cafés de l’avenue Mohamed-Ali, tournées, mariages de rue, clubs ou même tombeaux de saints.
Pour enrichir cette enquête anthropologique, Nicolas Puig a également eu recours à d’autres techniques de collecte de données : observation flottante 5 , prises de photographies et enregistrements vidéo, notamment pour capturer les performances musicales, les cérémonies et les scènes de fête.
Un lieu, des hommes : entre prestige et stigmatisation
Dans la première partie de son ouvrage Un lieu et ses hommes, Nicolas Puig retrace l’histoire de l’avenue Mohamed-Ali, autrefois haut lieu de la vie musicale cairote. Il en décrit l’emplacement, les caractéristiques, l’évolution, les singularités, l’apogée, l’âge d’or… puis le déclin.
Ce quartier du vieux Caire, aujourd’hui dévalorisé, fut longtemps le point de ralliement des plus grands chanteurs, chanteuses et instrumentistes égyptiens. On les retrouvait dans les cafés, véritables centres névralgiques où circulaient les nouvelles, où se forgeaient les liens et se concluaient les contrats.
Au départ, ces cafés accueillaient deux mondes distincts : d’un côté, les cuivres des fanfares locales (hasaballa), de l’autre, les instrumentistes de la musique arabe traditionnelle (‘ûd, qânûn). Les années 1940 virent l’arrivée des accordéonistes, puis les années 1970 celle des pianistes.
Malgré la dégradation de son image et un déclassement social qui fait peser sur lui un certain opprobre, l’avenue Mohamed-Ali reste une référence incontournable pour les musiciens. Les chanteurs qui la fréquentent interprètent aujourd’hui surtout des chansons mi-savantes ou plus légères.
Entre interdit religieux et illégitimité sociale
Dans la partie intitulée Amour, haine et prestige : les musiciens sur la scène urbaine », l’auteur analyse les déviances perçues de la profession et la stigmatisation qui y est associée.
Les témoignages de musiciens spécialisés dans les musiques populaires urbaines, jouées notamment lors des mariages baladi, font apparaître deux sources majeures de discrédit : l’interdit religieux (harâm) et la mauvaise réputation sociale.
Ce groupe subit en effet une double marginalisation. Sur le plan religieux, il est rejeté par de nombreux théologiens. Sur le plan social, il inspire méfiance : le métier est jugé illégitime et, de surcroît, souvent assimilé à une activité féminine, ce qui entache davantage leur image.
Non issus de formations académiques, ces musiciens exercent une profession qui les place en marge du reste de la société. Leurs contraintes professionnelles imposent un rythme de vie inversé – ils travaillent la nuit et dorment le jour – accentuant leur décalage avec le monde « ordinaire ».
Leur art, fondé sur l’improvisation, est intimement dépendant du public, les obligeant à s’adapter constamment aux goûts et aux demandes des spectateurs. Mais cette instabilité artistique se double d’une précarité sociale et économique qui les pousse à diversifier leurs moyens de subsistance. Beaucoup cumulent un second emploi pour assurer leur respectabilité, améliorer leurs conditions de vie et obtenir une certaine reconnaissance. Dans ce contexte, rester durablement musicien est souvent perçu comme synonyme d’échec professionnel et social.
La Noqta : le don monétaire et sa signification…
La partie intitulée « Sur scène : centralité de la circulation d’argent » est consacrée à une analyse détaillée du farah, de son organisation spatiale, de son fonctionnement, de son déroulement et de la disposition spatiale des invités.
À titre d'exemple, dans ce type de cérémonie festive, les femmes ont une place bien déterminée. Elles sont placées « dans l’angle mort des regards masculins, à l’écart, loin de l’estrade et des invités », écrit N. Puig. La présence d'une estrade (masrah 6) confère au lieu et à l'événement une dimension essentiellement dramatique.
Depuis environ une trentaine d'années, ces fêtes de rue se caractérisent par un phénomène qui tend à se généraliser et à devenir prépondérant : « leur polarisation sur la circulation de l'argent et les salutations publiques adressées aux donateurs et aux personnes de leur choix ». En d'autres termes, lors de ces cérémonies, qui fonctionnent sur la base d'une relation réciproque de don et de contre-don, l'argent est devenu un élément central. Il est rendu lorsque l’un des invités donateurs organise à son tour un farah. L’argent échangé lors de ces festivités est désigné sous le nom de la Noqta, qui signifie « pratique du don monétaire »
Les principaux acteurs de ce type de spectacle sont les chanteurs, les danseuses, les instrumentistes et le nabatshi, l’ambianceur, qui est le personnage central de ces festivités de rue. Autrefois, il était désigné sous le nom de shawish el-masrah (le gardien de l’estrade).
Son rôle consiste à animer la fête en annonçant l’arrivée des invités, à recevoir l’argent des mains des donateurs et à scander leurs noms dans le micro tout en énumérant leurs qualités. Cette annonce est considérée comme un acte d'hospitalité et de respectabilité.
L’argent est ensuite reversé à l’organisateur de la fête ou à l’orchestre. L’argent échangé est « placé sur le devant de la scène ». Sa mise en scène de manière visible semble être valorisée à l’extrême. C’est pourquoi le nabatshi le garde dans sa main durant toute la phase de salutations des invités donateurs.
Au cours de ces fêtes de rue, où la priorité est accordée aux invités-donateurs et aux salutations, la musique et l’orchestre occupent une place secondaire. Il y a « une sorte d’assujettissement de la musique à l’accueil des invités par l’ambianceur », écrit N. Puig.
Au cœur de microscopiques parcelles de vie…
Dans le second chapitre, intitulé Récits de musiciens égyptiens, l’auteur restitue la parole de quatre musicien·ne·s : trois hommes et une femme, sous forme de récits de vie recueillis en 2002. « Le Maître », Ahmed Wahdan (nom de scène), luthiste, pianiste et chanteur ; « l’Héritière », Rana Wahdan, fille d’Ahmed Wahdan, pianiste ; « An-Nâgih » (celui qui a réussi), Mahmoud El-Asmar (nom de scène), percussionniste ; « le Désabusé », Réda As-Sahîr (nom de scène : Ridha le Magicien), percussionniste. Ces quatre personnes ont été choisies en leur qualité de professionnel·le·s représentant·e·s de la profession et connaisseur·se·s du milieu.
Ces récits autobiographiques sont importants, car ils renseignent sur les trajectoires, les environnements, les actes, les conditions de vie et les raisonnements de chaque personne interviewée. D'autre part, ces récits permettent de saisir et de comprendre le vécu des musiciens de l'avenue Mohamed-Ali de l'intérieur, ainsi que les difficultés de ce métier qui a de plus en plus de mal à perdurer.
En conclusion, cet ouvrage, fondé sur une étude qualitative du vécu – gestes, interactions, discours et pratiques – des musiciens des scènes urbaines du Caire, offre un éclairage anthropologique sur un domaine longtemps méprisé et socialement dévalorisé en Égypte, et largement méconnu en Occident.
Le regard singulier que N. Puig porte sur l’univers foisonnant des musiciens animant les afrah baladi 5 dans les quartiers populaires cairotes conjugue la sensibilité d’un « insider » et la distance d’un « outsider ». Cette double posture permet de dévoiler un milieu marginalisé, de mettre en lumière son “sens commun” et d’en comprendre les codes, grâce à une immersion longue et attentive sur le terrain.
Tout au long de l’étude, l’auteur maintient un équilibre subtilement dosé entre détachement analytique et participation active (E. Hughes, 1996). Ce positionnement d’observateur participant rend possible une appréhension fine des pratiques musicales et culturelles, des dynamiques propres au contexte “naturel”, ainsi que des conditions de vie et des mécanismes structurant cet univers.
Proche des acteurs étudiés, cette recherche constitue aussi une invitation à explorer certaines réalités des espaces urbains de la capitale égyptienne. Agréable à lire par sa clarté et la qualité de son analyse, l’ouvrage mériterait d’être traduit en arabe, tant il pourrait contribuer à transformer les perceptions et représentations que les Égyptien·ne·s ont de ce corps de métier en déclin, stigmatisé et dévalorisé.
Notes
1. Le vocable Farah signifie « joie ». Il désigne aussi l’ensemble des réjouissances égyptiennes. D’une manière plus précise, il fait référence à la fête de mariage. Les Farah ou Afrah (pluriel du terme Farah) renvoient aux lieux de performances des musiciens spécialisés qui animent les cérémonies de mariage.
2. Nicolas Puig, Farah, musiciens de noces et scènes urbaines au Caire, Arles, Actes Sud-Sindbad, coll. La Bibliothèque arabe », 2010, 218 p
3. On parle de fêtes baladi, populaires, traditionnelles par opposition aux fêtes afrangui qui ont lieu dans les grands hôtels, clubs…
4. L’observation participante est une méthode ethnologique et sociologique développée dans les années 1925-1930 par l’anthropologue et ethnologue polonais Bronislaw Kasper Malinowski (1884-1942). Cette méthode mobilisée pendant des enquêtes de terrain implique la totale immersion du chercheur dans son terrain d’investigation.
5. L’observation flottante est une méthode de recherche prônée par Colette Pétonnet. Elle consiste à ne pas focaliser son attention sur un objet ou un aspect particulier, mais à la laisser « flotter » en toute liberté sur le terrain d'étude. Cette « disponibilité attentive » vise à favoriser une observation sans a priori, tout en restant attentif aux points de repère et aux convergences qui permettent de mettre à jour les mécanismes de fonctionnement du phénomène observé.
6. Masrah signifie théâtre en arabe.
Qui est l’auteur ?
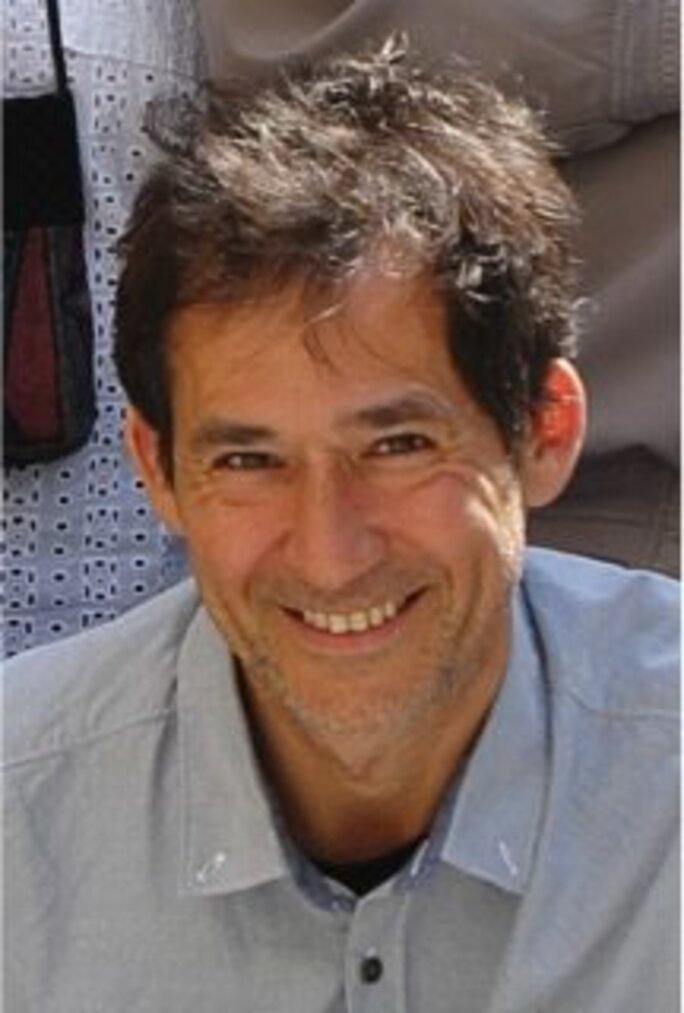
Nicolas Puig est un anthropologue spécialisé dans les migrations, les réfugiés, et les musiques du Proche-Orient. Sa bibliographie comprend plusieurs ouvrages, articles et chapitres d'ouvrages publiés depuis les années 2000.
Parmi ses ouvrages :
Bédouins sédentarisés et société citadine à Tozeur (Sud-ouest tunisien), Paris, Karthala, 2004.
Farah. Musiciens de noce et scènes urbaines au Caire, Paris, Sindbad-Actes Sud, 2010.
L'urbanité des marges. Migrants et réfugiés dans les villes du Proche-Orient, co-dirigé avec Kamel Doraï, Téraèdre, 2012.
Exils syriens. Parcours et ancrages (Liban, Turquie, Europe), avec Assaf Dahdah, Le Passager Clandestin, 2018.
Lives in Music. Mobility and Change in a Global Context, Routledge, 2020.
Babels : enquêtes sur la condition migrante, Seuil, 2022.
Il a également écrit de nombreux articles sur des thématiques liées à l'urbanité, la musique, les migrants palestiniens au Liban, et les pratiques culturelles migrantes.
Voici quelques titres d'articles récents :
"Amour, honte et prestige au Caire" (Revue L’Homme, 2009).
"Villes intimes : expériences urbaines des réfugiés palestiniens au Liban" (2012).
"La cause du rap, Engagements d’un compositeur palestinien au Liban" (2012).
"Réduire l’étrangeté. Interactions entre installés arabes et migrants asiatiques sur un marché de Beyrouth" (2017).



