
Agrandissement : Illustration 1
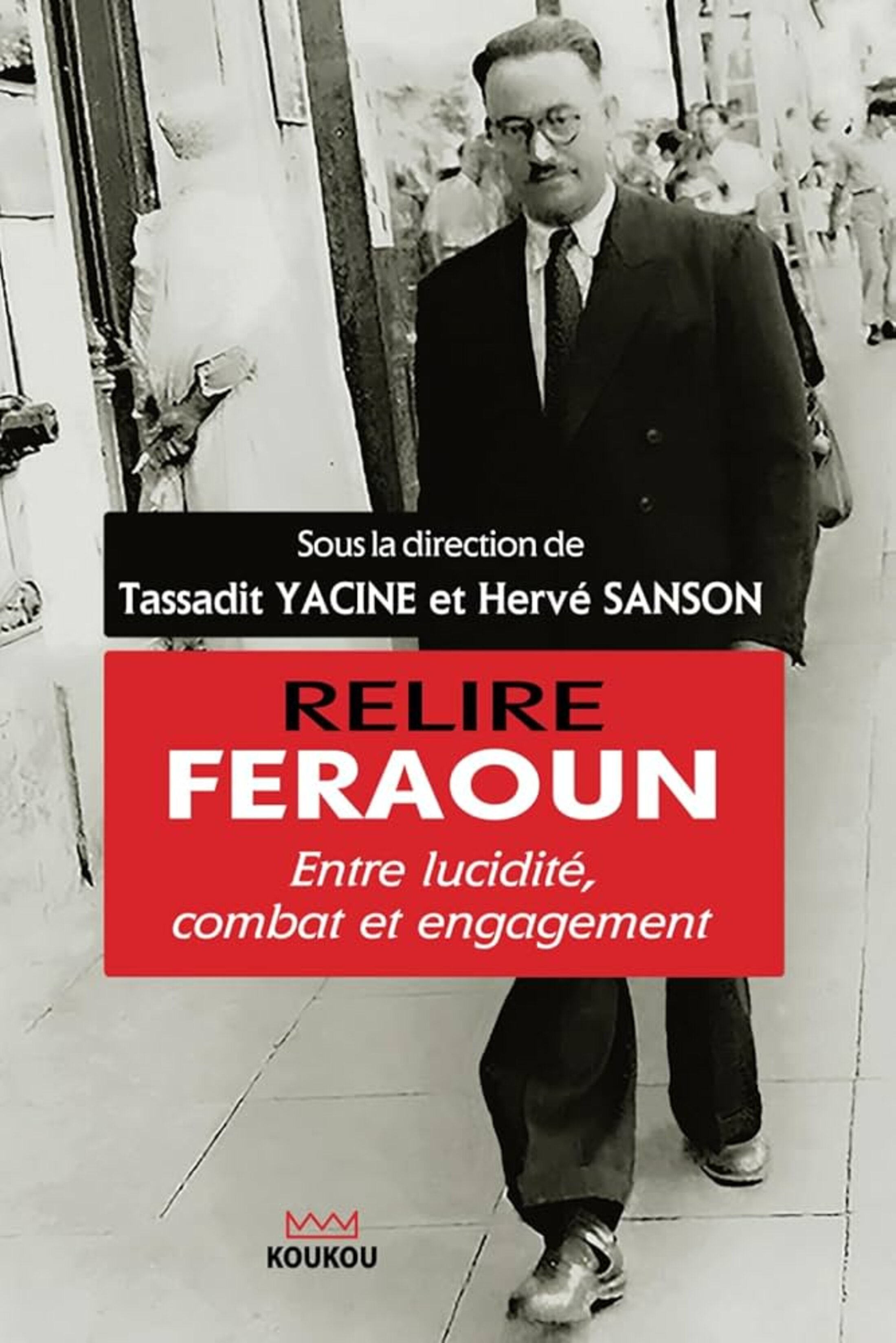
"Cette critique des valeurs patriarcales s'accompagne d'une grande tendresse exprimée à l’égard de sa culture et de ces mêmes valeurs villageoises dont il est l’héritier. Bien qu’il n’attaque pas frontalement ce système, on peut dire que Feraoun fut féministe et l’un des premiers à dénoncer l’instrumentalisation du corps des femmes en temps de guerre, à travers le recours aux viols de masse." Hervé Sanson au sujet de Mouloud Feraoun
Nadia Agsous : Vous qui connaissez bien Mouloud Feraoun pour l’avoir étudié, quel genre d’homme, d’intellectuel et d’écrivain était-il ?
Hervé Sanson : Feraoun était un intellectuel « impliqué », comme je le disais. Il était immergé dans sa société, celle qui l’avait vu naître. Il a vécu dans le « bled », en Kabylie, jusqu’à l’été 1957, dans le "bled", puis à Alger, dans le quartier du Clos-Salembier, près de ses élèves. Il se consacrait entièrement à ses fonctions d'enseignant, de directeur d'école, puis d'inspecteur des Centres sociaux, tout comme à son rôle de père de famille et d'écrivain. Très occupé, il devait voler quelques moments dans la journée afin de pouvoir se livrer à son activité d’écriture. N’oublions pas qu’en Kabylie, en tant que lettré et cheikh du village, il était sollicité continuellement pour servir de médiateur et donner des conseils. Son œuvre d’écrivain, celle que la postérité a évidemment retenue, a donc dû sans cesse composer avec ces contraintes diverses et un emploi du temps particulièrement chargé.
Quel est l’intérêt de lui consacrer un livre qui revisite son œuvre 62 ans après son assassinat ?
Tassadit Yacine et moi-même avons jugé qu'il était temps de renouveler l'apport critique de cette œuvre qui avait longtemps souffert de lectures orientées idéologiquement et donc réductrices, ou à tout le moins biaisées. L’aspect littéraire de cette œuvre, le travail d’élaboration scripturale, ont notamment été longtemps occultés, non pris en considération, jusqu’aux travaux de Robert Elbaz ou Martine Mathieu-Job au tournant du XXIème siècle. Nous avons donc voulu prendre en compte, à la suite de ces travaux récents, la dimension littéraire de l’œuvre de Feraoun, et montrer à quel point son style est un style faussement « scolaire », naïf, et combien, au contraire, son œuvre est le fruit d’un véritable travail d’écriture, concerté. À ce titre, la génétique des textes, l’une des méthodes critiques présentées dans l’ouvrage, en tenant compte des manuscrits participe à cette mise en valeur de l’écriture. Par ailleurs, il nous paraissait capital de réinterroger une œuvre qui a encore beaucoup à nous dire, plus de soixante ans après l’Indépendance, certains partis pris idéologiques régnant dans les années soixante ou soixante-dix en Algérie n’ayant plus cours.
Quels sont les nouveaux éclairages que cet ouvrage met en lumière sur Mouloud Feraoun, son œuvre, son époque ?
L’intérêt majeur de l’ouvrage, je crois, réside dans le fait qu'il aborde l’œuvre sous différents angles, mais aussi dans la prise en compte du parcours de l’homme et du contexte historique de sa production (il faut lire la contribution de Zineb Ali Benali à ce sujet). Ainsi, des approches historiques (Domenico Canciani, Emmanuel Sacriste), sociologiques (Jean-Pierre Faguer), relevant des études de genres (Inès Kremer) ou littéraires et stylistiques (Salah Ameziane) composent notre livre. Certaines contributions s’intéressent plus spécifiquement à des productions de Feraoun jusque-là délaissées ou peu abordées : Guy Basset s’intéresse ainsi à Jours de Kabylie et à l’élaboration de cette œuvre composite illustrée par Charles Brouty, tandis que Nicholas Harrisson met en lumière pour la première fois l’élaboration de la série de manuels scolaires (L' Ami fidèle) par Feraoun alors qu’il est aux Centres sociaux. Au-delà de l’objectivité apparente de ce type de manuels, ce chercheur révèle des choix particulièrement éclairants sur le plan intellectuel et idéologique de la part de leur concepteur.
Enfin, nous avons voulu donner la parole à trois écrivains maghrébins contemporains de générations différentes : Habib Tengour et Samira Negrouche pour l’Algérie ; Tahar Bekri pour la Tunisie. Chacun d’eux nous livre « son » Feraoun et nous explique en quoi cette œuvre lui parle.
Son œuvre a fait l’objet de lectures réductrices et d’interprétations falsificatrices. Comment expliquer que le monde universitaire ait mis longtemps pour analyser son œuvre à sa juste valeur ?
Précisément, à cause des lectures que vous évoquez, qui étaient tributaires du climat politique et idéologique de l’époque (taxant Feraoun d’ « assimilé » au mieux, de « traître », pas suffisamment nationaliste, au pire). Ces lectures ont grevé une réception plus juste de l’œuvre, autrement dit le fait que Feraoun est d’abord un écrivain, et un grand écrivain. Il a donc fallu un certain recul, une décantation, pour pouvoir appréhender loin des passions et des parti-pris de cette époque, l’œuvre à sa juste mesure.
Pendant la période coloniale, Feraoun n’était pas dans une situation confortable. Les autorités coloniales sollicitaient son soutien. L’Armée de libération nationale (ALN) lui demandait également des engagements. Comment vivait-il cette situation et comment parvenait-il à s'en sortir ?
En effet, il était pris en étau par les deux camps en présence. Il lui fallait composer quotidiennement avec chacun d'eux. Pour pouvoir continuer sa tâche : instruire ses jeunes élèves, les mener sur la voie du savoir et des diplômes, et ainsi servir l’Algérie de demain. Ceux qui n'ont pas vécu cette situation ont du mal à imaginer à quel point elle était compliquée et combien elle le faisait danser sur l'abîme au jour le jour. Feraoun a côtoyé dignement les autorités coloniales et l’Armée française sans se renier et en tâchant de ne pas leur donner trop de gages. Il lui fallait toutefois accepter occasionnellement des invitations aux soirées et cocktails donnés par ces autorités, et « ménager l’adversaire ». Mais ces autorités n’étaient pas dupes : elles savaient quelle était sa position. Ainsi, Jacques Achard, administrateur civil des Ouadhias, et futur chef de l’OAS dans le secteur de Bab el Oued, l’avait menacé explicitement en lui expliquant qu’il devait faire attention et se montrer plus reconnaissant envers la France qui lui avait tout donné. Il pouvait très bien le retrouver un matin, couché dans un fossé, et cela n’aurait absolument rien changé au fait qu’il émargeât au Seuil. Il avait même ajouté : « Ainsi, même un simple troufion ici peut vous mettre un coup de pied au cul ! »
Nous savons par ailleurs qu’il avait des contacts avec l’ALN, et que lorsque son père est mort durant la guerre, il a pu se rendre à son enterrement, les forces de l’ALN lui garantissant la libre circulation. Son Journal indique par ailleurs clairement qu’il comprenait et soutenait le principe de l’insurrection du 1er novembre 1954. Il soutenait également clairement l'indépendance de l'Algérie. Finalement, la pression devenant intolérable et les menaces se multipliant, il avait dû quitter Fort-National à l’été 1957 pour rejoindre Alger.
Sa position durant la guerre d'Algérie a été mal jugée. Quelles sont les raisons de cette réputation ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette mauvaise réputation. Tout d’abord, il s'est écoulé beaucoup de temps entre l’élaboration de l’œuvre et sa parution. Ainsi, les positions anticolonialistes de Feraoun n’étaient pas forcément connues du grand public. Le premier roman, qui aborde explicitement la guerre d’indépendance, est La Cité des roses (à l’origine L’Anniversaire, titre qui sera « récupéré » pour une publication posthume réunissant divers textes et le début de son dernier roman, dont seuls trois chapitres ont été rédigés), mais celui-ci a été refusé par Le Seuil à l’époque. Il ne sera publié qu’en 2007 en Algérie.
Par ailleurs, Le Fils du pauvre, qui avait initialement été publié en 1950 dans une version un peu confidentielle, a été repris par Le Seuil en 1954 dans une version plus courte, sacrifiant la troisième partie qui évoquait la répression des manifestations du 8 mai 1945.
Enfin, le Journal de Feraoun, nettement engagé, n’a été publié qu’en 1962, après l’assassinat de l’écrivain par l’OAS. Feraoun était d’ailleurs conscient de la teneur hautement subversive de son journal pour les autorités françaises, et il cachait les cahiers de son journal parmi ceux de ses élèves, au cas où une perquisition aurait eu lieu. Mais sa position nuancée, qui soutenait l’indépendance, mais critiquait certaines dérives du FLN qu’il avait pu constater, a faussé la perception qu’en Algérie l’on pouvait avoir de lui.
Dans ses écrits, Mouloud Feraoun a abordé plusieurs sujets courageux, voire tabous : l’homosexualité, les relations entre musulmans et chrétiens, la guerre, les dérives du FLN, les exactions de l’armée française. Il tournait en dérision les principes du patriarcat. Il a également dénoncé le fait que les filles n’aillent pas à l’école ainsi que les viols perpétrés par l’armée française et par le FLN sur les femmes. Ces éléments font apparaître Feraoun comme un féministe et un avant-gardiste. Comment expliquez-vous ce positionnement qui lui avait attiré des inimitiés de toutes parts ?
Feraoun était un homme fondamentalement honnête : il se contentait de rapporter ce dont il était témoin. Il mettait la vérité au-dessus de tout : il rapportait les injustices auxquelles il assiste ou dont on lui fait part, qu’elles soient le fait des Français ou bien de l’ALN. La défense d’une cause ne l’amenait pas à accepter les injustices souvent présentées comme des « dommages collatéraux », et que l'on dit parfois « justifiées par la fin ». Dans tous les cas, il s’interdit de passer sous silence tel ou tel fait, sous le prétexte que cela nuirait à la cause.
Mais c’était également un homme progressiste. Ainsi, il a toujours défendu et encouragé l’instruction des filles, y compris celle de ses propres filles. Il critique donc, dès sa première œuvre, Le Fils du pauvre, le système patriarcal dans lequel il a grandi, mais il le fait subtilement, sans attaquer ce système de front, ce qui serait contre-productif. Cette critique des valeurs patriarcales s'accompagne d'une grande tendresse exprimée à l’égard de sa culture et de ces mêmes valeurs villageoises dont il est l’héritier. Bien qu’il n’attaque pas frontalement ce système, on peut dire que Feraoun fut féministe (et l’un des premiers à dénoncer l’instrumentalisation du corps des femmes en temps de guerre, à travers le recours aux viols de masse).
Quels procédés littéraires utilisait-il dans sa prose pour critiquer subtilement les travers de sa société ?
Feraoun utilise souvent deux procédés littéraires dans son œuvre : l'ironie, qui permet de faire passer plus aisément le message que l'on souhaite transmettre, et l'emboîtement, ou le « glissement » des discours. Ce mille-feuilles narratif permet de confronter les points de vue, de les faire jouer ensemble, mais aussi les uns contre les autres, afin de favoriser la réflexion du lecteur et de servir ainsi une critique collaborative des travers de sa société. Celui-ci doit jouer son rôle dans la partition.
Le livre intitulé Journal est un témoignage précieux sur les débuts de la guerre d'Algérie. Il nous livre également d’importantes informations sur Mouloud Feraoun, l’écrivain, ses doutes, ses réflexions… Beaucoup qualifient cet ouvrage d’œuvre visionnaire. Quelles informations nous livre-t-il sur l’homme et sa personnalité ?
Comme je l’ai dit précédemment, Feraoun observait les événements de la façon la plus objective possible. Il mettait les principes d’humanisme, de respect de l’autre et d’entraide au-dessus de tout, et la guerre d’indépendance a ébranlé ces principes humanistes. La laideur de l’homme se dévoile alors tout entière – et dans ce chaos et cette laideur généralisés, des actes héroïques et admirables surgissent parfois. Feraoun tâche de garder la tête froide, rapporte, analyse, déplore, tout en tâchant d’assurer jusqu’au bout sa fonction d’éducateur, afin de conduire de jeunes âmes à la pleine réalisation d’elles-mêmes. C’est un homme déchiré, mais aussi engagé, ne transigeant pas sur les principes de base, et un homme empli de compréhension et de compassion pour l’humanité souffrante, qui se révèle à travers les pages du journal. Par ailleurs, si Feraoun condamne absolument le système colonial et souhaite sa disparition, il fait toujours la différence avec les hommes qu’il est amené à rencontrer ou côtoyer, et il espère qu’après l’indépendance, des liens – nouveaux, réaménagés – pourront exister avec l’adversaire d’hier.
Quelle est la dimension visionnaire de cet ouvrage ?
Plusieurs aspects du Journal fondent sa dimension visionnaire : la dénonciation du sort fait aux femmes en temps de guerre, le viol utilisé comme arme de guerre, ainsi que sa perspicacité à l’égard des futurs dirigeants de l’Algérie indépendante (Feraoun en connaissait un certain nombre). Le lecteur d’aujourd’hui peut effectivement corroborer certains constats de Feraoun, à présent que l’Histoire a parlé et que cette période est lointaine.
Quelle importance lui attribuer aujourd'hui ?
Le Journal de Feraoun est le seul journal tenu par un Algérien durant la guerre d’indépendance, sur le terrain même du conflit. Cette seule donnée suffit à en justifier l’importance. Feraoun y rapporte au jour le jour les événements qui se produisent, d’abord en Kabylie, à Fort-National et dans ses alentours, puis à Alger où il a trouvé refuge, mais où il sera malheureusement rattrapé par la mort quelques jours avant la signature des accords d’Évian.



