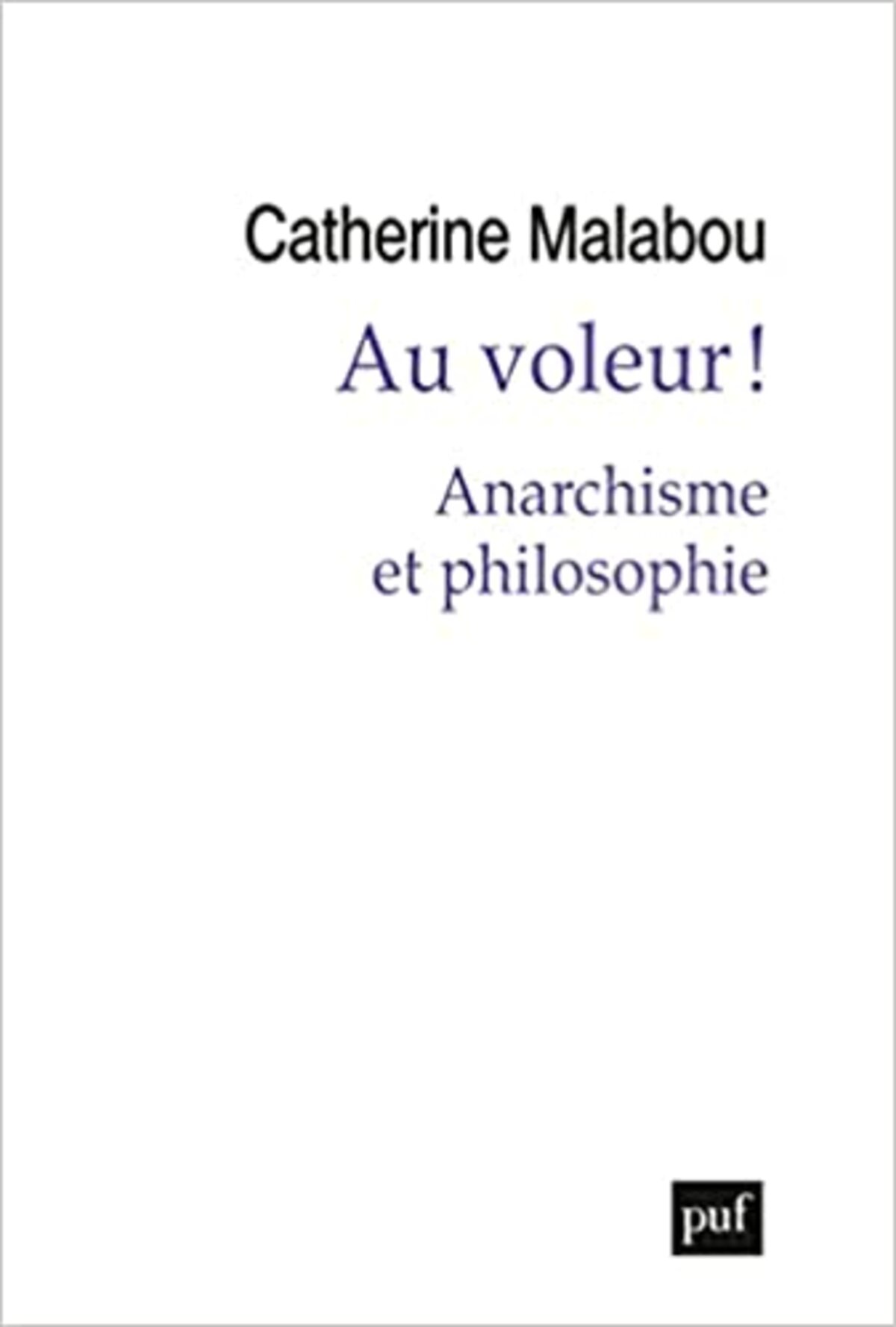
Il fut un temps (lointain…) où je n’hésitais pas à proclamer : je suis anarchiste ! Cependant il m’apparut très vite que cette assertion, loin de me procurer une quelconque sérénité, recelait, comme tapie dans un obscur recoin de mon être, une interrogation pour le moins sarcastique.
Puis, le temps faisant son office, il m’apparut, quelques lectures plus tard, que cette affirmation énonçait quelque chose de l’ordre de l’antinomie, peut-être même du contresens. Car, qu’est-ce donc que l’anarchie sinon le refus de toute autorité et la revendication d’une liberté absolue ? (On lira avec profit l'entretien accordé par Catherine Malabou à Joseph Confavreux)
Mais alors, la proclamation ne se métamorphosait-elle pas en injonction limitant ma liberté et par là se révélant comme acte d’autorité ? Le prédicat « anarchiste » ne corsetait-il pas le sujet le privant ainsi de sa liberté ontologique : je suis ? Ou, pour le dire autrement selon Saul Newman (De Bakounine à Lacan) : « comment l'anarchisme peut-il s'abstenir de reproduire les formes d'oppression qu'il s'efforce de vaincre ? »
Par ailleurs n’est-il pas remarquable que les mots « anarchie » et « anarchisme » émergent depuis quelques années après une longue immersion dans les profondeurs du discours philosophique et politique dominant ? Catherine Malabou examine cette émergence en décortiquant minutieusement le rapport entretenu par quelques philosophes majeurs avec la possibilité de l’énoncé « je suis anarchiste ».
Reclus et Kropotkine
Tout commence par la géographie, par l’évocation de ces deux grands géographes anarchistes que furent Élisée Reclus et Pierre Kropotkine car la géographie observe l'horizontalité alors que « toute l'approche historique quelle que soit sa méthode, reproduit toujours d'une manière ou d'une autre l'interprétation hiérarchique des positions dominantes » (p. 11).
Sans doute, mais cette horizontalité n'est-elle pas interpellée par la question de l'État qui est absolue verticalité comme l'indique son étymologie ? Car, dire « je suis anarchiste » n'était-ce pas souhaiter une société sans État telle que décrite, par exemple, lors du fameux Congrès de Saragosse de l'anarcho-syndicaliste CNT (confederación nacional del trabajo) en mai 1936 ou dans le « Mon communisme » de Sébastien Faure ?
Société sans État à laquelle, au fond, je ne croyais absolument pas (car dans la mouvance libertaire que je fréquentais, on croyait...) mais il n'en demeurait pas moins que cet anarchisme était, comme dit Catherine Malabou, « un combat contre les mécanismes de domination, lesquels débordent la sphère étatique stricto sensu pour concerner tous les domaines de la vie » (26). Autrement dit, rejetant toute croyance, toute « foi », l'anarchisme se révélait alors comme « manière de vivre » à l'instar de « la philosophie comme manière de vivre » telle que la définit Pierre Hadot.
A ce propos, il me vient ici d'interrompre un instant ma lecture pour m'interroger sur la propension de certains philosophes à moins que ce ne soit de certains professeurs de philosophie (tant il est vrai, comme disait David Thoreau rejoint par Hadot que, si foisonnent les professeurs de philosophie, fort peu nombreux sont les philosophes) la propension, disais-je, à se complaire dans un ésotérisme encore accentué par celle d'orner volontiers leurs textes d'une constellation d'étymologies grecques et latines. Ce qui ne simplifie pas la tâche des non-initiés et béotiens pourtant pleins de bonne volonté. Serait-ce, mais comment le croire, qu'il y ait là une volonté de demeurer dans un entre-soi excluant les non-initiés c'est-à-dire le commun des mortels ?
Ceci dit, reprenons l'exploration de cette œuvre, je n'ose dire magistrale, il s'agit ici d'anarchisme, mais absolument passionnante. Combat donc de l'anarchisme contre les mécanismes de domination dans tous les domaines de la vie qui, selon Proudhon cité par l'auteure (27), trouve son origine dans le « préjugé gouvernemental » : Que certains commandent et d'autres obéissent, telle est la logique du gouvernement , son « préjugé ». Ceci donc pour ce qui est de l'anarchisme, mais qu'en est-il de la philosophie ?
Arkhè
Eh bien, nous explique Catherine Malabou, un encore étudiant, Derek C. Barnett propose de nommer « paradigme archique » la version philosophique du préjugé gouvernemental. Pourquoi pas ? Poursuivons : « Le paradigme archique désigne la structure (qui) lie l'une à l'autre souveraineté étatique et gouvernement. Cette structure a pour nom « arkhè » (29). Qu'es aquò ?
Aristote définit l'arkhè à la fois comme commencement et commandement. Et notre encore étudiant de préciser : « l'arkhè est le principe qui situe la question politique à l'intersection de la souveraineté étatique et du pouvoir exercé comme gouvernement » (30). Mais voici que « l'examen critique du paradigme archique révèle que l'anarchie hante l'arkhè, qu'elle est originaire et qu'elle inscrit donc la contingence dans l'ordre politique ». Ce qui peut se dire aussi : « le virus anarchique qui infecte l'arkhè dès l'origine est l'incapacité de l'ordre politique à se fonder lui-même » (32).
Fascination
Vient alors la question qui m'importe : « Comment comprendre que les philosophes ne fassent malgré tout jamais référence à la tradition anarchiste ? Pourquoi aucune lecture sérieuse de Proudhon, Kroptkine, Bakounine, Malatesta, Goldman, Bookchin […] n'est venue soutenir la déconstruction philosophique du paradigme archique ?» Mais aussi, pourquoi « se déclarer marxiste, pour un philosophe, n'a jamais été et n'est toujours pas honteux alors que se dire anarchiste est presque indécent ? » (34-35). J'ajouterai volontiers : comment un érudit tel que Alain Badiou a-t-il pu dire la sottise suivante : « […] la figure anarchiste qui n'a jamais été que la vaine critique ou le double ou l'ombre des partis communistes comme le drapeau noir n'est que le double ou l'ombre du drapeau rouge ». (L'hypothèse communiste (p.26), 2009)
Pourtant, pourtant, les philosophes que l'auteure se propose maintenant de passer en revue, Schürman, Levinas, Derrida, Foucault, Agamben, Rancière, sont plus proches, dit-elle de l'anarchisme que du marxisme. Interrogations, celles-ci, qui ont alimenté mon malaise pour ne pas dire mon angoisse. Car, en effet, comment se fait-il ? Comment expliquer cette fascination exercée sur des esprits brillants par la « Théorie des théories » jusqu'à, pour certains, justifier l'injustifiable ?
Il m'apparut très vite que la raison avait à voir avec le grégarisme intellectif provoqué par la complexité, la sophistication « révolutionnaire » de la Théorie, complexité qui ne pouvait, par cela même qu'elle est complexité, que porter la Vérité, tout autre énoncé ne pouvant alors qu'être voué aux gémonies, condamné, « ridiculisé et marginalisé » tel Sartre « excommuniant » Camus pour insuffisance philosophique avec la bénédiction du révérend Badiou. (a propos de Camus n'est-il pas curieux de noter que le mot « révolte » n'apparaît nulle part dans ce livre alors que la révolte – et l'absurde camusien – me semblent être le premier des sentiments, des affects, à l'origine de « mon anarchisme » de jeunesse?)
Post-anarchisme
Puis, dans les années 80-90 apparaît le « post-anarchisme » inspiré par le « post-structuralisme » qui met en évidence « la dichotomie entre anarchie et anarchisme » ce qui rend possible une philosophie politique alternative à celle des grands barbus de l'anarchisme traditionnel se traduisant concrètement par une nouvelle (plus ou moins nouvelle, d'ailleurs) pratique militante qui, s'éloignant de « l'universalisme militant », se réalise en une multitude de formes de lutte et de résistance à l'autorité non seulement étatique mais sociale (féminisme, décolonialisme, écologisme, discriminations raciales et de genre...) analysées par Irène Pereira (« L'anarchisme face au paradigme de la colonisation », Grand Angle, mai 2018) qui ne peuvent plus être prises en compte par le syndicalisme « officiel » devenu un rouage du fonctionnement capitaliste comme le constatait déjà en 1920 le syndicaliste révolutionnaire Pierre Monate.
D'Hérodote à Proudhon
C'est dans ce contexte historique que l'auteure constatant que « les philosophes de l'anarchie n'ont jamais conceptualisé la dimension anarchiste de leurs concepts » entend analyser « la dissociation interne à la pensée philosophique de l'anarchie » (38) ce qui nécessite l'examen attentif des trois constituants de la dissociation que sont « un impensé, un vol et une dénégation». Tel sera l'objet de pages aussi philosophiquement instructives que politiquement captivantes.
L'analyse, en effet, du mot « anarchie », de son « impensé », nous conduit d'Hérodote à Xénophon, Sophocle, la République de Platon et la Politique d'Aristote jusqu'à Diderot et son Encyclopédie, Maine de Biran, Fourier, Louis Blanc et Jaurès pour constater que « le mot anarchie garde durant des siècles cette signification négative qui persiste mais accompagnée d'un autre sens à partir du « je suis anarchiste » de Proudhon et de « l'anarchie comme la plus haute expression de l'ordre » de Reclus ».
Fort convaincante se révèle ensuite l'analyse des deux autres constituants de la dissociation. Le « vol » (Au voleur !) qui nous ramène à Proudhon, évidemment, avec cette énergique interpellation des philosophes auteurs du « vol philosophique » de l'anarchie des anarchistes. La « dénégation » enfin (Freud) car « la raison inconsciente d'un tel larcin n'est pas à écarter » (45).
Pour autant la possibilité de l'antinomie inscrite dans la déclaration « je suis anarchiste » demeure entière car, j'insiste, ne se pourrait-il pas que le prédicat anarchiste se révèle être ni plus ni moins qu'un acte d'autorité annihilant la liberté du sujet. D'autant plus que m'avisant de consulter le dialogue entre David Greaber, Nika Dubrovsky, Assia Turqier-Zauberman et Medhi Belhaj Kacem (Diaphanes Anarchies, 2021) ce dernier de déclarer : « Je soutiens que ce que Kant a découvert c'est l'identité paradoxale de la liberté et de la contrainte » (103).
Toutefois on ne peut ignorer la remarque de D.G. selon laquelle « La liberté est notre capacité à entrer volontairement (oui mais, me vient-il d'interroger en passant : quelle est l'origine de cette volonté?) dans des relations de contrainte ou encore selon M.B.K. : « la liberté suppose une règle de coercition » (117), ce qui ne peut que me conforter dans l'idée que la liberté consiste donc à échapper à l'autorité de la qualification du sujet « Je » par le prédicat « anarchiste » . D'où... silence, mon silence désormais quant à toute éventuelle qualification.
Poursuivons encore un peu pour, sans négliger la possible dénégation freudienne (46), avancer, avec toute la prudence qui sied à un non-initié, une hypothèse alternative (ou complémentaire?) relative à cette réserve des philosophes quant à l'anarchisme : ne serait-ce pas, par exemple, que penser et envisager la possibilité d'une société « sans gouvernement » implique nécessairement de penser des modalités telles que le partage, l'entraide, l'égalité, l'abolition effective des privilèges, non seulement matériels mais aussi, et peut-être surtout, relatifs à l'idéologie « démocratique » fondée sur la figure du mérite, celui des philosophes et autres « élites » ?
Ne serait-ce pas, comme le dit Rancière, qu'envisager cette possibilité implique de penser la subversion sociale en termes de « ceux qui ont droit à la parole et ceux qui n'y ont pas droit ». N'y aurait-il pas alors, dans ce « refoulement freudien » la crainte fort consciente de la perte d'une position sociale dominante ? Qui sait ? En tout cas, nous avertit l'auteure, les développements qui vont suivre seront consacrés à la dissociation philosophique entre anarchie et anarchisme (54).
Voyons donc : Aristote pour commencer, ses éléments vacillants, ses indécisions, les apories de sa politique sont inhérents au paradigme archique lui-même et laissent paraître la fragilité de l'édifice. Menace anarchique inévitablement logée au cœur de l'arkhè. Ce qui peut sans doute se dire simplement : toute puissance porte en elle sa propre contestation, peut-être...
Schürman
Passons, bondissons plutôt d'Aristote à Reiner Schürmann et son ouvrage majeur, « le principe d'anarchie » que Catherine Malabou questionne énergiquement se demandant par exemple : est-ce si sûr que l'anarchie ontologique n'emprunte rien à l'anarchisme politique interrogeant ainsi l'assertion selon laquelle « l'anarchisme […] n'a pu masquer malgré son extrémisme révolutionnaire son appartenance à la métaphysique et donc sa subordination paradoxale à l'arkhè ». Et, à ce point, il m'apparaît soudain que mon doute quant au « je suis anarchiste » n'était peut-être pas dépourvu de tout fondement.
Mais poursuivant notre lecture nous en profitons pour prendre un bain moussant d'arkhè domestikhè, d'arkhè politikhè, d'enklisis, d'arckhè encore, mais cette foi accompagnée de telos qui est achèvement quand, on le sait maintenant, l'arkhè est commencement sans oublier une pincée de praxis, de poiesis, de tekhnè et, pourquoi pas d'eidos après quoi nous sommes à même de nous jeter d ans la lecture schürmanienne de Plotin qui nous apprend que « l'Un est ce par quoi les choses s'arrangent entre elles, une mise en ordre sans ordre donné » (100) et que nous parvenons ainsi à « soudain l'économie anarchique » et à cette conclusion sans doute provisoire de l'auteure : « Plotin premier anarchiste ». Pour plus de précisions on peut, si nécessaire, consulter le lumineux Plotin de Pierre Hadot.
Puis Foucault ou, plutôt, une lecture de Foucault par Schürmann, Foucault dont, on le sait, c'est dit à la moindre occasion, a montré qu'il y a du pouvoir partout, de sorte qu'il « y a du commandement dans l'obéissance et de l'obéissance dans le commandement » (104). Et, dit Schürmann, Foucault a bien montré qu'être sujet revenait toujours, d'une manière ou d'une autre à « se constituer soi-même en sujet » et par là-même, d'une manière ou d'une autre, en « sujet anarchique » (104). Comprenons bien, anarchique et non pas anarchiste.
Dès lors, interroge Catherine Malabou, « pourquoi Schümann ne franchit-il pas la ligne qui sépare l'anarchie et l'anarchisme ? Réponse : « Dire « je suis anarchiste », choisir de le dire, vouloir le dire, contredirait l'anarchie elle-même, la transformerait en une position, donc en une nouvelle arkhè » (105). Ou encore : « l'impossibilité de se dire anarchiste ne contredirait donc pas l'anarchisme mais le respecterait. La dissociation entre anarchie et anarchisme formerait ce double bind (double injonction contradictoire : « soyez anarchiste ») qui dans son impossible possibilité est une arme puissante contre le préjugé gouvernemental » (107-108). Ce qui ne manque pas de contribuer à dissiper ma petite angoisse de jeunesse. Oui mais les choses ne sont pas si simples car « si pour comprendre la pauvreté il faut être pauvre […] alors pour comprendre l'anarchie, ne faut-il pas être... ? (117-118). Bon...
Levinas
Voyons maintenant ce qu'il en est de l'anarchisme éthique d'Emmanuel Levinas. Que les choses soient claires, les « anarchies » de Schürmann et de Levinas ont au moins un point commun : la séparation nette d'avec l'anarchisme politique. Mais il y a plus, « il y a l'anarchie qui hante les textes de Levinas (123) et ce double bind qui est un commandement auquel on ne peut obéir qu'en désobéissant […], cette obéissance à un ordre s'accomplissant avant que l'ordre ne se fasse entendre, l'anarchie même »(p. 130). Car pour Levinas, « être élu signifie ne pas avoir besoin d'être commandé ni gouverné » (134).
Ce qui ne peut manquer d'évoquer pour moi, de manière inattendue, ces miliciens anarchistes (ou pour le moins anarcho-syndicalistes) se ruant en juillet 1936 par les monts d'Aragon à l'assaut de Saragosse tenue par les fascistes et refusant toute « militarisation » parce que anarchistes, non pas élus au sens de Levinas, mais conscients, et par cela même refusant toute autorité autre que celle de leur conscience. Mais voici que du côté de Caspe un avion ennemi lâche deux ou trois petite bombes dont les détonations provoquent la panique et la dispersion effarée des miliciens et que, l'alerte passée, leur responsable (pas chef, bien sûr) le prestigieux militant Buenaventura Durruti les apostrophe en termes pour ainsi dire levinasien : est-ce là le comportement d'anarchistes (non pas d'élus, bien sûr), d'hommes conscients ?
Serait-ce par hasard qu' « éthique d'élection » de Levinas et éthique anarchiste de Kropotkine se retrouvent (se fondent?) non pas dans le « désobéir » mais dans le rejet de toute autorité autre que celle de sa propre conscience, celle d'être élu, celle d'être, par un mystérieux cheminement, anarchiste ? Car « l'âme des enfants d'Israël » est une âme anarchique (139) (comme celle des enfants de Durruti ?).
Mais les choses ne vont pas ainsi, ne sont pas si simples car, selon Miguel Abensour, « il existe bel et bien une « folie éthique » qui a sa démesure spécifique » (44) de sorte que nous nous heurtons à ces paradoxes tels que « mettre de l'ordre dans l'anarchie , tel (serait) le rôle de l'État » (145) ou encore : « l'État (serait) nécessaire pour sauver l'anarchie », sachant tout de même que cet État de Levinas n'est autre que l'État de David dans lequel, bien sûr, on reconnaîtra l'État d'Israël (147).
Catherine Malabou poursuit son analyse de « l'anarchie éthique de Levinas à travers les commentaires de celui-ci sur Mai 68 et la question de l'esclavage pour lui régler son compte, si j'ose dire, en ces termes : « La non-gouvernabilité, n'est pas, n'est jamais, ne peut être soluble dans l'État ». Puis : « sans une ressaisie totale, anarchiste, du problème de l'esclavage, l'éthique court le risque d'être trop bien gouvernée » (155).
Derrida
Après quoi, nous pouvons passer, non sans quelque appréhension, à Derrida, brièvement cependant tant est riche l'analyse menée par l'auteure. Ceci simplement : « Ne nous y trompons pas (dit Derrida) l'anarchisme laisse intacte la question du pouvoir- colonial, esclavagiste, censeur... » Ou encore : « La pulsion de mort est-elle anarchique ou anarchiste ? » Ou encore ceci : « Levi-Strauss anarchiste et Clastre, bien sûr, et Freud pour qui l'anarchie serait le pouvoir a priori, le transcendantal mis a nu » (190), mais au-delà de Freud et de sa « pulsion de mort », y aurait-il quelque part une « pulsion anarchiste » ? Car, en effet, pour la psychanalyste Nathalie Zaltzman la pulsion de mort n'est ni pulsion anarchique, ni pulsion d'anarchie mais bien « pulsion anarchiste », libératrice, libertaire.
Au terme de cette dense analyse en forme de jonglerie de concepts multicolores (mais les concepts ont-ils une couleur ? Grave question …) vient la réjouissante et lumineuse appréciation sur quelques lignes de Derrida, celles-ci : « Le voyou est à la fois inoccupé, parfois au chômage, et activement occupé à occuper la rue, soit à « courir les rues », à n'y rien faire, à traîner, soit à faire ce qu'on ne doit pas faire normalement, selon les normes, la loi et la police, dans les rues et sur toutes les autres voies » (Voyous, Galilée, 2003). Est-ce juste ? s'interroge Catherine Malabou […] Une chose est sûre, poursuit-elle, en situant la « voyoucratie » quelque part entre « le chaos de l'anarchisme et le désordre structuré », Derrida semble avoir oublié la troisième voie : la possibilité d'un ordre anarchiste, la possibilité même du non-gouvernable. La possibilité, du même coup, que les anarchistes ne soient pas des voyous (203).
Foucault
Il est temps maintenant d'en venir à « l'anarchéologie » c'est-à-dire à Foucault. On le sait, c'est dit et écrit partout, Foucault ne croit pas à l'existence d'une pulsion de pouvoir. Impossible, dit-il, d'assigner au pouvoir une origine, une racine, une provenance, même une différance... » (205). Vient alors, évidemment, la question mille fois posée selon cette manie de l'étiquetage qui ne peut être que réductrice : Foucault est-il anarchiste ? Peu m'importe. En tout cas, assure Catherine Malabou, c'est un des seuls philosophes du vingtième siècle qui prend l'anarchisme politiquement au sérieux. Ne disait-il pas lui-même : « La position que je prends n'exclut absolument pas l'anarchie – et, après tout, encore une fois, pourquoi l'anarchie serait-elle si condamnable ? » (208) (Du gouvernement des vivants).
On sait bien en outre comment de Tomás Ibañez à Todd May en passant par David Graeber, Andrej Grubačić et tous les autres, les « post-anarchistes », dans leur diversité, se réfèrent à Foucault. Bien sûr, on ne manque pas de croiser Deleuze et son « auto-affectation […] qui décide précisément d'une orientation anarchiste de l'ontologie » et pour qui « l'immanence est bien la dissidente anarchiste de l'ontologie » (241). Ce qui, pour le moins, n'est pas sans évoquer cette cohérence revendiquée par nombre de militants libertaires entre fin et moyens, entre objectifs politiques proclamés et « mode de vie ».
Mode de vie minutieusement traité ici par le commentaire foucaldien des deux dialogues de Platon, l'Alcibiade et le Lachès nous introduisant au cynisme « qui apparaît comme la forme la plus radicale d'un adieu […] qui n'est pas un adieu à la politique mais un adieu à la « scène ». Un adieu à la dynastie, un adieu à l'arkhè, en un mot, un adieu au gouvernement ». Car « le bios, loin d'être le cimetière de la politique, est sa nouvelle naissance » (248). Ceci dit sachant que le cynisme n'est pas désobéissant mais « c'est plutôt que quelque chose en lui est absolument étranger à l'ordre hiérarchique »(256).
De sorte que soyons optimistes puisque « le retrait de la politique rendu nécessaire par la corruption et la dévaluation de la « parrêsia » (le parler vrai), n'est que le prélude à un rebond, à un éveil qui annoncent une nouvelle catégorie de l'agir » (258). En effet, si l'anarchisme préfigure la preuve par la vie, ce que les activistes contemporains appellent « l'engagement préfiguratif » qui affirme que c'est par le mode de vie, ici et maintenant, que l'on peut changer les choses, sans besoin d'aucun gouvernement, alors tout n'est peut-être pas perdu.
Agamben
Venons-en maintenant, brièvement, à « l'anarchie profanatrice » de Giorgio Agamben. Non que la soixantaine de pages qui lui sont consacrées dans ce livre soient dépourvues d'intérêt, bien au contraire, elles sont foisonnantes et nécessitent une lecture attentive pour saisir, par exemple, comment pour Agamben il s'agit de « suturer » le partage entre commandement et obéissance – encore à l'œuvre dans le concept foucaldien de gouvernement de soi – et de donner son congé définitif à la logique de gouvernement (266). Ou pour comprendre comment l'anarchisme de transgression ne serait que la simple doublure du capitalisme, sachant cependant la différence irréductible qui sépare la profanation de la transgression, de sorte que « Foucault serait trop transgressif » (donc pas assez profanateur?) pour être anarchiste.
Mais, tout de même, au terme d'une longue exposition quelque peu ésotérique, si l'on entend par là « réservée aux initiés », comment ne viendrait-il pas au non-initié la question du statut de ces développements passablement hermétiques : sont-ils de l'ordre du ludique, de quelque chose comme une gymnastique des méninges, gymnastique jubilatoire n'ayant d'autre objet qu'elle même, comme le jeu activité autotélique par excellence, n'a d'autre objet que lui-même, et alors, ce « jeu » serait pleinement justifié : le ludique jubilatoire comme manière de vivre en quelque sorte... Il se pourrait bien, cependant que ces « jongleries conceptuelles » soient de l'ordre de l'utilité publique en tant qu'elles participent à l'approfondissement de la connaissance et par là au mieux être non seulement des humains mais de la Terre. Il revient alors aux professionnels de la philosophie, de la connaissance, de le démontrer.
Rancière
Passons à « l'anarchie mise en scène » de Rancière. L'auteure l'affirme d'emblée : Jacques Rancière est un grand penseur de l'anarchie. Inutile de préciser de l'anarchie politique, puisque politique et anarchie sont pour lui synonymes. Et la question vient, inéluctable : « Pourquoi, alors, hésite-t-il à se déclarer anarchiste ? (325). Parce que, précise-t-il, « il faut bien dire que l'anarchisme a trop souvent signifié, historiquement, la constitution d'une petite secte doctrinaire : on a trouvé du doctrinarisme et de la compromission politique dans l'anarchisme comme dans le communisme (oh, combien! suis-je tenté de m'exclamer) et, poursuivant : « j'ai une sensibilité profondément anarchiste mais je la sépare des petits groupes anarchistes » (330). Et puis vient inévitablement la question de la police, concept majeur selon Catherine Malabou de la pensée de Rancière. Non pas la « basse » police à matraques mais la police comprise comme l'autre nom de la politique (332).
Il me revient à cet instant, comme par inadvertance, le souvenir d'un ami, d'un copain qui ne survécut pas à l'immense déception de Mai 68. Je donne ici son nom en hommage à son « anarchisme » qui s'exprimait fort souvent par un éclat de rire. Ainsi, disait-il parfois, hilare, « dans notre société libertaire, les flics auront toujours des matraques mais elles feront moins mal parce que elles seront peintes en noir et rouge ». Il s'appelait Christian Lagant. Il fut, entre autres, le fondateur et l'animateur de la revue « Noir et Rouge ».
Revenons à Rancière : « ces étranges rapports entre politique et police constituent à l'évidence un point obscur de la pensée de Rancière », commente l'auteure. Sans doute mais pas seulement du philosophe car s'il est un point obscur il est aussi celui de toute pratique militante libertaire, obscurité dans laquelle se sont débattus les militants anarchistes au cours de l'histoire, de leur histoire. L'exemple le plus significatif est sans doute celui des « anarchistes au pouvoir » pendant la guerre d'Espagne (1936-1939), au pouvoir en Catalogne et à Madrid où, Juan García Oliver, militant « illégaliste » qui ouvrit les prisons de Barcelone en juillet 36 (comme d'autres le faisaient ailleurs) et occupa un peu plus tard le poste de ministre de la Justice dans le gouvernement de Largo Caballlero. Sa collègue, comme lui militante (pas dirigeante, bien sûr...) de la FAI (Fédération anarchiste ibérique) Federica Montseny, ministre de la Santé dans le même gouvernement, ne disait-elle pas longtemps après depuis son exil de Toulouse : « Ministre oui, mais sans jamais cesser un instant d'être anarchiste ».
Alors ? Alors quand Todd May dans son ouvrage « La pensée politique de Jacques Rancière » éprouve le besoin de « radicaliser sa pensée […] en prononçant le divorce du couple politique et police sans tomber pour autant dans l'aveu pur et simple d'une impossibilité de l'anarchisme » (334-335), gardant en mémoire l'Espagne, le Chiapas et le Rojava, je ne peux que douter de la pertinence de ce radicalisme théorique. A moins que l'on ne retrouve quelque sérénité en allant voir du côté de D. Graeber disant que « l'anarchisme n'est ni une attitude, ni une vision du monde, ni même un ensemble de pratiques ; mais un processus permanent de va et vient entre les trois » (L'anarchie pour ainsi dire, p. 25)
Poursuivant son commentaire de Rancière, l'auteure en arrive, (comment pourrait-il en être autrement?) au « Maître ignorant ». Ce qui la gêne ici, dit l'auteure, c'est la thèse de l'égalité des intelligences qui est présentée comme un fait, une affaire de volonté, de raison.[...] « Derrière l'affirmation de ce qu'il faut se passer de maître se cache une élimination du tiers. Le Maître ignorant est un mémoire sans anamnèse (mémoire d'un passé inconscient). Un argument d'autorité. Et donc, en un sens une démonstration archique (375).
Je crains fort sur ce point de ne pouvoir suivre Catherine Malalbou. Ancien enseignant, je crois pouvoir affirmer que le « Maître ignorant » est un fait. Mes trente cinq ans d'enseignement en ZEP en attestent. Je n'ai jamais été rien d'autre qu'un « Maître ignorant ». Plus encore, je n'ai jamais rencontré que des maîtres ignorants dans les innombrables « salles de profs » fréquentées, dont certains étaient conscients que cette « ignorance » devait être mise à profit pour donner tout son sens à leur démarche pédagogique. Loin de signifier « qu'il faut se passer du maître ce qui cacherait l'élimination du tiers », l'ignorance du maître signifiait la possibilité de la reconnaissance totale de l'Autre, non seulement du groupe des élèves mais de chacun des élèves et la reconnaissance, idéalement, des enseignants pour peu que ceux-ci consentent, conscients de leur ignorance, à travailler collectivement. Le Maître ignorant implique et fait advenir une pédagogie libertaire, sachant que j'entends par pédagogie le mode de vie « anarchique » en un lieu peuplé d'enfants, mode de vie aussi étranger que possible à toute démarche impositive. L'ignorance du maître n'est rien d'autre alors que la condition d'une appropriation collective des connaissances qui assimilées par chacun se constituent en savoirs singuliers. C'est ainsi que je crois avoir beaucoup appris de mon ignorance. De sorte que loin d'être un argument d'autorité, un mémoire sans anamnèse, loin d'être « une démonstration archique », le Maître ignorant est une démonstration anarchiste.
Être anarchiste ?
Nous voici parvenus à la vaste conclusion de cette extraordinaire contemplation philosophique de l'anarchie, conclusion que l'auteure intitule naturellement : « Être anarchiste ».
Pour les philosophes cette proposition semble à jamais frappée d'impossibilité. On ne peut pas être anarchiste. Le phénomène de l'anarchie de l'être […] manifeste son irréductibilité à toute détermination ontique (382). Chaque terme de la proposition « Je suis anarchiste » opposerait aux autres un obstacle infranchissable comme en écho au caractère politiquement intenable de l'anarchisme (383).
Manifestement, « contre toute attente, la philosophie n'a pas pris la mesure de la signification ontologique – c'est-à-dire aussi précisément philosophique – de l'anarchisme (385). Mais, en insistant encore une fois sur l'impossibilité de l'être anarchiste, c'est précisément la dimension anarchiste de l'être que les philosophes ont échoué à apercevoir » (385). « Comment penser sérieusement toutefois que l'on puisse en avoir fini avec l'être ? Comment penser que la vie – la forme de vie – l'ait en quelque sorte remplacé » (387). Ne serait-il pas vrai que « le point sensible des relations entre l'être, la vie et la mort, crie son nom tous les jours : écologie (396) ? Comment, alors, le doute ne persisterait-il pas quant à la possibilité de cette proclamation, ce cette prétention à la sagesse absolue : « Je suis anarchiste ! ».
A moins que l'on ne fasse siennes les dernières lignes de la conclusion de Catherine Malabou : « C'est à ce moment que l'on comprend que ces doutes eux-mêmes sont déjà des chemins vers d'autres façons de partager, d'agir et de penser. D'être anarchiste. »



