
L'auteur sait de quoi il parle : Docteur d' État en droit, enseignant, militant syndicaliste révolutionnaire, il est un Anarchiste assumé. Comment alors rendre compte d'une telle somme ( 567 pages), d'une telle érudition, exposées cependant dans une langue accessible, se concluant par la proclamation : Vive la Commune ! ?
Tel est le défi auquel s'affronte le commentateur qui, alors, peut apparaître quelque peu présomptueux. Quoi qu'il en soit, il convient pour commencer de considérer ce Propos introductif : Changer le monde est possible, mais se prépare (p. 15) qui sonne non comme un slogan mais comme une conviction primordiale que le texte des cinq cents pages suivantes expliciteront minutieusement. Car il importe de démontrer que l'objectif révolutionnaire est vain s'il ne pense pas la société qu'il veut construire, c'est-à dire s'il ne pose pas la règle avant l'événement, s'il ne construit pas une organisation efficace aujourd'hui, capable d'inventer les institutions de demain, de redéfinir les droits humains et les libertés fondamentales. A cet effet, l'auteur propose quatre théorèmes.
Croire que l'État peut ne pas être dominateur est comme croire que le Capital peut ne pas être profiteur.
Sans un mouvement pour la démocratie directe, la commune et le fédéralisme, un autre futur est impossible.
Faute d'avoir pensé les institutions de la société à venir, la révolution communaliste est vouée à l'échec.
Faute d'avoir défini les droits et libertés de la société à venir, la révolution communaliste est vouée à l'échec.
Ces quatre théorèmes, précise l'auteur, sont indissociables pour « résoudre la quadrature du cercle de la participation active de toutes et tous dans les affaires de la cité ». Ils forment les quatre parties du livre.
On peut alors entrer dans le vif averti par l'auteur lui même que : Rien n'est tranché. Tout est à discuter. (p. 39). Sachant également que cet essai n'est pas un code de droit constitutionnel pour demain, pas plus qu'un livre de recettes fédéralistes moins encore l'exposé d'une doctrine. C'est, en quelque sorte une feuille de route qui entend contribuer à l'avancée historique du projet socialiste anti-autoritaire.
Alors sont passées en revue minutieusement cinq brèches infligées à l'histoire linéaire du pouvoir étatique par le peuple insurgé.
La fulgurance de la Commune de Paris (p. 46 et suivantes).
La tragédie de la révolution russe (P.54 et ...)
L'Espagne libertaire trahie par les siens (p.63 et ...)
La résistance d'un Chiapas émancipé (p.79 et …)
L'auto-administration du Rojava et ses revers. (On verra sur ce point les précédents ouvrages de Pierre Bance (p. 87, note 108).
Puis est considérée l'histoire du syndicalisme et particulièrement du syndicalisme révolutionnaire que l'auteur aborde en citant intégralement la fameuse « Charte d'Amiens » adoptée au congrès d'Amiens en octobre 1906 pour tenter de dégager les principales raisons de l'échec du syndicalisme révolutionnaire. Et, sur ce point, en tant que militant pédagogique (pédagogiste disent les « Instructeurs » la trique à la main) « hors syndicats » je crains de ne pouvoir suivre l'auteur quant à ces raisons qu'il attribue essentiellement aux « erreurs humaines » de militants empêtrés dans d'obscurs combats entre révolutionnaires et réformistes pour la prise du pouvoir dans le syndicat.
En effet la cause essentielle de l'échec du syndicalisme révolutionnaire est inscrite en toutes lettres dans la Charte elle-même sous la figure antinomique des deux objectifs du syndicalisme : amélioration immédiates d'une part et émancipation intégrale d'autre part, qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Ce qui constitue, à mon sens la structure fondamentalement contradictoire du syndicalisme.
Toute l'histoire du syndicalisme, mieux vaudrait dire du fait syndical, montre à l'évidence que le capitalisme a su privilégier les « améliorations immédiates »jusqu'à développer une société de la consommation, que je préfère nommer société de l'avidité, soutenue par une idéologie de la marchandisation, une propagande au sens de J. Ellul, qui promeut cette avidité frénétique comme mode de vie idéal : vivre c'est consommer ! Idéologie qui a su transfigurer le syndicat en « partenaire social » évacuant ainsi toute velléité d' émancipation intégrale et d'expropriation capitaliste. Il n'est plus de syndicats mais seulement des partenaires sociaux !
Alors que faire ? (comme disait l'autre).
Le lecteur attentif se nourrira des analyses pertinentes des différentes propositions politiques pour répondre à cette antique question en passant de la tentative du NPA tendance Besancenot (peu goûtée semble -t-il par Daniel Bensaïd) de concilier marxisme révolutionnaire et anarchisme, vieil espoir là encore porté par Daniel Guérin, Catoriadis et le groupe « Socialisme ou barbarie » et discuté dans les années 1960 jusqu'au sein du groupe Noir et Rouge animé par le regretté Christian Lagan (cité ici en hommage).
Pierre Bance, quant à lui, propose la création de ce qu'il nomme Le Mouvement pour la démocratie directe qui imaginera le projet d'un autre futur et se mettra en capacité de le réaliser(p.204). Il sait parfaitement, ce faisant, qu'il ravive le débat entre ceux qui comme lui sont partisans d'une charte, d'une constitution, d'un plan préalable à la révolution et ceux qui affirment que le projet révolutionnaire doit naître de l'intérieur même des luttes. Raison pour laquelle il cite Tomás Ibañez, lui aussi Anarchiste assumé :
L'orientation et les objectifs doivent être ceux qui émergent du processus de lutte lui-même car s'ils sont préfixés alors le caractère autonome du processus est enfreint et, paradoxalement, les possibilités de changement radical sont donc trahies par le fait même de tenter de diriger ce changement. (Derniers fragments épars pour un anarchisme sans dogmes. Paris, rue des cascades,2022).
Le débat dure depuis fort longtemps et, me semble-t-il, il n'est pas près d'être épuisé. Pour ma part, je conclurai ce déjà trop long commentaire en posant la question suivante : comment et avec quels instruments lutter contre l'idéologie de l'avidité, contre cette propagande incessante et massive qui décrit la société marchande avec des couleurs si chatoyantes et qui mène le monde à sa perte ? Comment ?
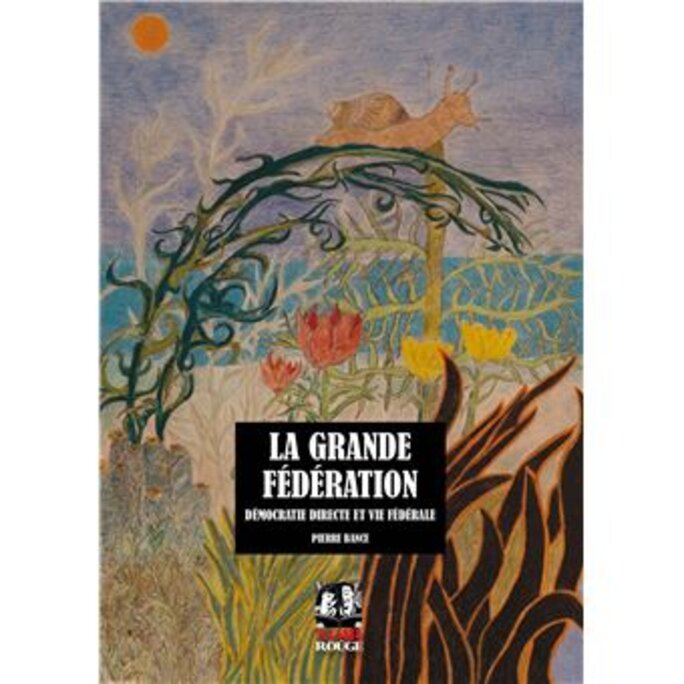
Enfin, je terminerai en signalant que les deux dernières parties de l'ouvrage décrivent par le menu les institutions de la Grande Fédération et de ce qu'il pourrait en être de la vie fédérale dans ce cadre, non sans réaffirmer qu'il s'agit ici d'une œuvre éminente et fondamentale qui sera, sans le moindre doute, sollicitée par chercheurs et militants.
Vive la Commune !



