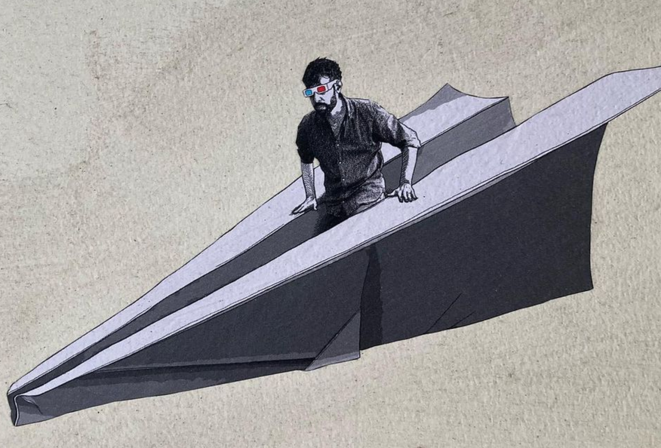Pap Ndiaye veut faire entrer plus de mixité dans l’enseignement privé au nom de l’égalité. Une idée intéressante de prime abord, mais vraiment une bonne idée ?
Qui en tirerait un réel profit ? Les établissements privés, qui accueilleraient un quota d’élèves issu·es des milieux les plus modestes, ou les établissements publics, qui verraient encore partir quelques élèves supplémentaires vers des établissements qui en réalité ne veulent pas d’eux ?
Ne devrions-nous pas plutôt chercher à faire revenir le plus grand nombre d’élèves vers le service public, au lieu de penser le transferts d’encore plus d’élèves vers le privé ?
Quel système éducatif, notre ministre, défend-il ? Peut-être celui de l’école alsacienne, une école privée de l’élite parisienne où Pap Ndiaye scolarise ses propres enfants ?
Beaucoup de questions restent en suspens face à la volonté du ministère de l’éducation nationale de rendre le système plus poreux vers le privé. En effet, qui peut croire, d’une part que des établissements privés accepteront un plus grand nombre de boursier·es sans contrepartie, et d’autres part que des élèves jusqu’alors scolarisé·es dans le privé iront de bonne grâce dans le collège public de secteur ? Car pour atteindre une véritable mixité sociale c’est bien vers cela qu’il faudrait tendre. Le secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme, réclame déjà des bonus d’allocation pour les établissements qui accepteraient de scolariser des élèves boursiers. Les déclarations du ministre resteront donc sans fondement et sans effet tant qu’il fera le choix de choyer le secteur privé au lieu de renforcer le secteur public pour en faire le fer de lance de l’égalité, le ferment d’une pédagogie émancipatrice et le creuset d’une société solidaire.
Mais voilà, le choix de la soi-disant école libre va à l’encontre de ces valeurs, car elle existe d’abord pour favoriser l’entre-soi (l’uniformité des profils étant plus forte dans le privé que dans le public), pour permettre la transmission d’une forme de soumission à la religion plutôt que de promouvoir la liberté de croire ou non (90 % des établissements privés sont confessionnels), pour reproduire une élite en se distinguant des classes moyennes et populaires (la publication en 2022 des IPS par établissement le prouve largement).
Le chemin vers la mixité sociale mérite mieux que les propositions floues et peu offensives de Pap Ndiaye, car sinon, dans les quartiers défavorisés, les quelques élèves en réussite et leurs familles désireuses de meilleures conditions d’enseignement se rueront dans les écoles privées. Elles trépignent déjà devant les portes des établissements privés saturés de banlieue. Mais dans ces établissements, pour faire place à la mixité, il faudra leur accorder toujours plus de moyens humains (les enseignants du privé sont aussi payés par l’impôt doit-on le rappeler), de moyens matériels (les collectivités locales contribuent beaucoup trop souvent au fonctionnement, et au-delà des prescriptions légales), au détriment des établissements publics qui pourraient perdre élèves, postes et crédits de manière mécanique.
Si l’on considère avec sérieux la devise de l’état : Liberté, Égalité, Fraternité, nous sommes conduits à penser que l’enseignement privé contredit les valeurs républicaines et qu’il entraîne un communautarisme de fait. Une injection homéopathique d’élèves différents suffirait-elle à soigner l’ensemble du système, c’est peu probable. Il faut au contraire, convaincre que c’est bien l’enseignement public qui est le plus responsable et le plus en capacité de faire vivre la démocratie et le pluralisme.
Pour cela, il faudrait commencer par arrêter de subventionner le privé pour qu’enfin la véritable école retrouve le manque d’investissement dont elle est victime. Il faudrait donc laisser à elle-même l’école de celles et ceux qui font le choix du séparatisme plutôt que du commun. Il est à noter que le système finlandais, que tout le monde flatte, a pour ainsi dire éteint l’enseignement privé. Est-ce un hasard s’il fonctionne si bien ?
Enfin, comment penser la mixité sociale sans réfléchir aux politiques publiques du logement, du transport ou de la ville ? Encore un fois, l’approche du gouvernement refuse par dogmatisme la complexité du monde qui nous entoure et nous conduit par aventurisme à l’affaiblissement du service public.