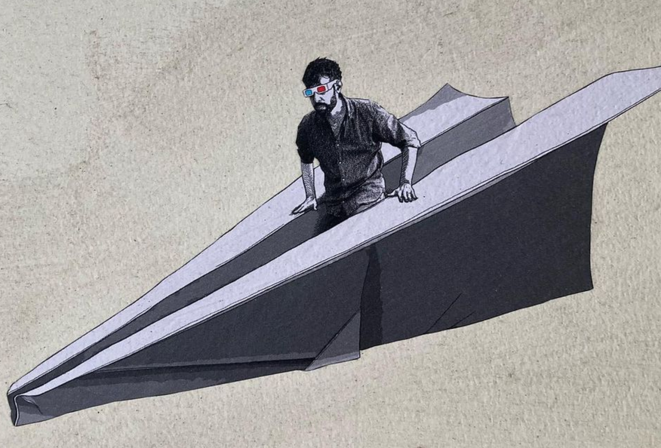Le système éducatif français est malade, il semble dévoré par ses propres agents, et à commencer par ses dirigeant·es, cela ne fait pas débat. La succession des ministres cherchant à réformer ce service public au nom de la justice sociale contre les enseignant·es, mais en offrant toujours plus de subsides et d’avantages au secteur éducatif privé en est un des exemples les plus visibles. Mais les acteurs principaux du système, enseignant·es comme élèves, ne sont pas en reste, et au-delà des élèves il faut percevoir l’influence des parents sur ceux-ci. Les parents d’élèves place en effet l’éducation nationale dans une situation paradoxale, elle serait ainsi à la fois inefficace, néfaste et tortionnaire mais aussi indispensable, inévitable et intégrative. On attend tout de l’école mais on considère qu’elle ne peut plus grand-chose. Comme beaucoup d’institution, l’école souffre d’une image dégradée dont elle est à la fois victime et bourreau.
Pour illustrer ce postulat, il suffit de se pencher sur la question de l’évaluation.
Les différents types d’évaluation ne sont pas en cause avec la même importance, mais qu’elle soit sommative ou certificative, ou même formative ou diagnostique, elles y contribuent toutes à leurs échelles. En effet, il ne s’agit pas de penser l’évaluation comme un problème en soi, mais de considérer que l’obsession d’évaluer le travail des élèves (voire l’élève lui-même au travers des savoirs-être), quotidiennement, heure par heure, exercice par exercice tend à rendre vain toute forme d’évaluation, et pire encore conduit à faire croire que l’évaluation serait un but en soi en dehors de l’acquisition des savoirs.
Bien sûr ce processus s’inscrit dans une dimension plus large ; notre société semble contrainte à l’évaluation permanente, technocratique et néo-libérale. Combien de cabinets et autres officines se nourrissent sur la bête pour justifier de leur existence même ? Il est à la mode d’externaliser l’expertise à grands frais.
Cette tendance se traduit, dans l’éducation nationale, par un triple piège.
Ainsi, nous sommes en tant qu’enseignant·es confronté·es, d’une part, à des familles et des élèves dont la seule perception de la « réussite » passe par l’évaluation (note ou compétence il n’y a pas de différence de ce point de vue), d’autre part, nous constatons que beaucoup de collègues installent leur autorité par l’évaluation en la transformant en un moyen de sanction et de contrôle, enfin cela contribue à fausser les relations enseigant·es/élèves évacuant la question du savoir au second plan.
En effet, à mon avis, ici se situe le cœur du problème, les savoirs et les connaissances deviennent annexes dans un système où les parents n’attendent pas de leurs enfants qu’iels apprennent mais qu’iels aient de « bonnes notes » et les élèves n’attendent pas que leurs enseignant·es leurs transmettent des contenus disciplinaires mais que leur travail soit noté et surtout bien noté (cf. ce qui se passe avec le contrôle continue au lycée). En outre, les enseignant·es, dont le métier est de moins en moins reconnu, sont contraint·es pour beaucoup d’entrer dans ce mécanisme pour exister ou pour imposer leur autorité. Sur ce dernier aspect, je prends pour exemple ma situation. Je suis professeur-documentaliste, je ne réponds d’aucun programme obligatoire, ma hiérarchie n’attend pas de moi que j’évalue concrètement mes élèves et ceux-ci sont surpris quand je leur annonce qu’iels seront évalué·es par compétence à l’issue d’un cours.
Mea culpa.
J’avoue être un agent du système, je participe à sa reproduction. Pourquoi ? Parce que tant que le système fonctionnera ainsi, j’aurais besoin de faire comprendre aux élèves que mon métier, en dépit du peu de considération qu’il suscite, a une importance, pour que cela soit aussi perçu par leurs parents, mais aussi pour exister face à une institution qui ne semble pas se rendre compte que nous sommes enseignant·es à part entière.
Ou pourrait m’objecter une certaine forme d’exagération, c’est possible, cependant d’autres exemples internationaux montrent que l’évaluation devient un but en soi, permettant notamment de maintenir des enseignements ou même tout simplement des établissements. Aux Etats-Unis, le Teach for test s’étend toujours plus, on forme les élèves à réussir les examens pour justifier de l’efficacité d’une école à faire réussir les élèves. De là à considérer qu’on pourrait glisser à un système du Test for Test, il n’y a qu’un pas qui n’est pas si grand.
En effet, il serait intéressant de comptabiliser et de comparer les temps consacrés à l’enseignement et ceux destinés à l’évaluation de ces mêmes enseignements. Combien d’heures perdues par semaine, quelle proportion d’une discipline à l’autre, quel temps hors cours pour corriger des copies au lieu de réfléchir à une pédagogie plus adaptée à chaque classe, à chaque élève ? Combien de temps perdu à chercher à exister plutôt qu’à enseigner ?
Enfin, et cela mériterait d’en parler plus longuement, il faut noter la croissance permanente des certifications distribuées par l’éducation nationale ; de la formation aux premiers secours en passant par l’ASSR, des nouveautés PIX et év@lang ou bien de l’expérimentation sur l’éducation financière, et bien sûr les évaluations de 6e et de 2nde. Le système éducatif deviendrait-il un substitut à l’ensemble des autres services publics ou des organisations d’éducation populaire ? Ce sont autant de raisons supplémentaires qui tendent à pervertir et déséquilibrer les relations entre les élèves et les enseignants. Si tant de choses peuvent être évaluées et certifiées en étant décorrélées de tout enseignement, comme dans le cadre de PIX par exemple, pourquoi respecter le déroulement et le contenu des cours ? Pourquoi les élèves devraient-iels mettre du sens à l’éducation à la place de l’institution elle-même ?
Il est donc urgent de réduire la place accordée à l’évaluation.
Quel est l’intérêt d’évaluer chaque notion abordée ? La succession automatique d’une séquence et de son évaluation est-il pertinent ? Les micro-tests quotidiens oraux ou écrits sont-ils utiles pour réconcilier véritablement les élèves avec leurs apprentissages ?
Il serait préférable au minimum, et à mon sens, de déplacer l’évaluation de fonction de couperet face à l’acquisition des savoirs à un moment déterminé, vers une simple vérification modulable dans le temps. Ce qui supposerait qu’un élève qui ne réussit pas une évaluation puisse la repasser jusqu’à atteindre un niveau considéré comme suffisant. Cela devrait être un droit fondamental pour les élèves.
Il faudrait aussi sortir de compte rendu trimestriel aux parents de la « réussite » de leurs enfants qui entretient une relation viciée des parents à l’école. C’est d’autant plus vrai pour les élèves en difficulté qui résume le plus souvent l’école à leur échec à être performant dans les évaluations. C’est d’autant plus vrai dans les milieux populaires où la réussite scolaire est perçue comme le seul moyen de sortir de sa condition sociale. C’est d’autant plus vrai dans l’éducation prioritaire ou la remise des bulletins doit se faire en main propre aux parents, ce qui sacralise plus encore ces rencontres avec les enseignant·es.
Il serait également important de penser une évaluation au long cours, une évaluation polytechnique et transdisciplinaire, à l’aune de ce qui est en place par exemple dans les lycées professionnels grâce aux chefs d’œuvres des CAP et des bac pro. Cette modalité permettrait de réconcilier l’acquisition des savoirs, leur application et leur évaluation, et ainsi de renouer peut-être une relation saine entre les élèves et les enseignant·es. Cela contribuerait à rendre plus perméables les disciplines entre elles, qui restent bien trop souvent cloisonnées, et enfin à redonner du sens à l’acte d’apprendre en associant l’aiguisement de la curiosité des élèves avec une démarche concrète et matérielle.
Car c’est bien ici que tout se joue, il faut donc que nous, enseignant·es, nous donnions les moyens de construire une culture commune émancipatrice et que nous tentions de nous soustraire à l’extension de l’obsession évaluatrice qui gangrène notre société.