Au fil de ses ouvrages (un essai, deux romans "jeunesse" et désormais un roman "adulte), Corinne Morel-Darleux explore différentes facettes de la bifurcation, de la rupture. Elle pose à chaque fois son regard singulier et généreux sur ce qui fait qu'on en vient à refuser de poursuivre le cours habituel des choses, le train-train quotidien lancé à toute vitesse vers la catastrophe.
On peut sans risque de se tromper estimer que le "refus de parvenir", qui était au cœur de son premier essai "Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce" a inspiré des trajectoires de vie. Son appel à "mettre de l'intention" dans la "multitude de petits pas de côté à dénicher" dans "un interstice de dissidence à aller chercher" raisonne ainsi fortement avec l'appel à déserter lancé par des étudiant.e.s d'Agro Paris Tech en juin dernier.
Son œuvre de fiction, Corinne Morel-Darleux poursuit ce sentier. Dans Le gang des chevreuils rusés, le passage à l'acte collectif d'une bande de gamins désireux de préserver un bout de forêt de l'appétit de promoteurs véreux est aussi joyeux et foutraque qu'une kermesse sur la place d'un village un dimanche de printemps.
Dans Là où le feu et l'ours, inspiré pour partie des expériences d'autonomie au Rojava, nous suivons le parcours de Violette, qui doit réapprendre à vivre, à faire confiance (mais aussi à se méfier), pour pouvoir laisser place à l'entraide (entre humain.e.s, mais aussi dans des alliances inter-espèces).
"La Sauvagière" nous entraine dans une autre dimension de la rupture et de la désertion : les ressorts intimes de la bifurcation.
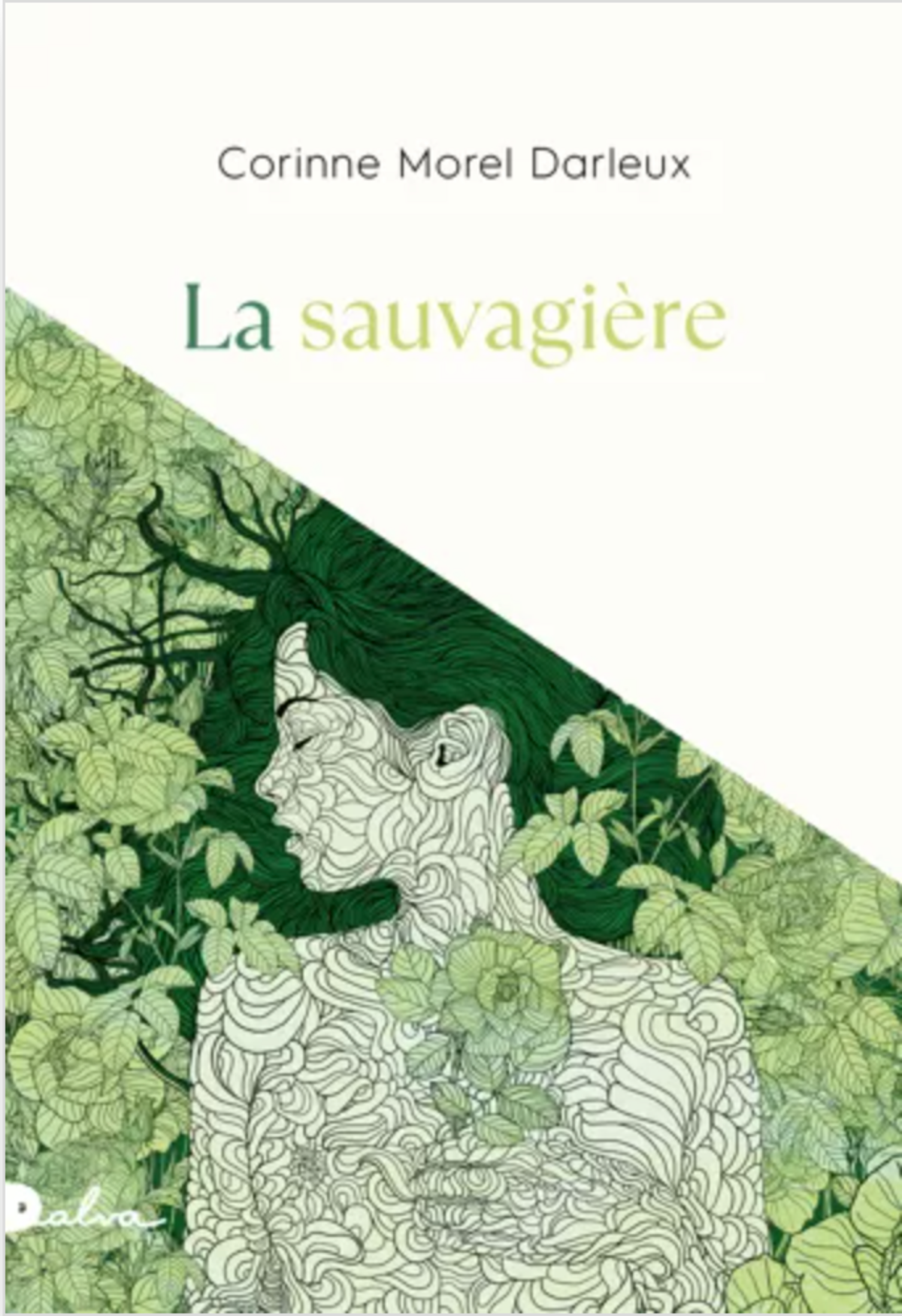
Agrandissement : Illustration 1
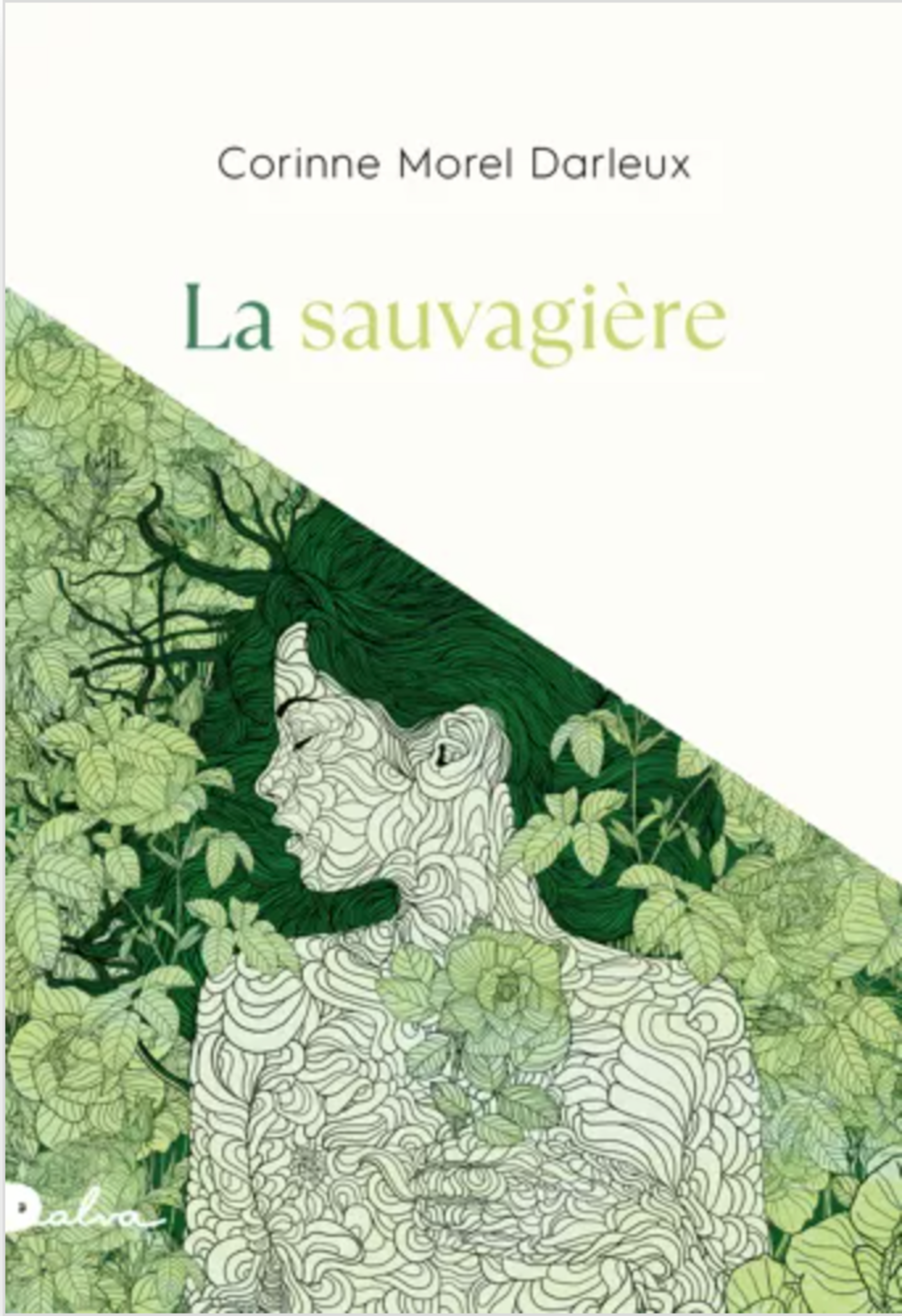
Il y a d'abord ce qui la provoque : ici un accident de moto. Mais l'accident est lui même l'aboutissement d'une quête de vitesse, qui permettait à la narratrice d'échapper à la ville, à son bruit, ses sollicitations et stimulations permanentes. Elle aspirait à se détacher, à quitter ses odeurs et ses lieux dont elle ne pouvait plus.
Elle se réveille alors dans une maison inconnue, perdue au beau milieu d'une forêt isolée. Stella et Jeanne l'y accueillent en silence, dans une économie de gestes et de mots qui permettent à la narratrice de reprendre peu à peu pied : ce n'est pas tout de rompre, de se détacher. Encore faut-il apprendre à se reconnecter.
La maison et la forêt sont une île : le monde extérieur ne se manifeste que dans l'esprit de la narratrice - des réminiscences de cette société dont elle ne voulait plus. Ici, elle fait l'exact inverse : elle n'envisage pas la fuite, ne cède plus à l'ivresse de l'asphalte comme exutoire.
La reconnexion commence par des petits détails. L'infime et l'intime : les petites bêtes qui courent sur le corps, les escarres et les cicatrices ; que les plaids, coussins et tisanes permettent d'apaiser. Ce corps qu'elle réapprend à connaître, elle passe alors au mouvement : des membres qui se déploient avec grâce et précision ; une danse qui devient chasse jusqu'à ce qu'une humaine se fasse renard. Et l'indispensable sororité, sans laquelle rien ne serait possible.
Bien sûr, ce cheminement n'est ni linéaire ni harmonieux : le mouvement se fait parfois auto-mutilation, violence contre soi-même pour se libérer de ce qui démange l'épiderme. Mais une fois abandonnée par Jeanne et Stella (ou bien seule face à elle-même, libérée de leurs apparitions), la narratrice est inéluctablement appelée au dehors, dans le potager puis dans la forêt.
Le récit se déroule au rythme des saisons, des conserves que l'on prépare l'été puis que l'on mange l'hiver ; de l'ail des ours qu'on ramasse au printemps ; des chardonnerets à la fin de l'été et des mésanges au cœur de l'hiver...
La langue que déploie l'autrice est le miroir du cheminement de la narratrice : la finesse du vocabulaire rend compte de la richesse des sensations qu'elle découvre une fois libérée du poids de la normalité qu'elle voulait tant fuir. Dans les dernières pages du roman, tout finit par s'entremêler dans une longue phrase qui porte toutes les dimensions de la bifurcation : le monde d'avant, la vie d'après et l'accident et la temporalité qui se brouille. Comme pour nous rappeler qu'on ne déserte pas du jour au lendemain, et d'ailleurs qu'on ne déserte jamais totalement - mais qu'on peut le faire ici et maintenant, que nous pouvons choisir nous-mêmes ces moments, petits ou grands, de rupture.
Une lucarne ouverte, une porte mal fermée ? C'est la forêt qui alors fait irruption dans la maison, par l'entremise d'une renarde et sa portée. Il n'y a plus dedans ni dehors. La narratrice est libérée et a repris sa vie - car au fond : tout ce qui précédait n'était peut-être qu'un long coma, un voyage intérieur dont les "deux lunes", n'étaient rien d'autre que la lumière blafarde d'une chambre d'hôpital ?Le récit serait alors une métaphore plus subtile encore que ce que l'on pouvait penser.
Car ce que la narratrice nous exhorte à quitter, c'est ce monde que l'on habite sans y rester : "je devais gérer le quotidien d'un petit village dont chaque habitant se moquait des conséquences de ses actes - il ne reviendrait jamais".
L'ouvrage sonnerait alors comme un appel à nous éveiller au monde en partant des petites sensations, qu'elles soient agréable ou qu'elles ne le soient pas, mais qui toutes nous traversent le corps et l'esprit. Être à fleur de peau pour mieux être au monde, et apprendre à l'habiter plutôt qu'à ne cesser de bouger, de nous déplacer ? Pour enfin graver à la pointe de l'Opinel, à l'aide d'une grelinette ou en s'enchaînant à une machine de chantier censée détruire quelques arpents de terre que nous voulons vivre "chacun selon ses besoins" plutôt que "chacun selon ses moyens" (Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce).
----
Corinne Morel-Darleux, La Sauvagière, éditions Dalva, août 2022.



