Par Maxime Combes et Nicolas Haeringer
(il s'agit d'une version courte d'une note plus longue, que vous pouvez retrouver ici)
Aux États-Unis, ce 20 avril, le prix du baril de WTI brut (West Texas Intermediate Crude) est passé sous la barre hautement symbolique du… zéro dollar. Il est même tombé à -37,63$ en fin de journée. Le “prix négatif” du baril a provoqué la stupéfaction et la sidération.
Pourtant, à y regarder de plus près, l’anomalie n’est pas forcément là où on le croit : on peut en effet considérer que le pétrole a atteint son juste prix. Décryptage (en forme de version courte d’une note plus longue que nous avons publiée ici).
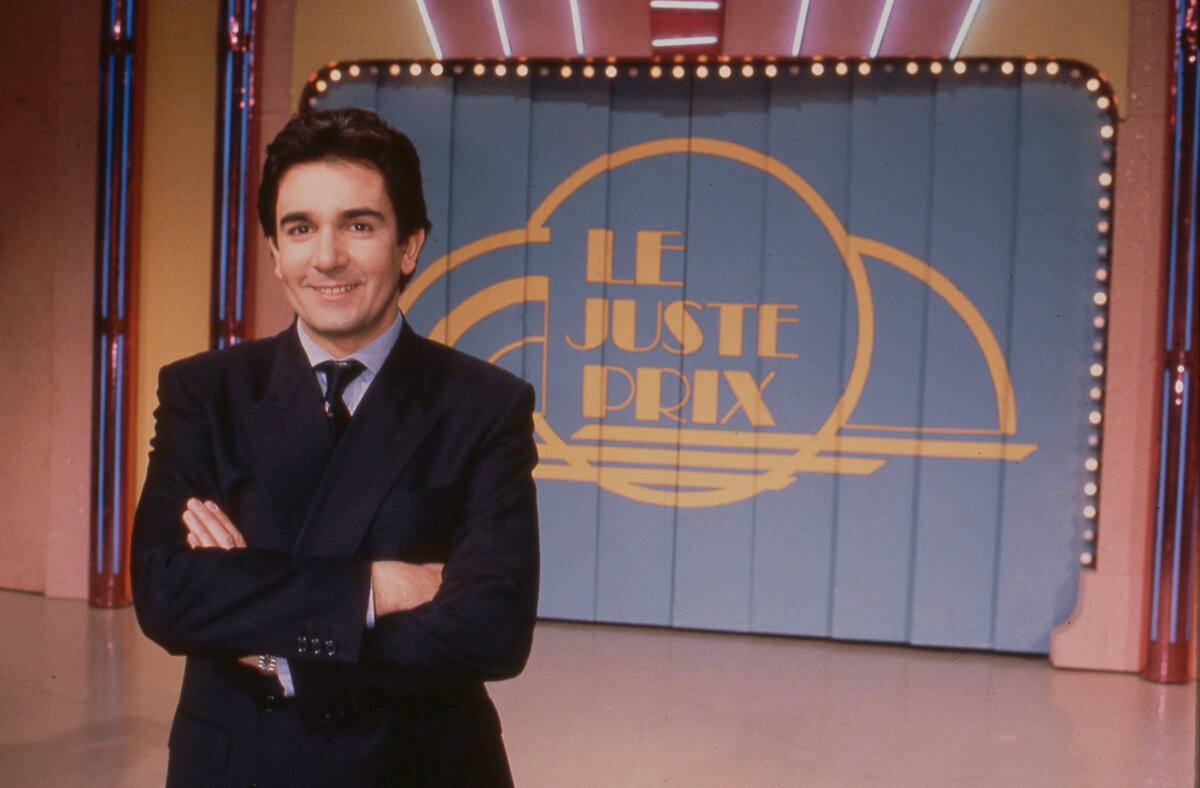
Agrandissement : Illustration 1
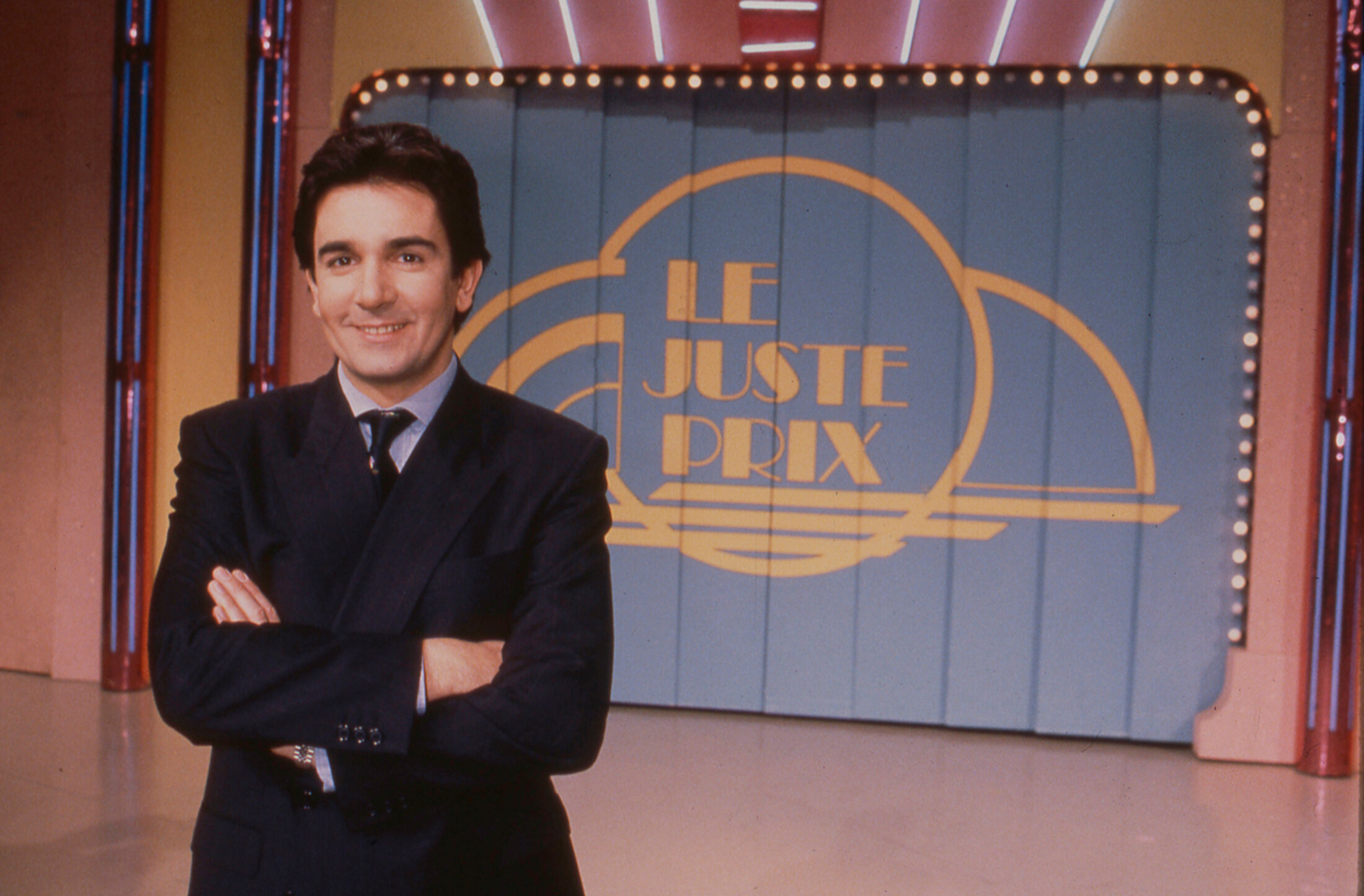
Pétrole de papier...
Le 20 avril dernier, nul consommateur n’a reçu de l’argent en faisant le plein d’essence, ni même en achetant un baril. C’est en effet du “pétrole de papier” qui s’est effondré : le cours du pétrole WTI brut n’est qu’une cotation sur un marché financier, parmi d’autres d’autres cotations sur d’autres marchés, d’un type de pétrole spécifique, produit aux États-Unis. Depuis que le pétrole est devenu un produit financier comme un autre, des investisseurs achètent et revendent des titres financiers, portant sur du pétrole à venir : avant qu’il ne soit extrait, un baril est échangé plusieurs milliers de fois sur les marchés, par des investisseurs qui n’ont nullement l’intention de prendre livraison des litres de pétroles qu’ils échangent : pour la plupart, ils n’ont pas la possibilité, encore moins la compétence, leur permettant de transporter, stocker et raffiner du brut.
Lundi 20 avril, à force de spéculation, les détenteurs de ces contrats étaient prêts à payer pour se débarrasser d’un pétrole qu’ils n’avaient jamais eu l’intention d’acheter physiquement.
… pour placement à risque
Les vendeurs étaient nombreux, alors que personne ne voulait acheter : c’est un krach. Ce dernier a le mérite de rappeler qu’investir dans le pétrole n’est pas si raisonnable et que les marchés financiers ne savent pas “réguler” une situation de trop-plein de pétrole. Le pétrole n’est pas qu’un actif physique avec une valeur monétaire. Il peut se transformer en un passif dont il faut se débarrasser à (presque) tout prix.
Pourtant, les investisseurs institutionnels considèrent aujourd’hui encore le pétrole comme un placement fiable, parmi les plus rentables qui soit. Pour eux, le prix du baril ne pourrait que croître à l’avenir, sous l’effet de l’augmentation de la consommation et de la raréfaction de la ressource (le fameux pic pétrolier). Sur ce point (et sur ce point seulement), les investisseurs rejoignent d’ailleurs une partie des écologistes, qui considèrent que la conséquence du pic pétrolier sera de faire grimper irrémédiablement le prix du pétrole.
Alors que le pétrole apparaît désormais comme un produit financier comme les autres, dont le prix peut complètement dévisser. tous les plus grands investisseurs mondiaux dépendent fortement des revenus qu’il génère. Les multinationales de l'énergie sont d’ailleurs des poids lourds des indices boursiers, dont elles représentent environ 15% de la valorisation. BlackRock, auquel le gouvernement s’apprêtait à ouvrir grand les portes de l’épargne retraite des salarié.e.s basé.e.s en France, détient par exemple 5,3 milliards d’action Total (au cours de l’action à la mi-avril). Et les investisseurs publics ne sont pas en reste : en France, la Caisse des dépôts et consignations est un soutien majeur des entreprises pétrolières françaises.
Fermer les vannes financières
Quiconque place de l’argent dans le secteur fossile joue à quitte ou double. Les alertes ont été lancées depuis plus de dix ans sur les fameux stranded assets, ou “actifs bloqués” : si on prend le climat au sérieux, la valorisation boursière des entreprises du secteur ne peut à terme qu’être réduire à peau de chagrin. Parier sur un renchérissement du prix du baril est hautement risqué - et ce serait renoncer définitivement à contenir le réchauffement “bien en-deçà” des 2°C. À ce jour, la seule attitude raisonnable est donc de désinvestir du secteur fossile.
L’effondrement des prix que l’on constate depuis le début de la crise sanitaire pourrait, si le cours du baril ne remonte pas, conduire les principaux acteurs du secteur à revoir leurs investissements drastiquement à la baisse. Sur ce plan, c’est une excellente nouvelle - et une opportunité bien plus prometteuse que de renflouer le secteur, en faisant le pari que la hausse des prix rendrait la transition plus intéressante financièrement. La seule voie possible, qui permette de protéger les droits des salariés du secteur, est désormais sa socialisation, assortie de conditions claires quant à sa reconversion vers les énergies renouvelables.
Le pétrole est à son juste prix, laissons le à sa juste place : dans le sol
Le pétrole est aujourd’hui échangé au plus près de ce qui devrait être son prix réel si l’on tenait compte l’impératif climatique : zéro euro.
Aux États-Unis, le prix du baril a chuté, car la ressource est temporairement trop abondante. Le confinement et les conséquences de la pandémie sur l’économie ont fait baisser la demande, et les capacités de stockage sont proches de la saturation. L’offre est trop importante pour une demande mondiale qui a chuté, de 30 à 40% sans doute.
Une fois la pandémie passée, les choses reprendront, nous dit-on, leur cours normal - baril inclus. Selon certains économistes, ils pourrait même rapidement grimper au-delà des 100$, sous l’effet d’un boom de la demande. Pour autant, nous voudrions ici prendre les choses à rebours : d’un strict point de vue climatique, le pétrole est une ressource surabondante. Nous avons trop, bien trop, beaucoup trop, démesurément trop de pétrole.
De ce point de vue, le prix du pétrole, en tant que matière première surabondante (mal) régulée par les marchés, devrait donc être nul, ou presque. Le juste prix du pétrole au regard de la contrainte climatique, c’est donc le prix actuel du pétrole de papier. Cela tombe bien : le moyen le moins onéreux (et coûteux pour le climat) de stocker le pétrole, c’est de le laisser là où il est, à savoir : dans le sol ; et le meilleur moyen de ne plus investir dans l’exploration et l’exploitation de nouveaux gisements, à défaut d’une interdiction par les pouvoirs publics, est d’avoir un prix du pétrole complètement déprécié.
De ce point de vue, la période actuelle constitue à bien des égards une opportunité historique de définanciariser l’économie, de tourner enfin la page des énergies fossiles, pour entamer la reconstruction d’une nouvelle économie, juste et durable. Si l’on met dans la balance des plans de relance hautement carbonés d’un côté, de l’autre des mesures permettant d’engager enfin la grande transition vers une économie libérée de l’extractivisme, il est difficile de surestimer l’importance de ce qui se joue actuellement. Les politiques qui sont en train d’être élaborées vont largement déterminer ce à quoi ressemblera notre devenir climatique pour des dizaines, sinon des centaines d’années. C’est donc un moment de vérité pour le mouvement pour la justice climatique. On a souvent glosé sur le fait qu’il était plus difficile d’imaginer l’après capitalisme que la fin du monde - nous voici expressément invité.e.s à penser et construire un avenir libéré du capitalisme fossile, sous peine de voir notre monde finir de tomber en ruine.
Maxime Combes et Nicolas Haeringer
Cette position est développée et explicitée dans une version longue de la note.



