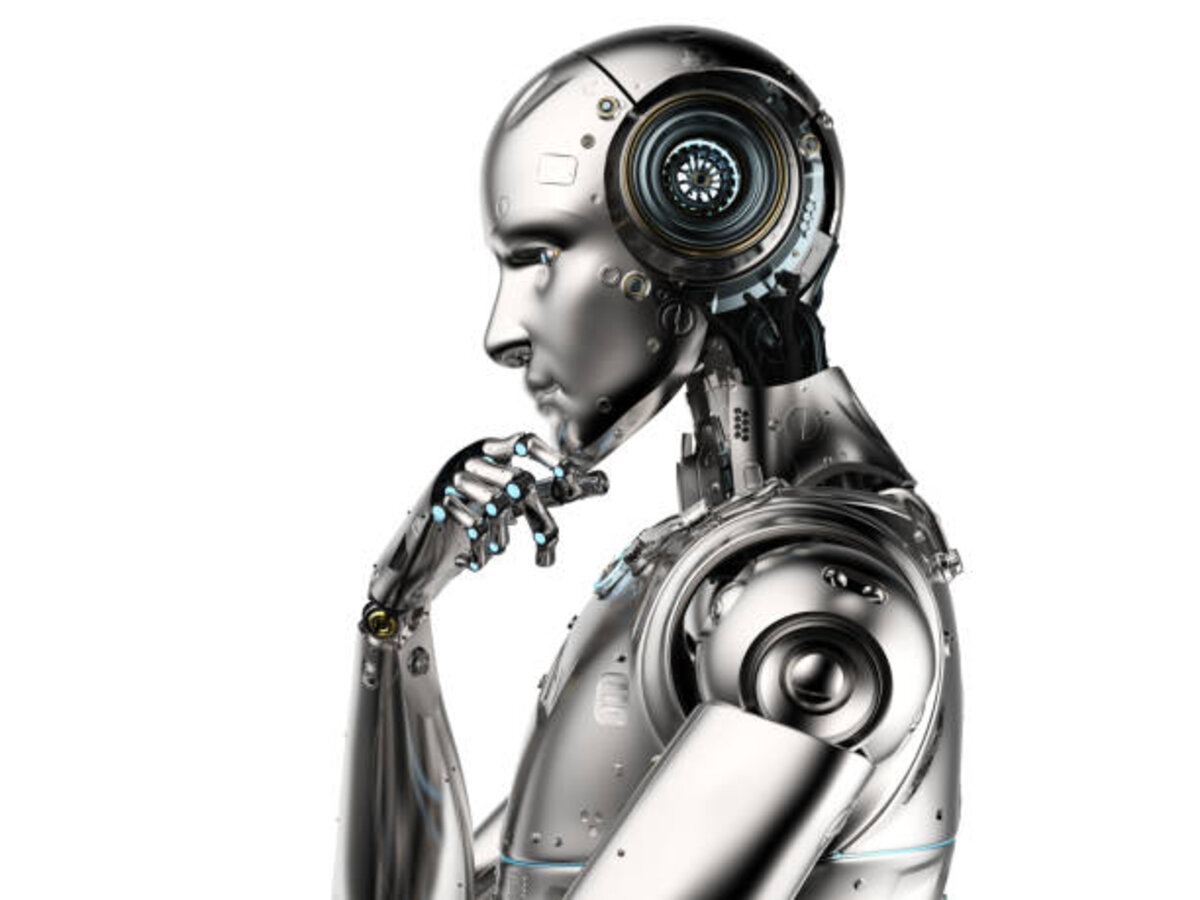
Agrandissement : Illustration 1
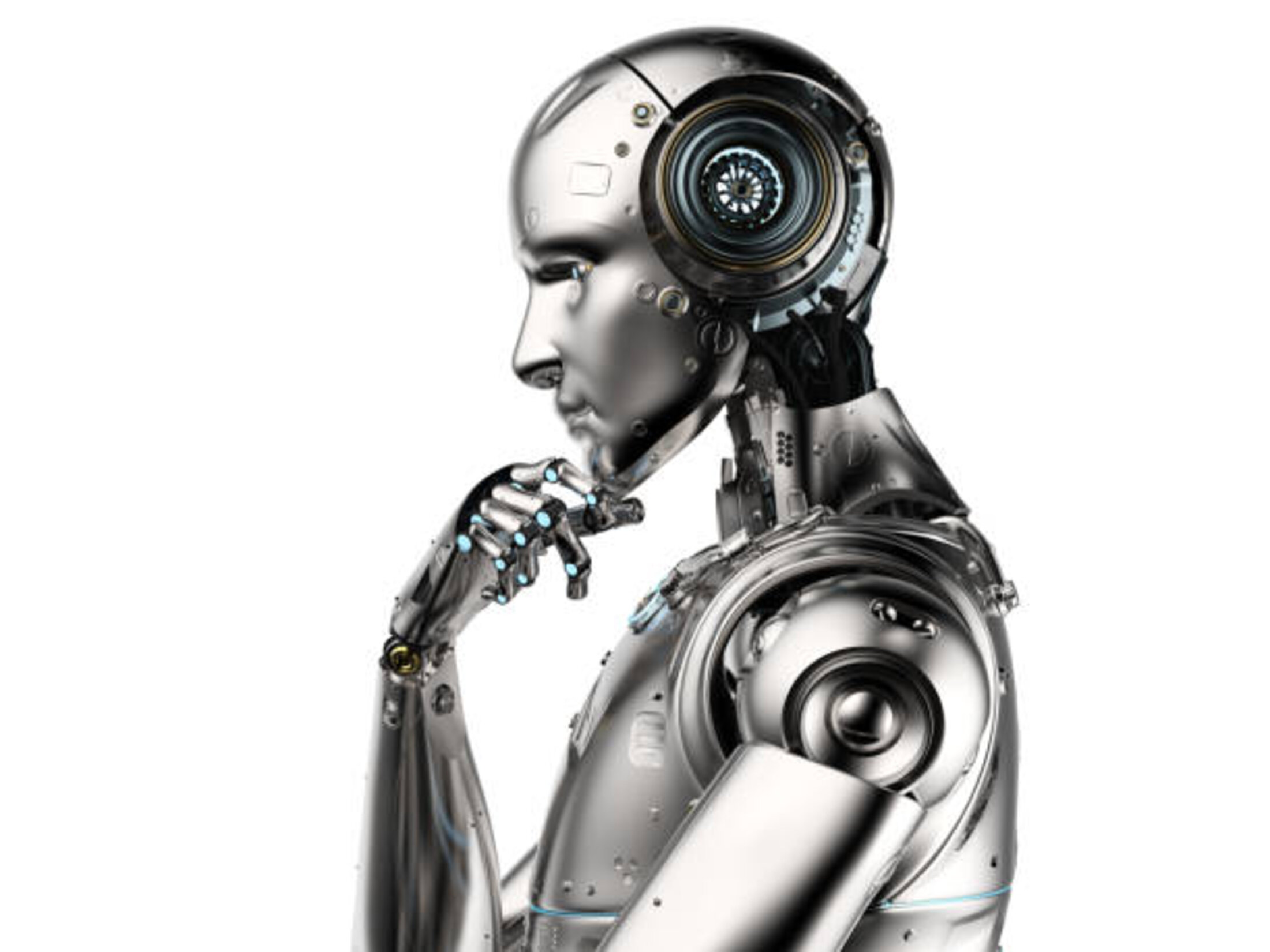
Nous savons cela depuis très longtemps, depuis au moins les sophistes grecs, qui autour du Vème siècle avant JC, ont largement abusé de la puissance de la réthorique froide et désincarnée et par là-même démontré de facto qu'elle se prête constitutivement à être utilisée de façon totalement absurde. Et est ainsi la meilleure arme pour défendre l'indéfendable.
Pourquoi cet usage de la pure réthorique est-il intrinsèquement absurde ? Parce que, livrée à elle-même et coupée du ressenti vécu par un être vivant pensant, la logique des raisonnements les plus impeccables, même si elle semble valide en surface, perd en fait tout son sens. Cette logique ne peut convaincre en profondeur. Elle ne repose que sur un repertoire de procédés oratoires conçus pour imposer au cerveau humain une apparence de réalité parfaitement construite, sans que cette réalité soit étayée par une perception sensible partagée avec d'autres. « Quand le vrai manque, le vraisemblable suffit » est sa devise.
De la même manière, l'usage des mots par une machine ultra-perfectionnée peut très bien imiter un style, intégrer de nombreuses références et obsessions récurrentes, un rythme et un contexte, mais jamais, par définition, bifurquer vers l'imprévisible qui caractérise le cheminement vivant de la pensée d'un être en évolution, atteint d'influences changeantes, doté d'un corps biologique et ressentant à travers lui. Là aussi, « Quand le vrai manque, le vraisemblable suffit ». C'est pourquoi, accepter d'utiliser ces machines algorithmiques pour remplacer la pensée vivante d'êtres vivants en la réduisant à une fonction mécanique, nous rapproche d'un point-limite absolu qui signale l'imminence de la destruction de l'humain.
Tricher avec les outils de l'expression a toujours été une possibilité de l'être humain, une possibilité qui entre dans le cadre de la spécificité de l'espèce, qui est la liberté de choix (dont parle Sartre par exemple), ou peut-être l'obligation de choisir. D'où l'absolue nécessité d'un repère moral pour faire apparaître le choix. Je ne serais d'ailleurs pas surpris d'apprendre que l'image chrétienne du Diable - dia-bolum (qui divise) en opposition à sym-bolum (qui unit) - fut une tentative un peu puérile de rendre apparent le risque qu'implique cette supposée "liberté" de choix. Cette image a en tout cas un mérite : elle montre que tout ce que nous pouvons faire n'est pas à faire, sous peine d'être qualifié de «diabolique».
Or, nous traversons un moment historique où, le système dominant n'intégrant plus aucune notion morale ni éthique, nous arrivons au bout d'un cheminement qui débuta probablement aussi à la grande époque des Grecs et trouve aujourd'hui sa limite létale.
Nous ne nous posons plus la question de savoir si une chose que nous pouvons faire doit ou non être faite selon qu'elle est bonne ou mauvaise, la notion de progrès a balayé tous les obstacles. Ces critères ont disparu. Une chose que la civilisation ultralibérale peut faire sera faite, même si elle est évidemment mauvaise. La seule condition sera l'efficacité (économique, scientifique ou militaire par exemple).
La tendance qui est ici favorisée, est en fait celle qui est utilisée par tous les régimes autoritaires : dresser un mur infranchissable entre la logique et le ressenti, de façon à pouvoir agir monstrueusement.
Je voyais hier soir sur Arte une belle série espagnole intitulée "Dis-moi qui je suis" où sont montrées les tortures subies dans les geôles de Staline. Lorsque la victime est arrêtée, son interrogatoire consiste pour le policier à répéter mécaniquement les mêmes phrases sans jamais entendre ce que celle-ci répond. Les mots sont devenus des instruments de pouvoir mécaniques, une machine pourrait en faire autant. Les méthodes du régime nazi ou même celles employées à Guantanamo, ne diffèrent certainement pas beaucoup de cette mécanique. Il y a de petites différences, le degré de sadisme par exemple, mais on peut percevoir dans tous les régimes totalitaires un point commun : les mots sont arrachés à leur humanité. L'usage des mots hors d'un ressenti partagé est commun à tous les fascismes.
C'est l'une des raisons pour lesquelles le geste de l'art, et en l'occurrence le geste de la poésie, est profondément révolutionnaire.



