« Comment repenser la France complexe et chahutée de ce XXIème siècle ? », pose Laurence de Cock en préface du « Mythe national » de l’historienne Suzanne Citron. « D’abord, déterritorialiser le regard historique coincé dans l’Hexagone par l’éveil d’une conscience planétaire. L’approche initiale de l’aventure humaine dans son immense durée et sa diversité permettraient au Françaises et aux Français de se reconnaître membres d’une collectivité terrienne aux multiples visages », répond-elle.
Une lecture simpliste du passé
Pour Suzanne Citron, « l’histoire fabriquée et transmise par l’école devenue obligatoire a d’abord été le catéchisme d’une religion de la France. »
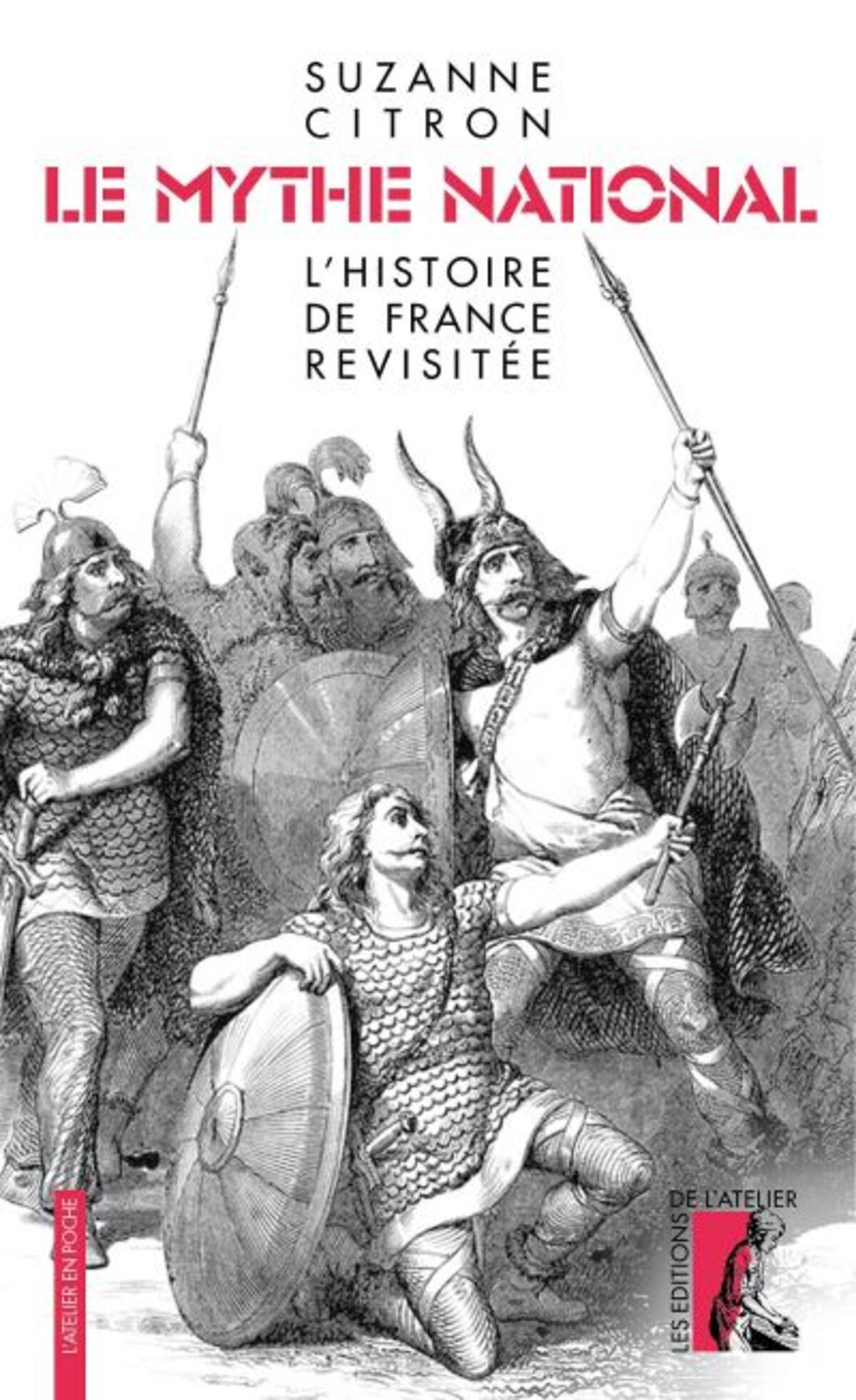
Agrandissement : Illustration 1
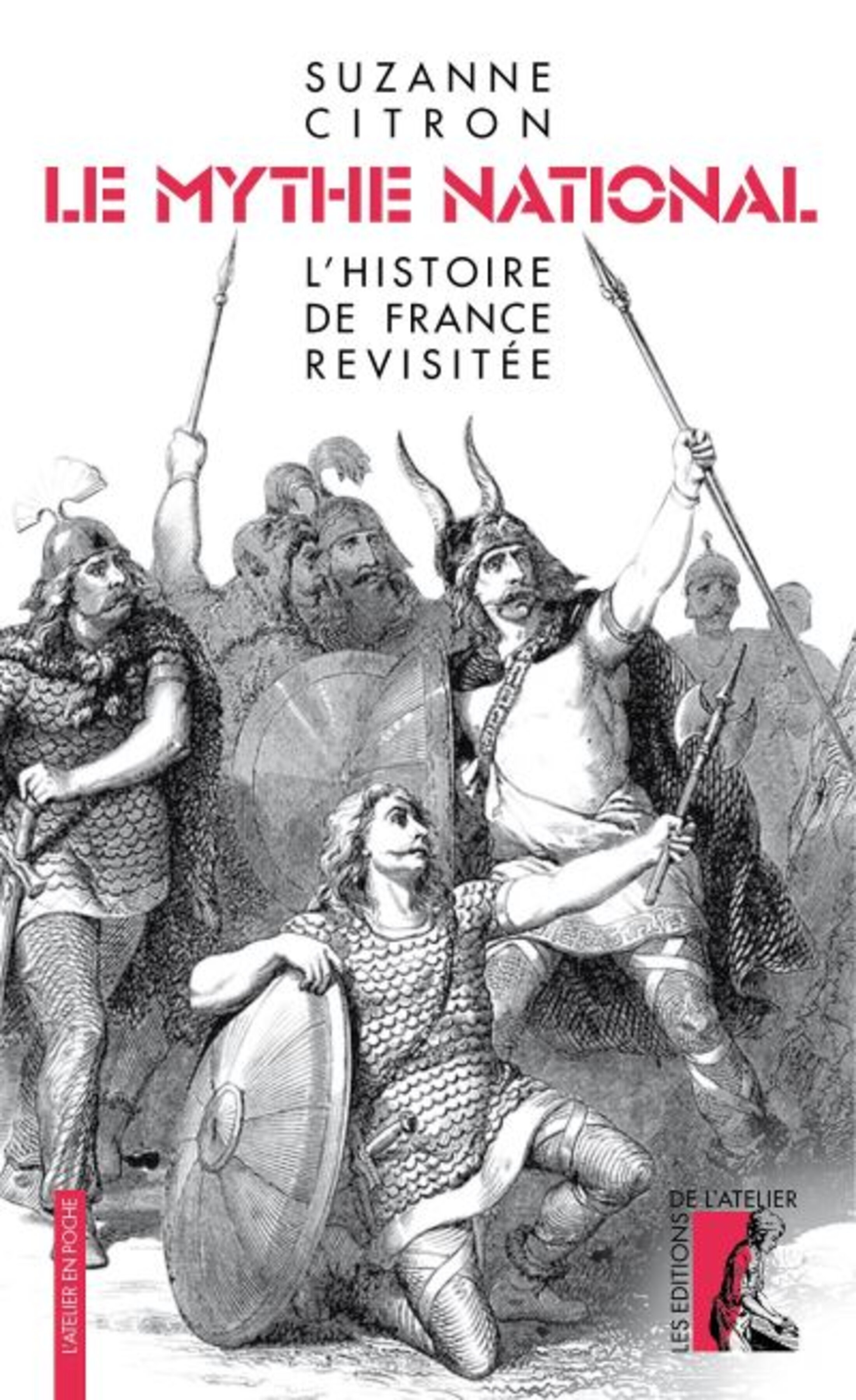
Une légende façonnée au cours du temps qui représente surtout « une histoire totalitaire, une histoire des triomphes du pouvoir où la voix des vaincus, des annexés, des persécutés, des opposants n’est pas entendue. Mémoire de l’État, à l’exclusion des autres mémoires, qu’elles soient régionales, culturelles, sociales, religieuses, colonisées, immigrées, cette histoire occulte ce qui la gêne ou l’ignore, mais ces ignorances sont significatives. »
L’historienne propose une relecture des programmes d’enseignement français d’histoire et part du « mythe gaulois [qui] donne à la nation une et idivisible son homogénéité et sa cohérence culturelle. » Pour elle, la Révolution française a ensuite été galvaudée en contredisant « par la théorie des frontières […] sa vocation universelle, renfor[çant] la conception territoriale de la nation, semant par là quelques graines des nationalismes qui, en 1914, mettront l’Europe en feu. »
Pour l’historienne, la période révolutionnaire française a été le jeu d’un glissement de pouvoir : « la Révolution transfère dans ce qu’elle appelle les nations l’unicité du pouvoir jusque là incarné par le roi. » Le pouvoir du roi se retrouvant désormais dans « la représentation nationale » est « cautionnée par l’idée rousseauiste que l’opposant à la “volonté générale“ doit être rejetée. L’exclusion des opposants devient un trait commun de la culture des élites françaises. En faisant de l’inidivisibilité le chantre même de la République, la Convention nationale déclenchera l’engrenage totalitaire ancré dans la monarchie absolue. »
Ainsi, l’enseignement devient une machine idéologique au service d’une certaine idée nationale : « […] la pluralité des mémoires constitutives de l’identité française est un non pensé de l’école méthodique. » Le récit national simplifie alors les choses des origines des Gaulois à la IIIème République. « Or, la conception déterministe du déroulement du passé est dangereux du point de vue d’une pédagogie démocratique », pointe l’historienne. « Car la supposée continuité, qui relie les événements comme une suite inéluctable, peut incliner au fatalisme, à la résignation, à la déresponsabilisation du citoyen par rapport au devenir collectif. Il est certes indispensable de comprendre que l’ “après“ succède à l’ “avant“, mais les chronologies trop linéaires peuvent être le “repaire“ de sectarismes idéologiques qui bloque la perspective dynamique d’un avenir transformable, et cela d’autant plus qu’une lecture simpliste du passé se retrouve, par contre-coup, dans les revendications victimaires des mémoires occultées. »
Repenser l’histoire de France
Les débats actuels d’une France mythifiée et naturalisée pour certains (les réactionnaires) et, pour d’autres, d’une France républicaine, fer de lance d’un humanisme mal appréhendé car s’enfermant dans la nation (la gauche radicale), sont les objets de la continuité d’une lecture de l’histoire biaisée par le récit national. Pour Suzanne Citron, « la crise de l’identité nationale ne peut être dissociée d’une crise de la culture “républicaine“, qui se manifeste par des références à l’exceptionnalité de la nation et par l’usage incantatoire du mot “République“. L’imaginaire historique forgé par le récit du XIXème siècle sous-tend des nationalismes et des souverainismes. »
Pour l’historienne, il est important de « repenser l’histoire de France » : « Les cathares exterminés, les juifs expulsés, les protestants traqués, les noirs d’Afrique transportés aux Antilles, ne sont-ils pas […] sujets de l’histoire ? » Pour elle, « le lien d’une tradition historiographique, héritée, en fait des “Grandes Chroniques“ qui subordonne la lecture du passé à la célébration du pouvoir doit-être définitivement rompu dans tous les ordres d’enseignement, pour que les mémoires des persécutés, des vaincus, des rebelles, des sacrifiés à la raison d’État, des colonisés, qui sont les “ancêtres“ de beaucoup de Français, trouvent dans l’histoire, un terrreau d’enracinement. »
L’aventure humaine
Suzanne Citron propose de remettre l’histoire nationale dans la perspective de « l’aventure humaine » : « le cadre de notre existence collective est d’abord l’aventure humaine comme il l’est pour toute nation, tout groupe, tout individu. Le renforcement de la vision territoriale, la sacralisation des frontières avec l’ère des États-nations ouverte par la Révolution française effacèrent la conscience cosmopolite qui s’étaient épanouie au temps des Lumières. La nation une et indivisible s’est enfermée dans l’orgueil d’une France mythique, supérieure, messianique, impériale au temps des “colonies“, implicitement hexagonale, alors qu’elle est faite de fragments d’Europe, irriguée de sève africaine, asiatique, antillaise… »
Le métissage culturel et social est le ferment de l’histoire humaine. Ce n’est que très récemment dans l’histoire qu’il devient « immigration ». « “Depuis le XIIIème siècle, écrit Patrick Weil, la France est un pays d’immigration. Mais celle-ci ne devient un problème que dans la seconde moitié du XIXème siècle.“ », explique Suzanne Citron. « Le mot même d’immigration, précise pour sa part Gérard Noiriel, “fait partie d’un lexique qui se constitue en même temps que la IIIème République.“ Les débuts de l’immigration de masse coïncident avec “la mise en place de l’espace public républicain.“ Une nationalité française s’invente : la nation politique est élargie à toute la population française masculine, l’école obligatoire diffuse à chacun images et symboles nationaux. Et la loi de 1889 pose pour la première fois le problème de l’assimilation des étrangers dans la communauté nationale. Les différentes phases d’immigration dans la France républicaine coïncident désormais avec des tensions xénophobes. »
Finalement, le mythe national est encore bien présent semant les graines de la division et du rejet de « l’étranger » : « Et comme à cette quadruple exclusion de l’école, du travail noble, de l’argent, de tout travail se superpose le plus souvent la différence de couleur de peau et l’abus des contrôles au faciès, la relégation aux marges de la société coïncide le plus souvent une relégation ethnique. »
Suzanne Citron invite donc à « réinventer la France ». Un mot d’ordre éclairant dans ces temps de réaction généralisée pour remettre les destins individuels et collectifs dans les pas de la grande aventure humaine.
Bibliographie
Citron, Suzanne. Le mythe national. Éditions de L’Atelier, 2017.



