A l’occasion de la sortie du numéro 104 de la revue Communications : Les Droits humains au XXIe siècle, dont je publie ci-dessous la présentation, une rencontre débat est organisée avec les auteur.e.s. le mardi 28 mai 2019 à 17h (EHESS, 105 bd Raspail 75006, salle 13). Elle sera suivie d’un hommage à Gaëtan Mootoo, décédé le 25 mai 2018, à qui ce numéro est dédié. Sa collègue d’Amnesty International, Paule Rigaud, évoquera son travail et ses combats. Un pot amical clôturera cette rencontre.
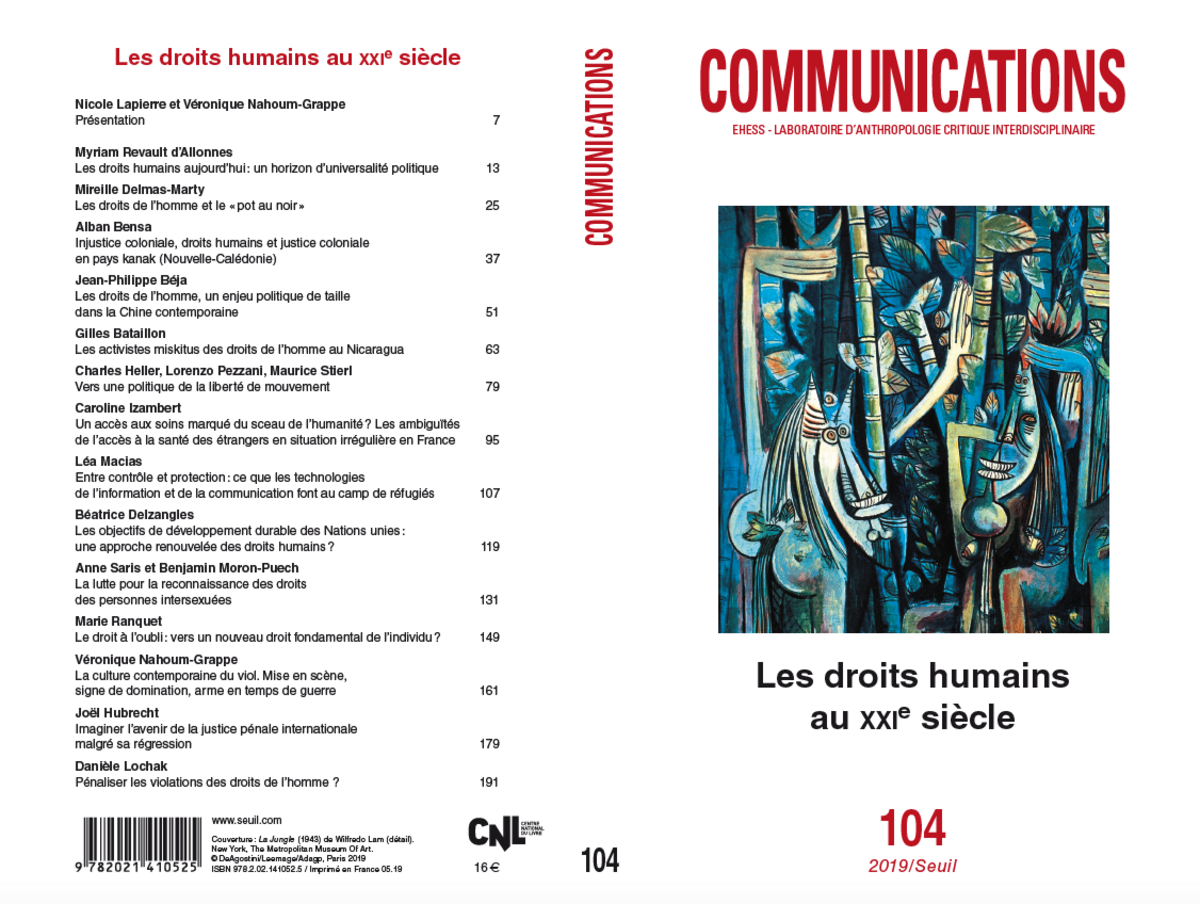
Agrandissement : Illustration 1
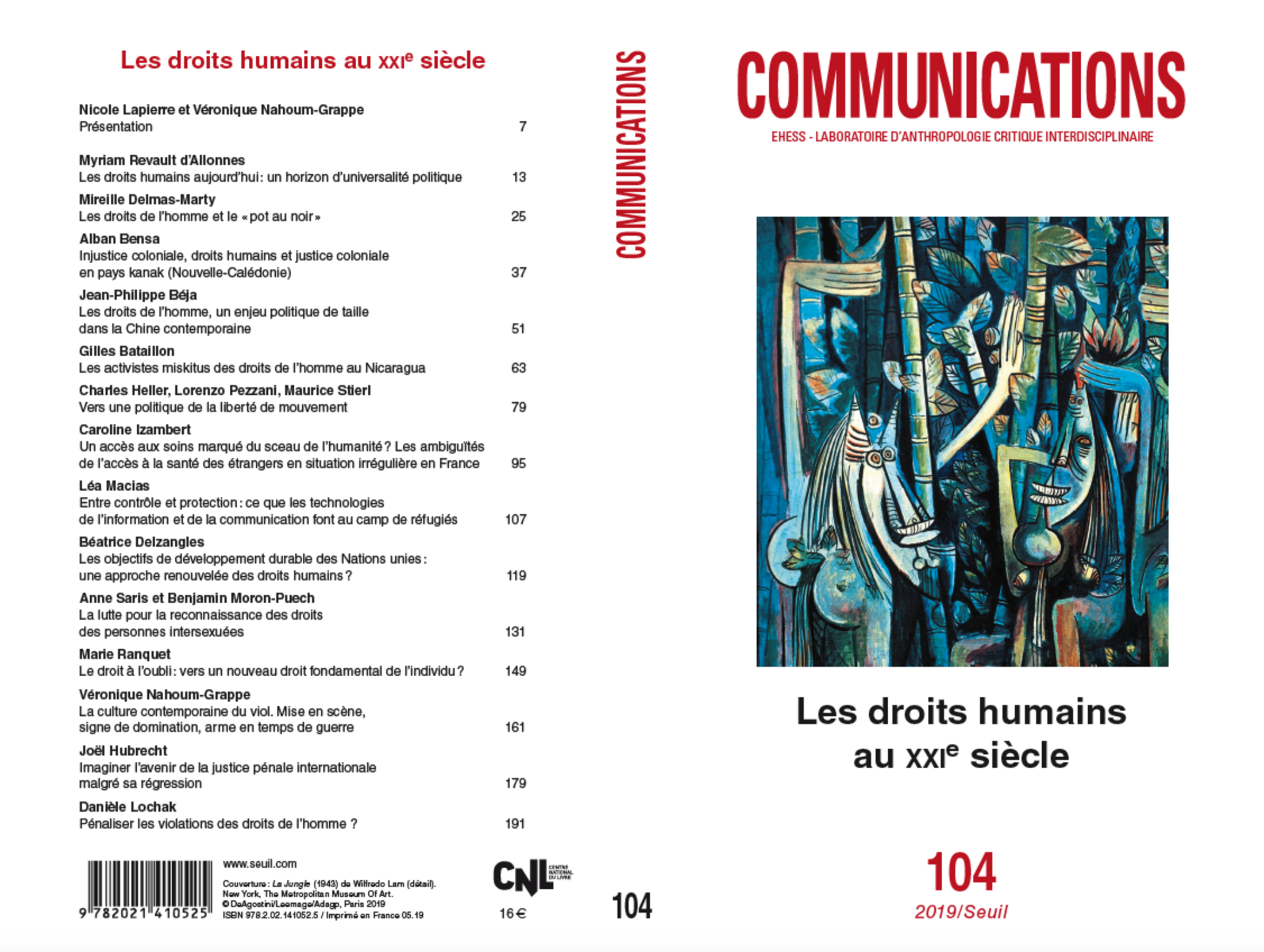
La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948, dont l’article 1er stipule que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », affirme comme principe intangible à l’échelle de l’humanité tout entière le fait que la dignité (mentionnée en premier), les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à chaque être humain et inaliénables. Si cette déclaration ne fait pas partie du droit international dit « contraignant » (c’est-à-dire d’application obligatoire), elle constitue un texte de référence qui a inspiré nombre de traités internationaux, eux légalement contraignants, relatifs aux droits humains et à leur développement conséquent à l’échelle internationale.
De la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à ces traités en passant par la Déclaration de 1948, ces droits ont une histoire philosophique, idéologique, politique et juridique qui continue de s’écrire, non sans résistances et contradictions. Ils ne sont ni gravés dans le marbre, ni inscrits dans la perspective d’une avancée linéaire et ininterrompue. Ils sont inégalement garantis, et leurs violations sont innombrables. Ils n’offrent ni l’assurance d’un progrès inéluctable, ni une promesse illusoire, mais doivent être en permanence repensés.
Leur déploiement comme leur universalisation dépendent avant tout des combats menés en leur nom et du sens qu’ils prennent dans ces combats, bref de la vie sociale des droits. De nouvelles questions émergent et de nouveaux combats surgissent, réclamant leur extension à de nouvelles causes et la conception de nouvelles normes. La globalisation économique, la menace écologique, le sort des populations migrantes, la stigmatisation de certaines minorités – et la liste ici n’est pas exhaustive –, nécessitent la réaffirmation des principes acquis sans être respectés et de protections inédites.
Ce numéro de Communications, dans lequel se croisent juristes, philosophes, ethnologues et sociologues, porte sur les défis, les luttes, les contradictions et les critiques auxquels sont confrontés, aujourd’hui, les droits humains. Nous avons opté pour cette dernière expression plutôt que celle de droits de l’homme, qui subsume la notion générique des êtres humains (présente dès la première ligne de la Déclaration de 1948, mais pas dans son intitulé) sous la catégorie du masculin. Nous n’allons évidemment pas réécrire l’histoire des déclarations et des principes depuis 1789, ni effacer une formulation qui renvoie à des textes et des contextes, des idéaux et des luttes politiques toujours actifs dans la mémoire commune.
Mais vu du présent, et notamment des combats essentiels et inachevés pour l’égalité entre les hommes et les femmes, mieux vaut parler de droits humains (comme le font beaucoup d’ONG et d’organismes officiels désormais en parlant de human rights ou de derechos humanos) plutôt que de droits de l’homme. Cette dernière appellation efface en effet la question des femmes en tant que moitié de l’humanité. L’espèce humaine oblige à penser l’unité du sujet de droit comme d’emblée plurielle, ainsi ce qui est perdu en stabilité monolithique du concept est gagné en possibilité de penser les différences. On verra que dans ce numéro, les auteurs ont utilisé l’une ou l’autre de ces deux formulations : les droits de l’homme en référence aux déclarations et pensées fondatrices ou les droits humains selon l’usage qui tend à prévaloir désormais.
Quelle que soit la dénomination et en dépit de leur extension, ces droits fondamentaux demeurent fragiles, incomplets, souvent violés, et ceci n’est pas le triste apanage des régimes autoritaires. Les pays démocratiques ne sont pas les patries irréprochables des droits humains, loin de là. Même dans les démocraties européennes, ils restent inappliqués, ou mal appliqués, dans de nombreux domaines, notamment en ce qui concerne les réfugiés, exilés et migrants, mais aussi le sexisme ou les traitements discriminatoires.
Plus généralement, les droits humains restent tendanciellement bafoués de façon systémique dans la structure même de toute situation où l’inégalité économique reste la norme. Plus la victime est « inégale », c’est-à-dire précaire et vulnérable, moins elle est en position de réclamer ce à quoi elle a droit, et moins elle a de chance d’être défendue. Les Roms, les enfants au teint hâlé des quartiers défavorisés, seront l’objet d’un traitement juridique plus répressif à crime égal que les populations issues des classes privilégiées. Les inégalités économiques sont corrélées aux situations d’injustice légale. Les vulnérabilités sociales et raciales se cumulent. En Europe, aux États-Unis comme dans de nombreux pays d’Amérique latine, les plus foncés de peau, minoritaires sur les écrans, sont majoritaires en prison et dans les quartiers pauvres.
Nécessaires, les droits humains sont également menacés par l’aspiration d’un positivisme juridique et la dérive d’un humanitarisme apolitique. Ils sont en outre critiqués de diverses manières. Au nom d’une vision inégalitaire de l’humanité, le mépris pour les « droits-de-l’hommistes », selon une expression venue de l’extrême droite, reprend de la vigueur. Plus profondément, la notion philosophique, politique et juridique d’universalité fait l’objet de contestations et d’interrogations. Au nom de l’histoire, et notamment de l’histoire coloniale, ces droits, proclamés et exportés par un monde occidental qui ne les a pas respectés, sont dénoncés comme l’alibi d’un impérialisme impénitent. Par ailleurs, des pouvoirs non démocratiques les récusent en invoquant le relativisme culturel. Enfin, l’universalisme abstrait, aveugle par principe aux différences, s’avère par là même aveugle aux discriminations et inégalités. D’où la question, sujette à polémiques, particulièrement en France : pour assurer l’égalité réelle des droits, ne faut-il pas assouplir l’universalité formelle du droit ?
Dans les deux premiers articles, Myriam Revault d’Allonnes en philosophe et Mireille Delmas-Marty en juriste prennent ces questions à bras-le-corps. La première propose de dépasser cette disqualification des droits humains, à l’heure où ils sont récusés, dans leur principe même, par des régimes qui leur opposent la revendication d’identités substantielles (nationales, ethniques, religieuses ou culturelles), en dégageant les conditions de leur réelle effectivité politique. À l’opposé d’une abstraction surplombante, elle défend un « universel élargi » à la fois grâce aux dispositifs institutionnels et à travers les luttes qui donnent au « droit d’avoir des droits » une réelle valeur émancipatoire. La seconde analyse les contradictions internes mais aussi les conflits externes auxquels ces droits sont confrontés au risque de s’égarer, par exemple quand il s’agit de « raisonner la raison d’État », de définir des risques acceptables dans l’imprévisibilité du monde ou de protéger la finitude humaine de la raison technoscientifique.
Les trois articles suivants, à partir de situations historiques et de contextes politiques différents, illustrent de façon très documentée les problématiques liées à l’application des droits humains aujourd’hui. Le premier se situe dans un contexte postcolonial, en Nouvelle-Calédonie. Alban Bensa, après avoir rappelé que les Kanaks, premiers habitants de cet archipel du Pacifique Sud annexé par la France en 1853, ont gardé de cet événement une mémoire vive, à la fois poétique et politique, développe une réflexion sur le passage de l’injustice structurelle de la colonisation à une justice qui ne serait plus « coloniale ». Il plaide pour un examen comparatif approfondi des valeurs océaniennes dans leurs rapports avec les valeurs occidentales inspirées par la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Le deuxième concerne la Chine, où le discours officiel délégitime les droits humains d’inspiration occidentale au nom du marxisme-léninisme, du nationalisme et de la « culture chinoise traditionnelle » néoconfucianiste prônant l’« harmonie ». Jean-Philippe Béja analyse l’usage de cette critique relativiste aux fins de répression et la façon dont le mouvement de défense des droits apparu en 2003 demeure, malgré son reflux, une référence pour faire face aux abus de pouvoir des représentants du régime.
Dans un autre pays et sur un autre continent, au Nicaragua, Gilles Bataillon montre comment le langage des droits de l’homme est devenu la langue politique et l’outil efficace des activistes défenseurs des droits des communautés amérindiennes (miskitues et mayangnas). Il rappelle l’histoire de leur mouvement, qui s’enracine dans l’Église morave et s’est développé à travers de multiples organisations durant les années 1980-1990, avant de lutter désormais aux côtés des mouvements d’opposition au président Daniel Ortega.
Au cœur de cet ensemble, et parce que la question est aujourd’hui centrale, trois articles abordent les droits des personnes exilées, réfugiées et migrantes. Rappelons en préalable que parmi les droits de la Déclaration de 1948 figure celui « de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État » ainsi que celui « de quitter tout pays, y compris le sien ». Ayant largement documenté le fait que la Méditerranée est devenue aujourd’hui « le terrain liquide d’un intense conflit de mobilité qui a provoqué la mort en mer de plus de 30 000 migrants », Charles Heller, Lorenzo Pezzani et Maurice Stierl s’efforcent de donner une traduction politique à ce droit fondamental de se déplacer. Partant des nombreuses frontières étatiques et sociales dont les migrants font l’expérience au cours de leurs trajectoires, ils définissent les contours des luttes nécessaires à une politique de la liberté de mouvement.
Celles et ceux qui parviennent à rejoindre les côtes de l’Union européenne se trouvent dans des situations matérielles et légales précaires. Ils attendent dans les limbes des procédures d’asile, souvent sans abri ni protection. Dans ces conditions, le droit à être soigné est capital. Caroline Izambert analyse ici les ambiguïtés de l’accès aux soins pour les étrangers en situation irrégulière en France où, depuis 2000, leur prise en charge est assurée par une prestation d’aide sociale, l’aide médicale de l’État (AME), distincte de l’Assurance maladie. Elle retrace la genèse de l’AME, qui relève moins d’un droit inconditionnel à la santé que d’une conception traditionnelle de l’assistance, et, à partir d’une enquête menée dans un hôpital, révèle les effets concrets des catégories de l’administration concernant l’immigration dans le système de soins.
Enfin, dans les camps de réfugiés, la communication entre ces derniers et les opérateurs de l’aide entraîne des conséquences aussi peu connues qu’ambiguës, entre protection et mise en danger. Dans le camp de Zaatari en Jordanie, Léa Macias a ainsi étudié l’impact des nouvelles technologies dans la gestion des actions et la production de savoirs humanitaires. Elle décrit la façon dont les innombrables informations collectées auprès des réfugiés, qui vont jusqu’aux données biométriques, renforcent un contrôle des corps et des esprits, sous couvert d’ouverture et d’efficacité.
Si la question cruciale du traitement des migrants renvoie le plus souvent au non-respect des droits existants, il convient aussi d’explorer les extensions possibles du périmètre des droits humains et leur redéfinition juridique. Trois exemples sont traités, sachant qu’il y en aurait évidemment beaucoup d’autres.
Le premier concerne les interactions entre les objectifs de développement durable et les droits humains. Apparus à des époques et dans des sphères juridiques et politiques différentes, ils ont cheminé en s’ignorant, constate Béatrice Delzangles, alors qu’ils ont un axiome philosophique proche – l’humanité – et partagent un but commun – assurer sa protection. C’est seulement en 2015 que les objectifs de développement durable adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies les ont rapprochés, non sans difficulté. Reste à préciser comment ils peuvent se combiner face aux défis du xxie siècle.
L’article suivant porte sur la lutte pour la reconnaissance et le respect des droits des personnes intersexuées, sous la forme d’une entrevue entre deux universitaires spécialistes de sociologie juridique et engagés, Anne Saris et Benjamin Moron-Puech. Le problème majeur des personnes intersexuées est la violation de leur intégrité personnelle. Actes chirurgicaux et traitements médicaux leur sont en effet imposés alors qu’elles sont mineures afin de normaliser leur corps. Les auteurs expliquent les préjudices subis, mais aussi les obstacles politiques et juridiques rencontrés pour les faire reconnaître comme tels.
À partir des années 1970, avec l’apparition puis le développement des technologies numériques, la protection de la vie privée, qui s’est développée au cours du xxe siècle, a rejoint celle des données à caractère personnel. Analysant cette évolution, Marie Ranquet montre qu’elle débouche sur une revendication nouvelle : celle du droit à l’oubli. Ce dernier, affirmé comme défense de l’individu face à des pratiques numériques intrusives, vient parfois heurter la liberté d’expression ou la liberté d’écrire l’histoire.
La dernière partie de cet ensemble traite, sous divers angles, des effets et des limites de la pénalisation des atteintes aux droits humains. Effets de visibilisation d’abord, comme dans le cas des viols en temps de paix et en temps de guerre. De plus en plus judiciarisés depuis une trentaine d’années, ils ne semblent pas diminuer, constate Véronique Nahoum-Grappe. Elle propose une analyse des mécanismes socioculturels qui sous-tendent ces pratiques criminelles, notamment une esthétique de la violence sexuelle dans les images contemporaines qui permet un glissement du « faire l’amour » au « faire la haine ».
De son côté, Joël Hubrecht examine les difficultés de la justice pénale internationale : l’utopie originelle de la Paix par le droit est mise à mal, la Cour pénale internationale, affaiblie par les oppositions externes et les tensions internes, est marginalisée, en particulier dans la lutte contre le terrorisme international. Dans ce contexte de régression, et face à la multiplication des crimes, il défend les principes de justice qui la fondent (sanction, prévention, réparation), et l’invite à une nécessaire réinvention.
« Recourir à l’outil pénal pour garantir les droits de l’homme, n’est-ce pas paradoxal ? » se demande pour finir Danièle Lochak, alors que cet outil, dans sa double fonction répressive et dissuasive, est de plus en plus utilisé, tant au niveau des législations nationales qu’au niveau international. Cette utilisation croissante témoigne d’une sensibilité évolutive et différentielle aux droits fondamentaux. Elle mérite néanmoins d’être interrogée à la fois sur son efficacité, ses limites et ses effets de surface rassurants, au détriment de l’action préventive.
Toutes ces contributions témoignent ainsi, dans différents registres, d’une réflexion en mouvement sur les droits humains, toujours incomplets, toujours à négocier, à défendre, à étendre à de nouvelles questions. Loin d’être un ensemble de principes immuables et exportables au nom d’un universel abstrait, ils dessinent un horizon d’universalisation en répondant à un rêve de justice dont on peut penser qu’il traverse l’humanité.
Nicole Lapierre et Véronique Nahoum-Grappe



