Il y a un projet dans l’école. Ca fait pester parfois les projets parce que c’est du temps de donné en plus du travail. Par « donné », entendez qu’il n’y a pas de contrepartie financière et la rétribution fonctionne plutôt à la gratitude des élèves et de l’équipe éducative. L’idée est de faire une installation sur le thème de la migration, plus particulièrement sur la question des réfugiés et des péripéties qu’ils rencontrent depuis l’endroit où ils sont nés jusqu’à celui où ils se retrouvent.
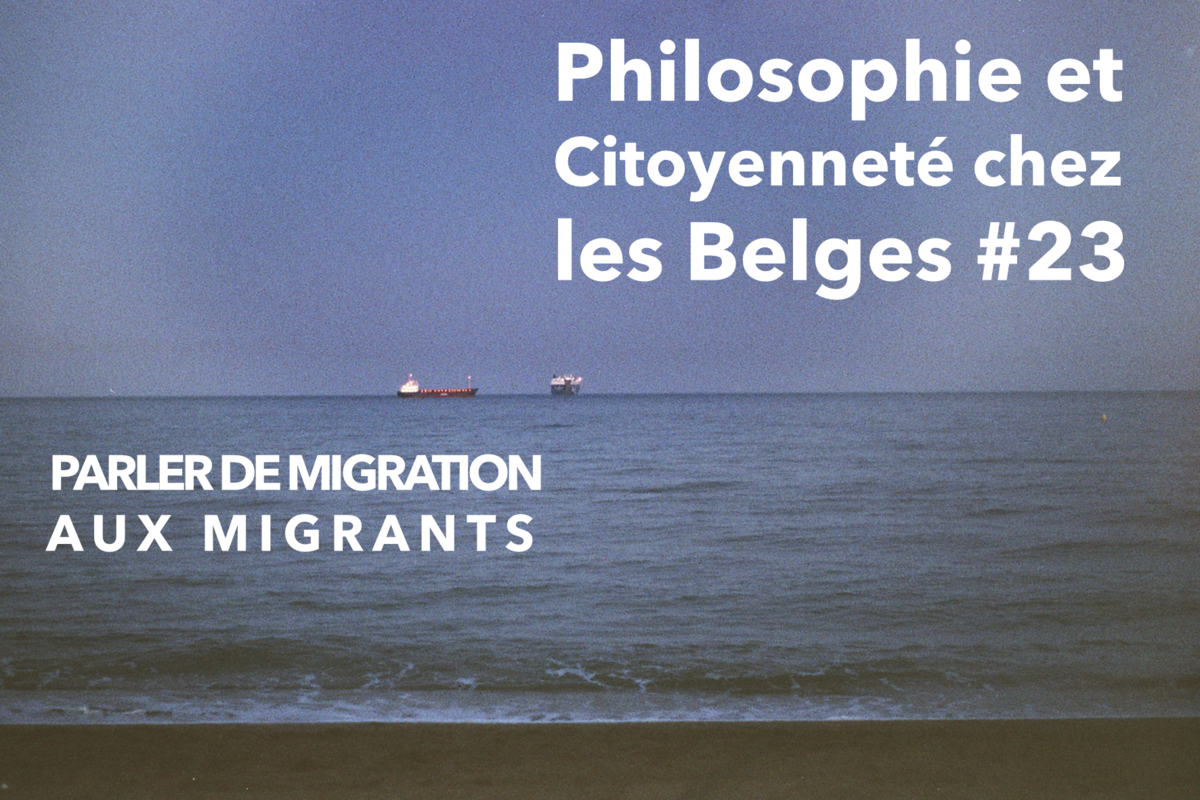
Agrandissement : Illustration 1
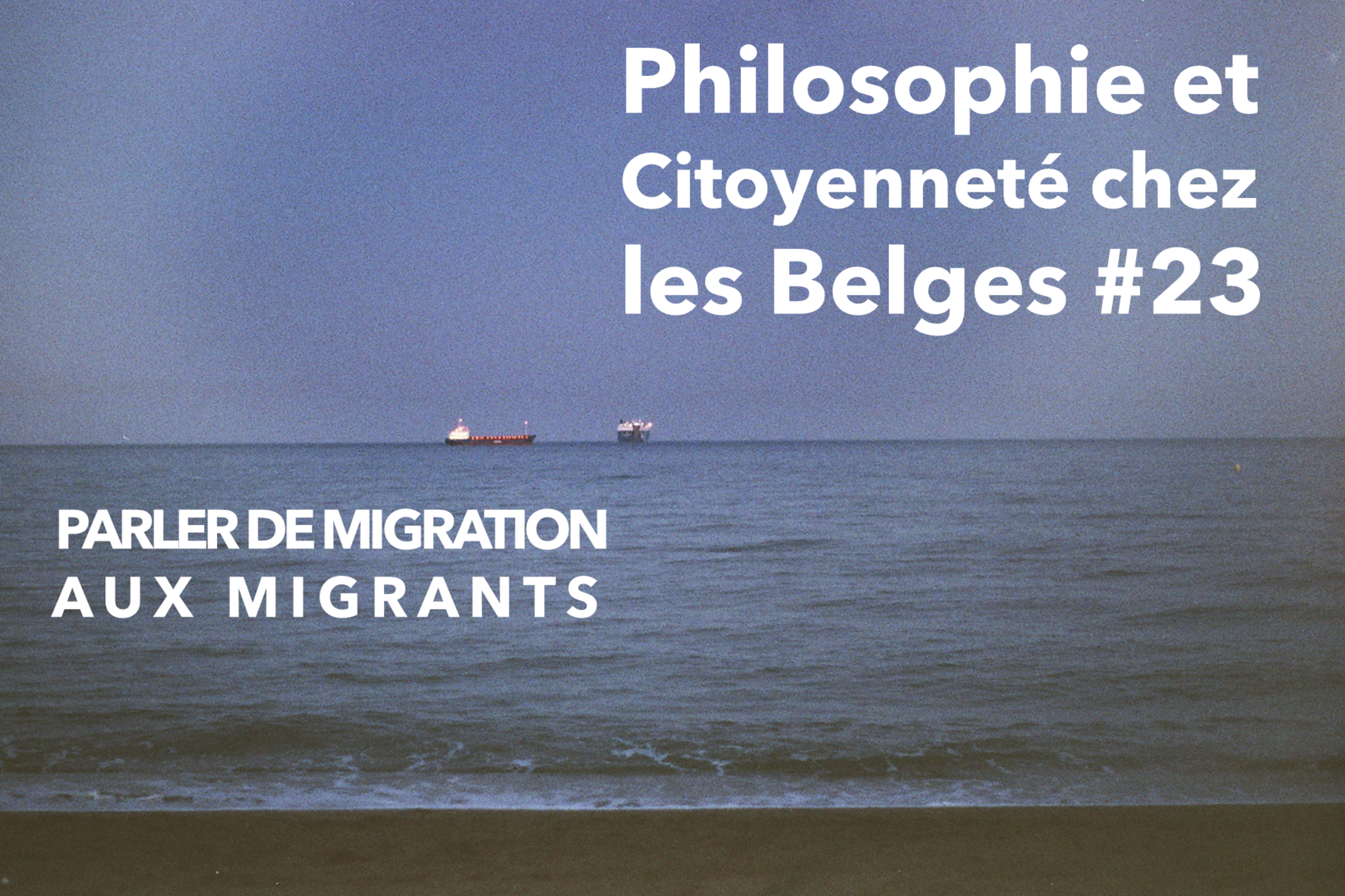
Du côté des professeurs, on fait donc tout un tas de choses. Des installations pour montrer le foyer initial, celui où tout semble bien aller. Dans l’idée, des sons menaçants viendraient casser la quiétée du lieu. D’une première salle représentant donc la maison originelle, on passerait à l’étape de la migration. De là, on parlerait de toutes les raisons qui poussent à la migration : de la nécessité économique aux vicissitudes discriminatoires et autres saloperies qui empêchent toute existence sereine. On finirait par le lieu d’arrivée qui n’en est pas un, dans l’idée que la pénibilité du premier voyage se prolongerait insidieusement une fois arrivé dans le pays d’accueil à travers la difficulté de vivre.
Le but du projet, c’est en tout cas ce que j’en ai saisi, est de sensibiliser au vécu de certains de nos élèves et de l’ensemble des migrants par extension – que ce soient d’ailleurs les élèves primo-arrivants ou ceux des deuxième, troisième et x-ième générations. Et donc, il faut la préparer cette exposition. On est occupés à faire un glossaire de tous les termes qui sont importants à saisir dans les processus migratoires. Pour vous donner un exemple, un élève qui voyait le glossaire projeté au tableau me demandait ce que c’était que l’excision et quel était le rapport avec les questions migratoires.
Je suis moi-même un immigré en Belgique. C’est comme ça que je commence l’histoire. Je leur explique ma situation, la vie à Paris et Marie qui est prise à l’INSAS pour y faire des études de théâtre. Moi qui leur dis que donc je suis ma compagne. Et de leur demander si j’ai eu le choix, si j’avais pu faire autrement et comment ils imaginent que ma vie était avant, en France. Sur l’ensemble, ils comprennent. Tout allait bien, c’est ce qu’on pourrait appeler une migration de confort. A tout moment je peux revenir dans mon pays, je n’ai rien fui qui aurait une incidence dommageable sur mes intégrités physique et mentale.
Et c’est là que ça devient un brin complexe. Je suis avec mes classes de primo-arrivants quand je fais ça et leur poser la question du motif de leur départ c’est les exposer à se plonger dans des souvenirs fort désagréables. Comme l’an dernier, quand j’avais demandé à ces mêmes classes, après avoir lu un extrait des Lettres persanes, de raconter leur pays d’origine ou la Belgique en utilisant leur point de vue d’étranger. De raconter ce qui est bizarre par exemple. Ce qui leur manque aussi. J’avais eu un élève en mode page blanche et je l’enjoignais de jouer le jeu. Du genre ça va, la consigne n’est pas si compliquée. Il n’y a rien dont tu souhaiterais faire part ? dit d’un toux doucereux. Et une absence de réponse qui témoignait que non. C’était un endroit où il ne souhaitait pas retourner, même en esprit.
Je me retrouvais dans cet espace que Geoffroy de Lagasnerie – à moins que ce ne soit Edouard Louis ou Didier Eribon ? – identifie comme douloureux. Celui dans un premier temps du traumatisme. Celui dans un second temps du conte du traumatisme. Et que témoigner dans le fond c’est revivre, et qu’on demande aux gens de raconter leur réalité pour qu’on puisse mieux la saisir, mieux s’en parer, puis en fait notre curiosité bien qu’elle soit bienveillante devient un sujet de tristesse pour l’autre. De tristesse ou pire, on ne parle pas ici d’un simple spleen de buveur d’absinthe. Et donc il faut parler, il faut les faire parler, trouver une manière cathartique de traiter cette histoire que certain.e.s portent en leur sein. Mais il faut aussi trouver le juste milieu, ne pas forcer, le tout en s’assurant qu’ils comprennent la potentielle utilité de la chose pour eux-mêmes et non pas pour le simple public que je deviens alors.
Parler de migration aux migrants. Ca me replonge dans mon mémoire d’histoire et sur le fameux nos ancêtres les Gaulois qu’on dispensait dans l’Algérie française à l’époque. Je n’ai jamais eu ce cas de figure en tant qu’élève mais je me suis imaginé alors ces professeurs qui doivent enseigner certaines guerres et autres drames sociétaux à des gens qui en sont empreints. Evoquer la guerre d’Algérie à des descendants d’Algériens par exemple. Là, on ne parle pas forcément de guerre, mais tout comme le professeur et l’Algérie, je me retrouve avec un savoir livresque et j’ai beau avoir de l’empathie à revendre ce que j’ai lu ils l’ont vécu. Parler de pourquoi on quitte son pays, d’excision, de guerre, de persécution religieuse ou autre devient alors comme tout un tas de petits œufs sur lesquels je marche doucement, alerte des réactions sur les bancs pour m’assurer que je ne vais pas trop loin.
Il y a autre chose, c’est le fameux adult gaze dont j’essaye de me défaire. Par là, je veux dire que je pars du principe que chaque élève a vécu d’horribles drames et que donc je prends mille pincettes, peureux parfois que ces pincettes ne se fassent démiurges. Par là, je veux dire que me préfigurer le drame et avoir ce timbre de voix, cette précaution envers elles et eux, j’ai peur parfois que ça leur fasse réaliser le sérieux d’une situation qu’ils n’estiment pas si grave. Comme quand quelque chose d’anodin se passe dans votre vie et que le racontant votre interlocuteur vous regarde d’un air interloqué qui signifie que la situation ne va pas du tout. Pour prendre un exemple que j’ai en tête, ce moment où quelqu’un vous raconte sa relation amoureuse et que vous prenez la mesure de sa toxicité. Et là, vous voyez que la personne ne l’a pas vue cette toxicité et peut-être que tout prend une autre intensité. Je souhaite d’un côté que les élèves se rendent bien compte qu’ils sont victimes de leur état, mais les faire se rendre compte de ce statut c’est aussi exposer ce dont ils ont été victime. On ne peut pas se contenter de dire c’est pas cool ce qui vous est arrivé, ou alors oui on peut s’en contenter mais je les imagine gamberger un peu plus que ça.
Donc, j’ai fait un premier cours avec des primo-arrivants où je leur ai demandé d’où ils venaient, éventuellement pourquoi ils avaient quitté leur pays. C’est une classe avec pas mal de difficultés en français comme vous pouvez l’imaginer donc ça n’a pas bien fonctionné. Pour le coup, j’ai un élève, alors que je passais de l’un à l’autre en lui posant mes deux questions, qui me voyait arriver et m’a fait un aller-retour horizontal de la tête pour me signifier qu’ils n’avait pas envie de répondre. Je l’ai passé.
Puis, quand même, je me suis dit qu’ils avaient parlé. Dire je viens de plutôt que en, je suis en Belgique depuis ou alors ça fait XX que je suis en Belgique… De petits exercices en cachette mais pour l’aspect citoyenneté je suis pas sûr qu’il se soit passé grand-chose. Pour la classe suivante, au niveau un brin plus élevé, j’ai préparé mon cours.
Ca nous fait une sorte d’étoile, que je leur présente sans ne rien dire, ou plutôt en leur disant d’essayer de comprendre ce que représente cette carte. Un élève me dit qu’il y a le Cameroun, fier. C’est là qu’il est né. Je leur dis que les traits ont tous un point commun, lequel ? Ils me disent que c’est la Belgique. Ok, on avance un peu. Je leur demande les pays qu’ils voient représentés. Je regarde mon élève Brésilien en lui montrant le Sud-Ouest et lui demande ce que c’est. Il reconnaît le bougre. Puis je leur dis – là c’est un peu une technique pour vous donner les pays parce que vous ne pouvez pas forcément les lire sur la carte – Cameroun, Moldavie, Ukraine, Espagne, République Démocratique du Congo, Tchernivsti, Roumanie, Algérie, France, Brésil. C’est quoi, tous ces pays ? Vous, ô lectorat, est-ce que vous avez deviné ?
Sur l’application de l’école où l’on prend les présences, remplit les bulletins et autres tâches administratives il y a le profil des élèves avec leur lieu de naissance. J’ai pris, pour cette classe, le lieu de naissance de chacun que j’ai relié à Bruxelles. On est partis de là, puis j’ai demandé à chacun. J’ai refait ma présentation, mimant avec entrain ce que je disais. Je clos en disant « moi, la raison de mon départ au final c’est l’amour » et j’ai la main sur le cœur. Et je suis presque content parce que je découvre qu’il y a des histoires légères. Une maman qui a rencontré l’amour via un expatrié revenu au pays natal et ils ont décidé de déménager ensemble ici. Une maman qui a quitté son pays en suivant un ami installé ici, qui a travaillé et mis de côté pour après quelque temps payer l’avion à son fils. C’est tout. Un autre qui a déménagé d’abord dans son pays pour monter à la capitale où il n’y avait pas plus de travail qu’ailleurs, ce qui l’a finalement poussé à venir ici. D’autres qui ne savent pas dire ce qui a motivé leur départ et ils viennent d’un pays en guerre. Je leur demande alors : s’il n’y avait pas eu la guerre, auriez-vous changé de pays ? Pareil, ils font tous l’aller-retour. Je leur dis donc, je projette, que c’est la guerre qui a motivé leur départ. Un autre me raconte que sa sœur avait des problèmes de santé et qu’ils sont venus pour faire une opération. Un autre enfin me raconte qu’il ne pouvait pas pratiquer sa religion. Il m’intrigue mais je ne lui en demande pas plus. Il se lance un peu et je le stoppe en imitant mon ami Raph : que ce soit bien clair les amis, moi je vous pose des questions tout ça mais si vous n’avez pas envie de répondre il n’y a aucun problème. Je ne veux pas être intrusif ou quoi, donc pas de problème si vous gardez vos histoires pour vous.
Il prend le sujet à cœur, dit qu’il n’y a pas de problème et se lève tout de même parce qu’il voit un trait entre son pays et ici et il a envie de rectifier. Il me demande de zoomer puis il m’indique du doigt les pays traversés. Le trait se transforme en zigzag avec des allers-retours, une case prison, de la voiture, un bateau de fortune que je vois sur son téléphone, voguant a priori sur la Méditerranée. Sur la vidéo on ne l’entend pas mais il chante, pas d’un chant du fond des âges qui s’apparenterait au blues d’ancêtres qu’il n’a pas eus. Un chant violent, un cri presque. Il me montre ça, j’ai envie de rentrer dans son histoire mais le cours continue et les autres partagent la leur.
L’heure sonne, c’est le moment où je vais fumer une clope et déverser un peu de café dans mon thermos. J’attends toujours une petite minute pour descendre parce que les élève bien évidemment occupent l’entièreté du couloir et des marches. Il est là. Les autres sortent tranquillement, lui est resté. C’est ce signe des élèves qui veulent parler un peu. Ils ne viennent pas toujours frontalement. Et là, il y va. Il a une autre religion que celle de ses parents. Rien de problématique au début. Tout de même, une famille nombreuse qui avoisine la dizaine de personnes. Pas de problèmes de mœurs, plutôt d’un point de vue économique donc. Puis son père se met à marabouter il me dit. Il me parle de bougies au sol. Je l’écoute. Je ne suis pas forcément le fil des événements et la logique qui les imbrique mais je l’écoute, gardant tout dans ma tête. Son père finit par dire qu’il a compris que son fils amène au foyer un mauvais esprit. Il faut le chasser. Puis il me dit qu’il a un rendez-vous en juin pour ses papiers et qu’il doit préparer son entretien et notamment prendre des photos des sévices qu’il a reçues et il me montre des cicatrices de coups de couteau.
Je me rends compte qu’il y a un travers qui pourrait paraître un peu dégueulasse d’exposer ainsi – dans l’anonymat ne l’oublions pas – l’histoire révélée par un élève confiant. Un peu à l’image de Raymond Depardon pris en photo entrain de prendre en photo un enfant souffrant de la famine. Montrer. Qu’est-ce qu’on montre ? Pourquoi on le montre ? Qu’est-on quand on montre ? Aucune volonté de sensationnalisme, aucun gain par rapport à ce que je vous écris. Juste exposer la pluralité et se dire que derrière l’acronyme DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) il y a des personnes qui ont vécu l’histoire de livres qu’on ne voudrait que fictifs, d’autres dont les parents vivent une histoire d’amour internationale.
Ecrivez-moi à nils.savoye@gmail.com si vous souhaitez être inscrit.e directement dans ma liste de diffusion.



