J'ai vécu 1983 dans la peau d'un adolescent de 15 ans, davantage marqué par la mort de Louis de Funès que par le « tournant de la rigueur » qui n'était que des mots, apparemment sans conséquence directe sur mon quotidien. La vérité répandue dans toutes les discussions d'adultes dont je pouvais être le témoin, c'était que les socialistes avaient vidé les caisses de l'Etat. On avait essayé le socialisme mais ça ne marchait pas, ça ne pouvait pas marcher. On avait payé pour voir, avec l'aide maléfique de Chirac qui jouait sa carte personnelle pour le coup d'après.
Je me souviens de l'effroi qui avait saisi mes parents lorsque le visage pixelisé de Mitterrand était apparu sur l'écran de télévision, le soir du second tour de l'élection présidentielle, le 10 mai 1981. Des communistes entreraient dans le gouvernement, l'URSS aurait un pied dans le pays, les rouges menaçaient notre avenir… Une fois le calme revenu, mon père se contentait de placer régulièrement dans les conversations que la gauche creusait le déficit, sans mesurer lui-même précisément ce que cela signifiait pour les comptes publics. En bon père de famille, il savait juste que « lorsqu'on a deux sous, on n'en dépense pas quatre ».
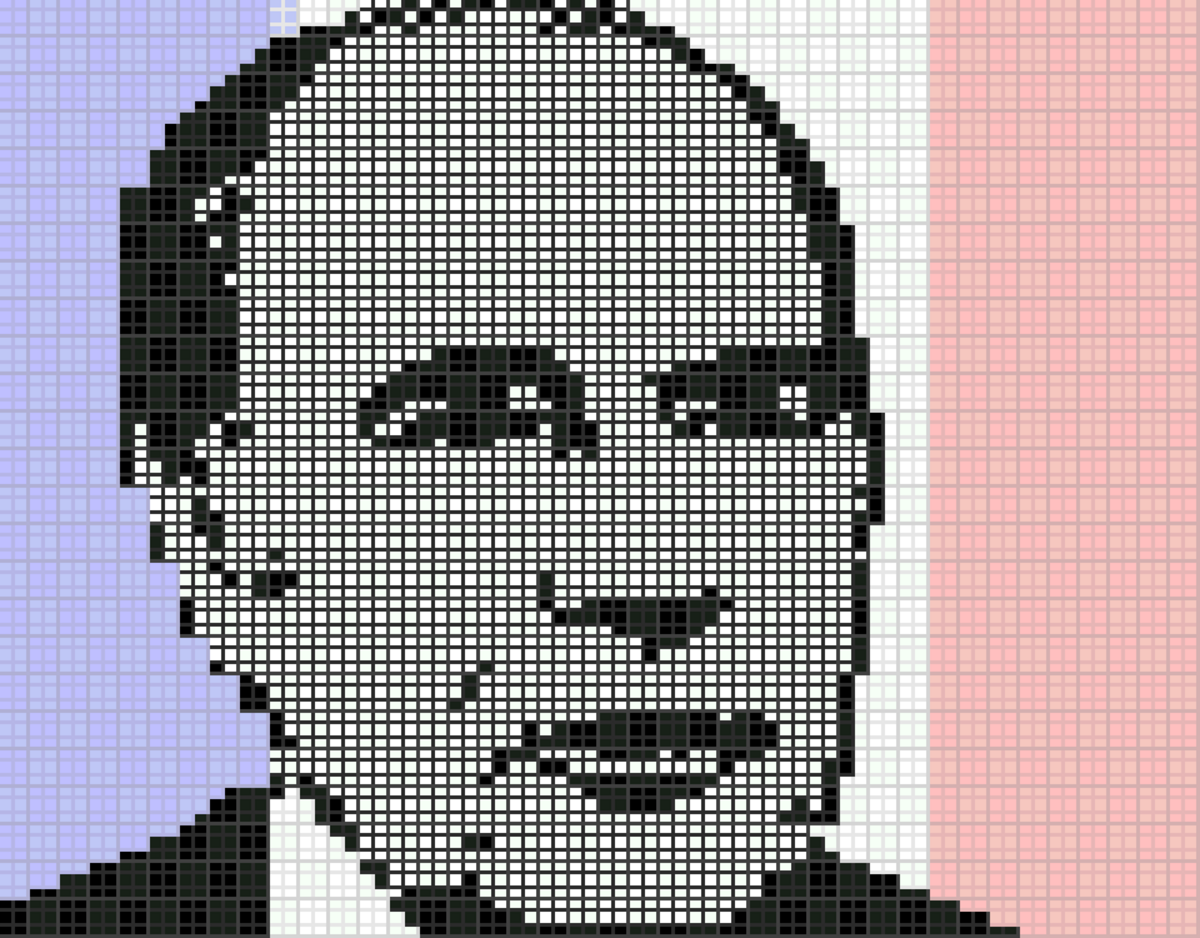
Agrandissement : Illustration 1
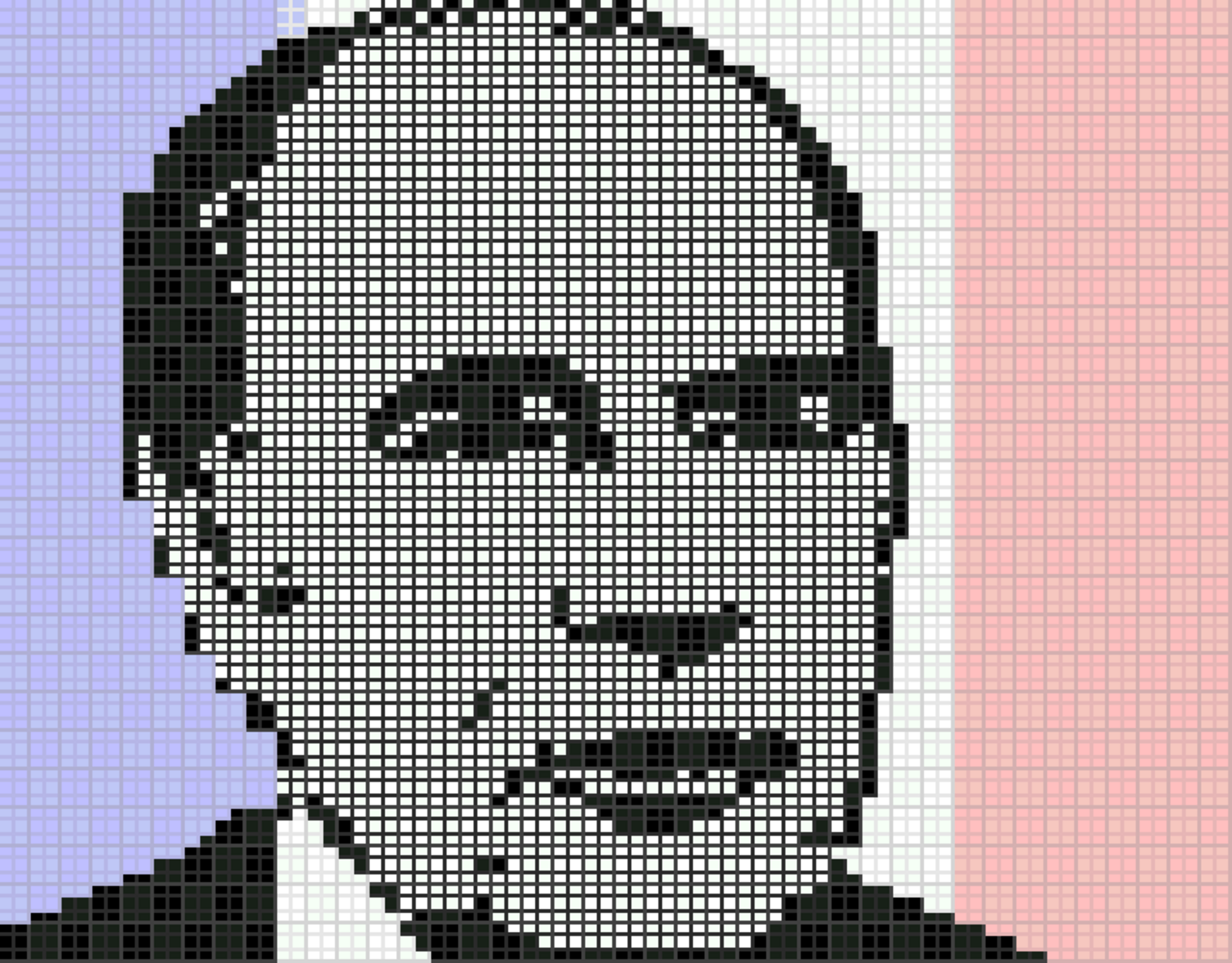
Mon père ne faisait que répéter ce qu'il entendait. Ce n'était pas un meneur. Il avait « la foi du charbonnier », comme il le confiait lui-même. Cela le guidait dans la plupart des gestes de sa vie qui étaient aussi inspirés par le bon sens paysan de la moyenne montagne. Il avait donc voté Giscard, après la messe qui était encore célébrée dans la petite église du village. Dans ce coin perdu du Dauphiné, la droite enregistrait de bons scores. Je comprendrais quelques années plus tard, dans les cours de sociologie électorale donnés par Pascal Perrineau à Sciences-Po Grenoble, pourquoi mes parents qui appartenaient à la classe populaire ne glissaient pas des bulletins de gauche dans l'urne. Les catholiques pratiquants ne pouvaient accorder leur confiance à des candidats considérés globalement, et abusivement, comme des « bouffeurs de curés ». Le prisme religieux l'emportait sur le niveau social.
Mère au foyer, après une courte carrière d'aide-soignante terminée à Voiron dès la naissance de son premier enfant, celle qui m'a donné la vie partageait les mêmes opinions politiques que mon père, « cantonnier » en poste isolé qui travaillait pour les « Ponts et chaussées ». J'ai ainsi été élevé dans la méfiance, voire la haine ou le dégoût, à l'égard de la gauche alors incarnée par les « socialo-communistes ».
Finalement, le coup le plus rude porté à ces préjugés de « classe religieuse » viendrait de ma foi de plus en plus vacillante au fil du temps. Dès que je le pus, je me permis de ne plus aller à la messe qui m'ennuyait profondément. A l'âge de 20 ans, pourtant, je votai Chirac. Mais c'était plus par provocation que par conviction. Je ne supportais pas les « mitterrandolâtres », ces bobos de la « gauche caviar » qui appelaient Mitterrand à briguer un second mandat, derrière la bannière du chanteur Renaud : « Tonton, laisse pas béton ! » Cette bourgeoisie de gauche me révulsait déjà. Elle incarnait cette social-démocratie mollement sociale, mollement démocrate mais vraiment libérale qui, vingt-cinq ans après, enfanterait Macron.
Depuis longtemps, j'ai pris mes distances avec les explications simplistes sur le « désastre » du socialisme ayant conduit le gouvernement Mauroy à faire machine arrière. Le terme de « rigueur » employé à l'époque me faisait un peu peur, il avait une connotation désagréable. Il devait vraiment être martelé car il est resté gravé dans ma mémoire. Comment est-on passé en quelques mois de l'Espoir à la Rigueur ?
Consentir à la rigueur : quand même, quelle humiliation ce fut ! Quelle déflagration, certainement, dans l'esprit et le cœur des électeurs de gauche ! Moins de deux ans après la Victoire, la Rose faisant son entrée au Panthéon, déposée sur les tombes de Jean Jaurès, Victor Schoelcher et Jean Moulin… Quel terrible moment pour la gauche au pouvoir vivant ses derniers instants, son glas sonné par la social-démocratie. Tels des héritiers se précipitant sur son cadavre, les sociaux-démocrates sifflaient la fin des illusions et le début de la grande mascarade. A ce jour, le bal masqué n'est pas encore terminé, même si les masques tombent à un rythme élevé depuis novembre 2018 et le mouvement des Gilets jaunes.
M.V.
Suite : https://blogs.mediapart.fr/objection/blog/240523/mon-parcours-sup-lepoque-de-malik-oussekine-23



