
Agrandissement : Illustration 1

Ce qui est d’abord beau et frappant dans ce film, c’est qu’il nous place littéralement dans une maison-belvédère accrochée à flanc de montagne dans la vallée de Qadisha, au nord du Liban. Il nous y place et nous y fait attendre quelque chose qui doit arriver dans l’espace commun qu’il ouvre entre la salle où nous sommes assis et la vallée où les images et les sons ont été enregistrés. L’image d’Abbas Fahdel est relation (contact et transitivité) plus que représentation. Elle nous invite à observer, à travers le film, la vie organique et végétative d’une nature somptueuse et les mouvements des corps vivants qui l’habitent. Il nous fait aussi entendre, sur une bande son très riche, les bêlements, caquetages, hennissements et paroles que lancent ces corps vivants. C’est du cœur de cette observation éthologique soigneusement enregistrée que naît une histoire, fine et simple, d’amour et d’exil.
Yara est une jeune et belle orpheline, elle vit avec sa grand-mère dans une maison rurale au cœur d’une vallée magnifique mais abandonnée. Elle semble y être enfermée ou préservée. On ne sait pas trop. Elle rencontre Elias, un beau jeune homme qui passe là par hasard. Ils se revoient. Ils explorent la vallée et partagent leurs souvenirs. Ils s’aiment. Il doit partir loin, en exil. Elle doit rester, mais son amour l’a libérée de quelque chose.

Agrandissement : Illustration 2

Cette trame suit l’avènement d’une désillusion amoureuse suivie d’une émancipation plus profonde, qu’on devine au-delà du film, discrètement évoquée par un mouvement de caméra portée (ils sont très rares dans le film) qui suit Yara sortant d’un enclos à la suite des chèvres. Rompant avec les plans fixes et les panoramiques qui ancrent la source du regard dans le lieu, ce mouvement aérien et fragile, ce mouvement de départ de l’enclos, nous emmène vers un ailleurs encore incertain mais tangible. Parce qu’un (a)franchissement a eu lieu.
Ce récit discret qui refuse d’être le seul prétexte au film, rappelle beaucoup les trajectoires émancipatrices de certains personnages de Robert Bresson, celle du pickpocket par exemple, et détourne aussi, celles, plus sacrificielles, de Mouchette ou Balthazar. Le fameux « sauve-moi ! » a trouvé son oreille. Le cinéaste français dont Abbas Fahdel prolonge ici la recherche éthique et esthétique, partage avec lui le goût de la simplicité, du laconisme et de l’enregistrement audiovisuel du monde, au fondement de l’Art cinématographique.
C’est ce qu’il exprime d’ailleurs dans cette remarque qu’il a partagé sur Facebook :
« Pour moi, la différence entre Robert Bresson et les cinéastes américains, c’est que Bresson c’est comme marcher dans les bois à pied. On marche, on voit une fleur, on s’arrête pour en sentir le parfum ; on entend chanter un oiseau, on s’arrête pour l’écouter. Le cinéma américain c’est comme si on traversait la forêt en 4X4 ; on ne s’arrête pas, on n’entend pas le chant des oiseaux, on ne sent pas l’odeur des fleurs, on roule vite en sursautant sur la route et à la fin on est complètement abruti. »
Le film d’Abbas Fahdel nous offre la possibilité d’un éveil sensoriel et d’une mise en relation. Je vais essayer de faire la liste des éléments sur lesquels repose cette impression intense de présence et de liberté.
La liberté
Chez Abbas Fahdel, depuis l’expérience très forte de Homeland, Irak année zéro, le film ne peut être séparé de ses conditions de production. C’est un objet éthique autant qu’esthétique, il a un prix qui se mesure moins en argent qu’en temps, en intention, en attention et en liberté. Pour que cette éthique comme son esthétique soient préservées de toute complaisance commerciale et de toute autorité financière, il faut renoncer à un certain confort matériel pour trouver une liberté de choix qui rapproche le travail du cinéaste de celui du peintre. Travaillant avec une équipe extrêmement réduite et en collaboration avec sa compagne, prenant des modèles non professionnels, sur place pour la plupart, Abbas Fahdel s’autoproduit, écrit, filme et monte ses films de manière autonome.
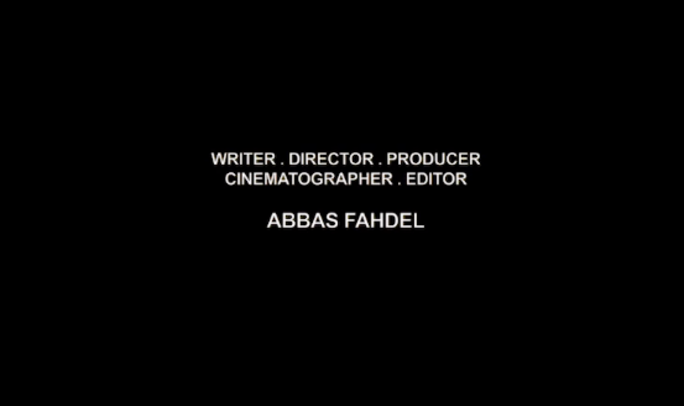
Ainsi Yara est ancré dans la réalité de sa production de manière directe, à travers des choix qu’on ne peut prêter qu’au cinéaste, et qui se présentent avant tout comme des choix. Chaque plan est le fruit d’un choix triplement assumé par l’auteur ; à l’écriture, au tournage et au montage, et nous rappelle par son affirmation même que le propre de l’Art cinématographique, en tant qu’art photographique, est d’être un art du choix. On ne compose pas, comme en peinture, on coupe, on taille, on saisit, on glane : puis on choisit.
De la même manière, le choix du lieu de tournage qui va donner sa matière au film, le choix des modèles rencontrés sur place ou empruntés à la réalité, le choix des cadres posés comme les collets du braconnier de Mouchette, mais pour attraper des épiphanies (présences) plus que des lapins, le choix aussi des durées et des espaces, sont tous imputables à une forme d’écriture filmique à la fois personnelle et professionnelle, abolissant les frontières entre les degrés d’officialité imposés par l’argent et les catégories commerciales. La petite entreprise de cinéma d’Abbas Fahdel, épaulée par internet et les réseaux sociaux, où fleurissent des pensées, des photographies et des plans, s’invente un territoire artistique libéré des tutelles. Et il semble que ça marche.
Le lieu
Le film est un moyen d’entrer en relation avec le lieu du tournage. Ici la vallée magnifique de Qadisha, classée au patrimoine de l’UNESCO. Par une suite de plans fixes sur des animaux domestiques n’ayant d’autre fonction que d’être présents, par la saisie précise des sons naturels, par la durée des plans qui permettent au spectateur de sentir le parfum des fleurs, de passer ses mains sous l’eau, d’en boire, de caresser les chèvres, de croquer dans un fruit, par des effets de construction répétés qui cherchent le beau point de vue, la belle lumière, bref, le plaisir scopique, puisque la maison où vit Yara est un belvédère, par cette médiatisation d’un objet regard qui devient par son exercice même un personnage à part entière, le cinéma d’Abbas Fahdel nous introduit, par conduction subjective, dans le lieu. C’était déjà le cas dans Homeland, dont l’invitation à partager les repas des protagonistes était irrésistible, c’est aussi le cas dans Yara. La distinction entre fiction et documentaire n’a pas d’intérêt dès lors que le film propose de faire advenir une co-présence décalée entre le lieu et le spectateur. Et quand le film est le fruit d’une attention au monde et ne se prend pas pour un boxeur ou une stripteaseuse, le décalage entre le temps du tournage et celui de la réception devient anecdotique. Non pas parce que le corps sursaute comme dans un 4X4, mais parce que les autres sensations éclosent aussi autour de la vue et de l’ouïe, dans le calme enveloppant le corps de l’intérieur sans le stimuler nerveusement.
Les êtres filmés
Animaux et hommes, sont égaux et vus essentiellement dans leurs mouvements ; dans une approche presque éthologique, qui préserve le mystère d’intentions dont seul le geste peut témoigner, fournissant une matière proprement cinémato-graphique. Pas d’émotion feinte, pas de geste inutile, pas d’effet de manche, mais une attention à l’événement inattendu. La grand-mère est aux aguets, de sa terrasse magnifique qui surplombe la vallée, elle est souvent vue de biais, elle passe ses journées à regarder au loin, Pénélope fatiguée qui guette le retour d’un Ulysse qui ne reviendra pas. Yara elle-même, sur la terrasse, face à Elias, semble guetter ce qui va se passer, mais dans le film, elle est tout ouïe, tout regard, à la fois amoureuse et spectatrice, dans le temps du tournage ou dans celui de l’histoire, peu importe.
L’histoire
… Justement, simple trame voire prétexte, elle appartient au spectateur plus qu’aux personnages ; histoire de l’exil vu du lieu abandonné, histoire de l’amour vu de l’être laissé, histoire de la mémoire vue de ce qui reste accroché aux murs, histoire du Liban vu d’une vallée perdue… Abbas Fahdel prend le parti des choses, des animaux, des éléments ; tout compte, tout est cinématographique. Le film s’apparente vite à la maison, il est construit par des lignes, des plans, il devient la maison, celle qu’on habite et qu’on va finir par quitter du regard… en y laissant Yara.
Le regard
Son enregistrement est le principe et la matière même de l’écriture cinématographique, qu’on ne peut jamais totalement classer en documentaire ni en fiction, palpitation entre les deux visées selon ce que le regard cherche… des indices, des images, des signes ?
Robert Bresson
Marguerite Duras disait de lui : « J’ai l’impression qu’il travaille avec un matériau dont il a le secret sur une pellicule qui n’est pas faite là où sont faites les pellicules, c’est autre chose, l’impression du film ne se fait pas au même endroit que les autres. (…) C’est un produit nouveau. » (« Au-delà des pages », TF1, 1988)
C’est peut-être ce qu’il appelait le cinématographe, « façon neuve d’écrire, donc de sentir » (In Notes sur le cinématographe) par opposition à son versant industriel qu’il appelait le cinéma. Dans Yara, Abbas Fahdel cherche et trouve cette matière et l’atteint lorsque qu’il fait surgir une présence par la sollicitation des sens agencés autour du regard et de l’ouïe, à part égale… et en créant un climat d’attente ; on ne produit pas le film on l’attend et on l’attrape…

Agrandissement : Illustration 4

Bresson est certes présent comme référence, dans le premier plan sur un âne (qu’Abbas Fahdel avait d’ailleurs baptisé Balthazar), bien sûr, et le fusil fait penser à celui du sombre Monsieur Arsène de Mouchette, tout comme les plans fixes qui quadrillent la nature ou l’épure du récit, le jeu sobre des modèles, les images pieuses, la vétusté des maisons … Mais c’est sans doute dans cette attente de l’épiphanie de la présence qu’il est le plus présent et ouvre la voie à un cinéma sensualiste et relationnel, à la fois littéral et potentiellement allégorique. C’est cette transfiguration du réel, par une écriture strictement cinématographique, objectivant le regard du spectateur, qui le libère en lui faisant prendre conscience de lui-même et de son propre travail.
« Tournage. S’en tenir uniquement à des impressions, à des sensations. Pas d’intervention de l’intelligence étrangère à ces impressions et sensations. » écrit Bresson dans ses Notes sur le cinématographe.
En suivant ce principe, Abbas Fahdel nous ouvre les portes d’une vallée perdue où naissent les amours, des désillusions et des prises de conscience comme le montre sa remarque qui nous montre comment le film s'inscrit dans la vie même pour la conserver, juste avant la perte : « Le guide de montagne, qui joue son propre rôle dans le film, m’a appris récemment que l’âne est mort, mordu par un serpent, tout comme le chien Lassie, mort empoisonné. Mary Alkady, la vieille paysanne qui interprète le rôle de la grand-mère de Yara a elle aussi quitté la ferme et la vallée, sa santé ne lui permettant plus de supporter la solitude et les dures conditions de vie dans sa ferme isolée. Ainsi, avec le départ de Mary Alkady, qui était la dernière habitante de la vallée et la gardienne de sa mémoire, la vallée n’est plus habitée. »



