Ouais, en complément de «Entropie systémique», ce qui est paradoxal puisqu'il s'agit d'un billet toujours en cours de rédaction. D'après le gestionnaire du “Club de Mediapart”, sa rédaction a commencé le 5 décembre 2020. Donc, le “covid-19” comme “pandémie politique”. Qu'est-ce à dire? Deux choses: cette pandémie a une “cause politique” et elle a un “traitement politique”. La première chose est exacte, la seconde ne l'est pas, ou alors le mot “politique” a changé de sens. Ce qui est le cas, cela dit, mais c'est provisoire.
Ce qui fonde le politique est, comme le releva Aristote il y a un bout de temps, le législatif et le judiciaire. Il ne l'exprima pas ainsi, avec ces termes, mais l'esprit y est. Selon lui, et j'en suis d'accord, le fondement de toute société est la capacité de légiférer et de faire le contrôle de la bonne application de cette législation, ce qui correspond au travail du législateur et du juge. Pour lui l'exécutif n'est pas politique, il est l'instrument du politique, qui lui commande comment agir et vérifie son action. Pour lui encore la corruption d'une société vient toujours de ce que ce qui le constitue, le gouvernement, perd de vue l'intérêt général pour ne considérer que les intérêts particuliers, et je suis là aussi dans le même esprit. De ce fait, quand dans une société l'exécutif prend le pas sur le législatif et le judiciaire celle-ci est corrompue. Tiens ben, je m'en vais vous citer ledit Aristote dans Le Politique, Livre III, Chapitre V:
«§ 4. Les déviations de ces gouvernements sont: la tyrannie, pour la royauté; l'oligarchie, pour l'aristocratie; la démagogie, pour la république. La tyrannie est une^monarchie qui n'a pour objet que l'intérêt personnel du monarque; l'oligarchie n'a pour objet que l'intérêt particulier des riches; la démagogie, celui des pauvres. Aucun de ces gouvernements ne songe à l'intérêt général. Il faut nous arrêter quelques instants à bien noter la différence de chacun de ces trois gouvernements, car la question offre des difficultés. Quand on observe les -choses philosophiquement,, et qu'on ne veut pas se borner seulement au fait pratique, on doit, quelque méthode d'ailleurs qu'on adopte, n'omettre aucun détail, et n'en négliger aucun, mais les montrer tous dans leur vrai jour.
§ 5. La tyrannie, comme je viens de le dire, est le gouvernement d'un seul, régnant en maître sur l'association politique; l'oligarchie est la prédominance politique des riches; et la démagogie, au contraire, la prédominance des pauvres, à l'exclusion des riches. On fait une première objection contre cette définition même. Si la majorité maîtresse de l'État est composée de riches, et que le gouvernement de la majorité soit appelé la démocratie; et réciproquement, si, par hasard, les pauvres, en minorité relativement aux riches, sont cependant, par la supériorité de leurs forces, maîtres de l'État; et si le gouvernement de la minorité doit être appelé l'oligarchie, les définitions que nous venons de donner deviennent inexactes.
§ 6. On ne résout même pas cette difficulté en réunissant les idées de richesse et de minorité, celles de misère et de majorité, et en réservant le nom d'oligarchie pour le gouvernement où les riches, en minorité, occupent les emplois, et celui de démagogie, pour l'État où les pauvres, en majorité, sont les maîtres. Car comment classer les deux formes de constitution que nous venons de supposer: l'une où les riches forment la majorité, l'autre où les pauvres forment la minorité, souverains les uns et les autres de l'État? Si toutefois quelques autres formes politiques n'ont point échappé à notre énumération.
§ 7. Mais la raison nous dit assez que la domination de la minorité et celle de la majorité sont choses tout accidentelles, celle-ci dans les oligarchies, celle-là dans les démocraties, parce que les riches forment partout la minorité, comme les pauvres forment partout la majorité. Ainsi, les différences indiquées plus haut ne sont pas de véritables difficultés. Ce qui distingue essentiellement la démocratie et l'oligarchie, c'est la pauvreté et la richesse; et partout où le pouvoir est aux riches, majorité ou minorité, c'est une oligarchie; partout où il est aux pauvres, c'est une démagogie. Mais il n'en est pas moins vrai, je le répète, que généralement les riches sont en minorité, les pauvres en majorité. La richesse n'est qu'à quelques-uns, mais la liberté est à tous. Ce sont-là, du reste, les causes des dissensions politiques entre les riches et les pauvres».
Malgré sa première considération, «les riches forment partout la minorité, comme les pauvres forment partout la majorité», Aristote n'exclut pas le cas inverse, «partout où le pouvoir est aux riches, majorité ou minorité, c'est une oligarchie; partout où il est aux pauvres, c'est une démagogie», donc il peut y avoir des cas où “les riches” forment la majorité, “les pauvres” la minorité. Peu importe car dans toute corruption on a un gouvernement “minoritaire” dont on peut dire qu'il est fondamentalement une oligarchie en son acception contemporaine, un «système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus ou de familles, à une classe sociale restreinte et privilégiée». Ou comme je le dis, c'est “le pouvoir de ceux qui ont le pouvoir”. Les notions de “riches” et de “pauvres” ont dans les cas de corruption d'une société une validité restreinte, par le fait les “puissants” sont des “riches”, mais ils ne sont pas riches de leur propre richesse, ayant en vue des intérêts particuliers, précisément les intérêts de leur seul groupe – l'oligarchie est étymologiquement “le pouvoir du petit nombre”, “le pouvoir du faible”, numériquement faible en ce cas –, ils détournent la richesse sociale à leur seul profit, donc contre l'intérêt général. Comme le propose encore Aristote, «la raison nous dit assez que la domination de la minorité et celle de la majorité sont choses tout accidentelles», à quoi j'ajoute que la domination des pauvres est toujours apparence, le démagogue n'agit pas pour les pauvres mais pour son propre groupe, qui ne peut être qu'une fraction des pauvres et qui ne reste pas longtemps dans cet état. Dans une démocratie il n'y a pas proprement de riches et de pauvres car l'intérêt général induit que nul ne soit en état de pauvreté puisque la démocratie c'est “le pouvoir de tous”, où l'intérêt général est donc l'intérêt de tous.
Pourquoi la pandémie actuelle est-elle politique? Parce que sa gestion est politique. Mais politique au sens courant et inexact: parce que l'administration, l'exécutif, prend en charge sa gestion de manière autonome, il fixe ses propres règles et contrôle lui-même son action. Ce 25 décembre 2020 j'entendais ceci sur ma radio, France-Culture, alentour de 8h45:
«Guillaume Erner: Jean-Luc Marion, votre regard sur noël?
Jean-Luc Marion: Noël? Noël c'est le moment de l'année où s'ouvre l'Histoire. Je veux dire qu'elle s'ouvre, parce que c'est la fin de l'année ou le début de l'année suivante, mais au sens où on ouvre la porte, éventuellement en la défonçant, et où on ouvre une outre avec un glaive, comme dit l"Écriture, un glaive à deux tranchants. C'est-à-dire que notre expérience c'est l'expérience du quotidien, au jour le jour, donc d'une certaine manière pour nous l'Histoire est close. Elle se prolonge naturellement mais finalement c'est toujours la même. Et noël, la signification de noël... Alors, je pense que c'était déjà un peu vrai avant le christianisme, mais avec le christianisme noël c'est le moment de l'irruption de ce que j'appelle l'ailleurs, de l'irruption absolue de l'ailleurs, qui d'un seul coup nous fait envisager cette hypothèse folle mais en fait très rationnelle: peut-être que l'Histoire, d'une certaine manière, est un éternel retour, ou du moins le masque d'autre chose. Et c'est ce rapport entre le visible et l'invisible qui taraude la fête de noël, et c'est très intéressant. En fait, on se pose la question – et en période de Covid encore plus –, on se pose la question de se dire, est-ce que le monde dans lequel nous sommes, non seulement est le seul, mais sil est vraiment réel. Je crois que noël c'est ça.
Guillaume Erner: Justement, en cette période de Covid, Jean-Luc Marion, votre regard, là aussi, sur la manière dont ces fêtes ont été vécues, et ce que nous sommes contraints à faire?
Jean-Luc Marion: Écoutez, le Covid n'est pas d'abord une crise sanitaire, c'est une crise politique. Je veux dire, la maladie elle-même n'est pas exceptionnelle, ce n'est pas la peste noire, les populations ne sont pas décimées de plus d'un tiers, ce n'est pas le choléra comme au XIX° siècle à Marseille. Donc, ce qui est inquiétant c'est les effets induits, donc les décisions politiques, et les conséquences économiques naturellement, du Covid. Tout se passe comme si le Covid était un révélateur – je prends le mot à dessein. Un révélateur de ce dont on ne parle pas habituellement. Alors, l'une des conséquences incroyables, là on en est à un an de Covid: qu'est-ce qu'on a lâché sur le plan des libertés individuelles! Pour la bonne cause peut-être... On a lâché ces libertés individuelles, et on n'a pas protesté, même les Français qui sont supposés râler n'ont pas protesté. Et, c'est d'autant plus étonnant qu'il n'y a pas péril en la demeure physiquement. Il y a des morts mais je veux dire, ce n'est pas une hécatombe. Et d'autre part ces contraintes nous ont été imposées – encore une fois, peut-être le faut-il, là ce n'est pas mon problème, j'essaie de décrire –, nous ont été imposées par un pouvoir politique, c'est son métier, mais un pouvoir politique faible. C'est-à-dire, il n'y a pas eu besoin de sortir des policiers, il n'y a pas eu besoin de... Pire, ça a été donné par un pouvoir politique qui n'était même pas vraiment politique, puisqu'il n'y a même pas eu de vote, etc., par un pouvoir politique qui était réduit à l'administration, et une administration qui n'a cessé de se contredire, donc sans autorité. Et alors, pour moi l'événement profond est: que s'est-il passé dans nos têtes? Parce que le Covid se passe dans nos têtes».
On peut entendre toute l'émission par ce lien, 13983-25.12.2020-ITEMA_22524022-2020C16450S0360.mp3, et si votre navigateur a besoin de béquilles pour lire des sons, vous pouvez essayer avec cette page (descendre un peu dans la page pour voir apparaître le lecteur de MP3 en haut). Je vous la conseille, c'est toujours plaisant d'entendre discuter deux personnes intelligentes. Non non! Pas Erner et Marion mais Marion et Thomas Römer.
Je ne puis qu'abonder: les contraintes consenties furent imposées par un pouvoir qui n'est pas vraiment politique, et en outre par un pouvoir faible et dans la contradiction, et de ce fait sans guère d'autorité. Censément, l'exécutif exécute, le législatif décide, le judiciaire sanctionne, l'autorité de l'exécutif est par délégation et dans un cadre défini par le législatif. Que s'est-il passé dans nos têtes, en effet, pour accepter que l'exécutif soit décisionnaire et que son autorité émane de lui-même? Et qu'on ne proteste guère, sinon parfois contre le sens – et pour un renforcement de l'exécutif au détriment du législatif et du judiciaire –, devant cette suspension des libertés publiques et individuelles, censément fondamentales. J'ai entendu ou lu bien des supposés responsables supposément politiques nous expliquer que «la première des libertés est la sécurité», or je pense le contraire: la première des sécurités est la liberté. Cette “crise du covid” est très illustrative des limites de la gestion de la chose publique quand de sa propre initiative le gestionnaire devient décisionnaire.
Ce que dit Jean-Luc Marion de cette pandémie est assez juste:
«La maladie elle-même n'est pas exceptionnelle, ce n'est pas la peste noire, les populations ne sont pas décimées de plus d'un tiers, ce n'est pas le choléra comme au XIX° siècle à Marseille [...]. Alors, l'une des conséquences incroyables, là on en est à un an de Covid: qu'est-ce qu'on a lâché sur le plan des libertés individuelles! [...] Et, c'est d'autant plus étonnant qu'il n'y a pas péril en la demeure physiquement. Il y a des morts mais je veux dire, ce n'est pas une hécatombe».
Il est à préciser que Marion a 74 ans. Les personnes raisonnables telles que lui ou qu'un autre philosophe, André Comte-Sponville, bientôt 69 ans, savent qu'à partir d'un certain âge, le leur, il n'est pas anormal de mourir et pas anormal de faire partie des personnes les plus en risque de mourir à cause d'une maladie contagieuse, d'où leur constat, d'un point de vue sanitaire il n'y a pas péril en la demeure. Si l'un, Marion, ne s'en réclame pas, ils ont là-dessus une approche dans la lignée d'un Épicure, d'un Lucrèce, d'un Spinoza, sur un point de doctrine central, l'ataraxie, la «tranquillité, [l']impassibilité d'une âme devenue maîtresse d'elle-même au prix de la sagesse acquise par la modération dans la recherche des plaisirs (Épicurisme), par l'appréciation exacte de la valeur des choses (Stoïcisme), par la suspension du jugement (Pyrrhonisme et Scepticisme)», nous dit le TLF, le Trésor de la langue française. Suspendre son jugement est toujours prudent quand on se trouve dans l'actualité et dans l'émotion, apprécier l'exacte valeur des choses est par exemple placer une situation dans un contexte plus large que l'immédiateté et le sentiment faux des choses, les “passions tristes”, lesquelles induisent à une recherche immodérée des plaisirs. Quand un événement d'apparence catastrophique advient, deux faux sentiments s'imposent: c'est “comme jamais”, et c'est donc “catastrophique”. Si on étend la compréhension de l'événement dans un cadre plus large, il n'apparaît que rarement singulier, inédit, et apparaît bien moins ou nullement catastrophique. Pour exemple, l'évènement dit «la canicule de 2003», qui correspond à un événement réel (depuis cette année-là, trois jours consécutifs de forte chaleur sont tout de suite qualifiés de canicule...). Il y a depuis un discours public sur la singularité et l'aspect catastrophique de cette année 2003, or ça n'est pas évident. Considérons ce tableau:
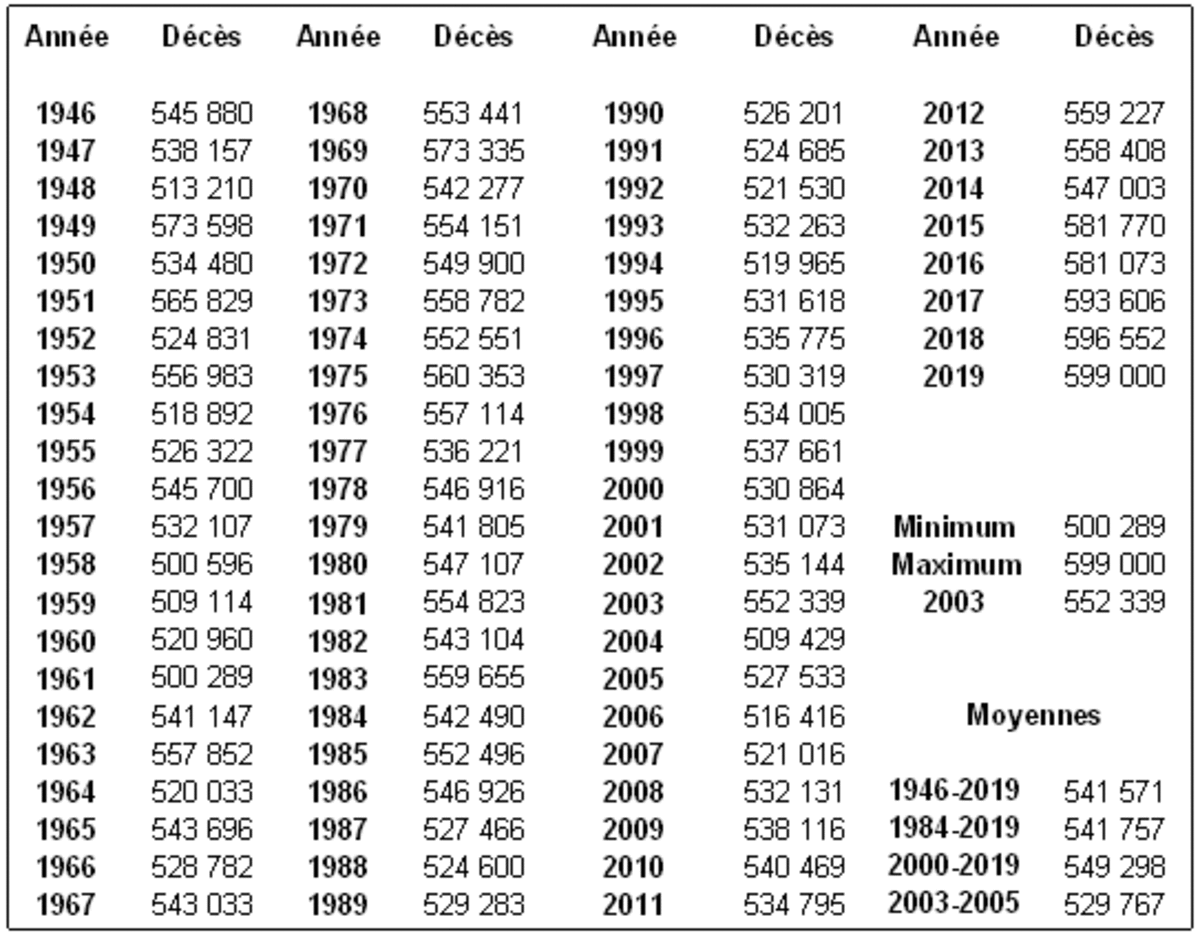
Les trois dernières années sont indiquées provisoires mais des tableaux anciens que je fis en 2007 et en 2012 m'ont montré que ces données provisoires sont peu corrigées par après – soit précisé il y eut des corrections importantes mais qui portèrent sur toutes les années, faudrait demander à l'INSEE le pourquoi de ce correction, possible que mes premiers tableaux portent sur toute la France et non sur la seule France métropolitaine comme ce tableau-ci, d'où une correction vers le bas, reste que les données provisoires sont proches de celles définitives. Il est à noter que depuis 2015 on a systématiquement un haut niveau de mortalité, là aussi faudrait demander à l'INSEE si elle a une explication – il faut remonter avant 1946 pour avoir des mortalités annuelles dépassant 560.000, assez vraisemblable que la conjonction d'une progression continue de la population générale et d'une faible progression – et même d'une petite régression de l'espérance de vie pour les années 2015 et 2016 – soit cause de ce niveau haut. Ou tout simplement c'est le résultat normal d'une variation ancienne et massive de la démographie: le second “Baby Boom” en France eut lieu pour l'essentiel entre 1945 et 1970, avec un plus haut entre 1950 et 1965, donc en 2015 les plus vieux “baby-boomers“ atteignent les 70 ans, un âge plus mortifère que les âges antérieurs. Corrélation n'est pas causalité, cependant on peut constater que la brève mais certaine baisse d de l'espérance de vie est concomitante à cette hausse nette de la mortalité et au moment où les “baby-boomers” prennent un gros coup de vieux...
On peut le constater, la mortalité en 2003 est à-peu-près à même distance du minimum et du maximum de la période 1946-2019 – j'ai pris cette période car juste après 1945 a lieu une baisse significative de la mortalité: entre 1901 et 1945 elle va de 626.780 à 867.816, avec une moyenne de 721.093, le plus bas de cette période étant donc supérieur au plus haut de la période suivante. Selon toute probabilité, dans les deux décennies à venir on devrait avoir une mortalité annuelle égale ou supérieure au plus bas d'avant 1946, le gros du “Baby Boom” ayant eu lieu entre 1950 et 1965, mais en proportion de la population c'est autre chose puisqu'en 1950 elle dépasse de peu les quarante millions, en 2015 (dernière année du tableau proposé par Wikipédia dans l'article «Démographie de la France») elle dépasse de beaucoup les soixante millions. Cette population connaît une faible variation de 1905 – 41 millions – à 1950 – 42 millions –, avec des hauts et des bas liés aux circonstances, sur cette période les deux guerres mondiales et le premier “Baby Boom”, entre 1920 et 1930, puis le début du deuxième qui, après un affaissement d'un million de 1940 à 1945, voit un rebond de deux millions de 1945 à 1950. Bien sûr la démographie n'est pas entièrement en relation causale avec la natalité, cependant, en France le plus gros de son accroissement lui est dû, en tout cas sur la période considérée, 1901-2019: l'accroissement naturel sur cette période est d'au moins vingt millions, ce qui représente les 4/5° de l'accroissement global. Quoi qu'il en soit, la mortalité de l'année 2003 se distingue peu de la moyenne 1946-2019 avec 541.571, ou 1984-2019 avec 541.757, et moins encore de la période 2000-2019 avec 549.298. Comme discuté, la population globale ayant fortement progressé et plus encore, ces dernières années, la population en âge de mourir, la nette progression de la moyenne au cours des deux dernières décennies est assez normale.
Ce cas m'intéresse parce qu'existe un discours sinon faux, du moins inexact concernant la “surmortalité” en 2003. Une recherche Google sur les mots
surmortalité canicule 2003
ramène beaucoup de résultats, qui sont vrais pour ce qui concerne la période de la canicule, laquelle se situe pour l'essentiel les trois premières semaines d'août, mais inexacts si on considère toute l'année, qui n'est pas spécialement “surmortelle”, même en ne considérant que la période 2001-2015, donc avant la récente nette hausse, elle est d'environ 16.000 au-dessus de la moyenne, ce qui la met près de ou au-dessous des années 2012-2014. Toute mort est regrettable, toute mort anticipée l'est encore plus, reste que passé les 70 ans ça sera dans la majeure partie des cas une anticipation modérée. Pour prendre ma réalité ordinaire, mon père est mort à 73 ans. Ce fut trop tôt, d'autant plus que si nous avions été correctement informés par le médecin qui le suivait, ou était censé le suivre, nous (ma famille) aurions pu être plus vigilants sur l'évolution de sa maladie et éviter cette mort anticipée, reste que mourir à 73 ans n'est pas anormal, qu'on ne peut tout anticiper et qu'il est dans l'ordre des choses de ne pas anticiper de manière certaine et parfaite le décès des personnes âgées. On ne refait pas le passé, mon père est mort, possiblement c'eut pu être plus tard et dans de meilleures conditions, possiblement non, en tout cas la persistance dans la vie se réduit à mesure que l'âge augmente. Statistiquement j'en ai encore pour, en moyenne, une vingtaine d'années avant de mourir, mais factuellement, à 61 ans je suis plus proche de la fin que du début et mourrais-je à 65 ou 70 ans que ça ne serait pas anormal. Regrettable pour moi et pour mes proches, mais non anormal. En fait, à quelque âge mourrai-je, ça me sera regrettable, et ça le sera pour mes proches, mais pour eux ça le sera nettement moins si ça m'arrive à 85 ans passés qu'avant 80 ans, car passé les 80 ans mourir est dans l'ordre des choses.
Ce qui nous ramène aux propos de Jean-Luc Marion:
«Le Covid n'est pas d'abord une crise sanitaire, c'est une crise politique. La maladie elle-même n'est pas exceptionnelle, ce n'est pas la peste noire, les populations ne sont pas décimées de plus d'un tiers, ce n'est pas le choléra comme au XIX° siècle à Marseille [...]. Il y a des morts mais ce n'est pas une hécatombe».
De fait, il y a des morts et ce n'est pas une hécatombe. Au pire ça serait une “décimation”, moins, une “centimation”: originellement “décimation” désigne le cas où une personne concernée sur dix meurt, ici on est plutôt dans le cas d'au plus une personne sur cent, pour autant qu'on connaisse tous les cas – il est significatif que la proportion de cas mortels est d'autant plus réduite que le nombre de personnes testées est important, ce qui donne à penser qu'il y a une surévaluation de la mortalité induite par ce SARS-Cov-2 dans les pays où l'on teste peu ou mal.
Est-ce que le “confinement” réduit la morbidité et la mortalité de ce SARS-Conv-2? La réponse est oui, du moins à court terme. Est-ce que c'est une réponse adaptée pour cette pandémie? La réponse est: indécidable. Ça dépend de la suite. De la réponse à moyen et long terme. La suite? «Business as usual» ou «On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste»? D'évidence notre exécutif, celui français pour ce qui me concerne, est dans la contradiction, et dans une contradiction insoluble: il souhaite, du moins dans son discours, qu'on en revienne à la situation antérieure, celle de janvier-février 2020, avec ce problème que la situation antérieure est la cause de celle ultérieure. Comme le déclare le ministre de la santé, Olivier Véran, ce 27 décembre 2020, ou la veille au soir, on peut anticiper un troisième “confinement” incessamment sous peu. Pour mention, j'ai entendu sa proposition sur France Culture dans l'un des journaux du matin. Après vérification c'est dans le journal de 8h00, et ça me permet de la situer au 26 décembre 2020:
«L'instauration d'un troisième confinement n'est pas exclue si la situation épidémique devait s'aggraver, c'est ce que laisse entendre le ministre de la santé, Olivier Véran, dans une interview du Journal du dimanche, tout en précisant qu'aucune décision n'était arrêtée à cette heure. La circulation importante du virus depuis plusieurs semaines, avec 15.000 contaminations détectées par jour en moyenne, ainsi que la période des fêtes, qui a favorisé la promiscuité, font craindre au gouvernement une troisième vague début janvier».
Ça se situe à partir de 2mn57 dans ce journal d'Adrien Toffolet.
Quel est le problème avec un exécutif étant son propre législateur et contrôleur? Un vieux problème, «On ne peut être à la fois juge et partie», qu'on peut compléter en: on ne peut être à la fois législateur, juge et partie. Fonctionnellement, l'exécutif est toujours dans le court terme, le judiciaire dans le moyen terme, le législatif dans le long terme. L'exécutif peut parfois être dans le court moyen terme, le législatif dans le long moyen terme, en tous les cas jamais l'exécutif ne peut être dans le long moyen terme ou le long terme, raison pourquoi il ne peut être son propre législateur et contrôleur. Enfin, ça n'est pas si simple ni si strict: l'exécutif est son propre contrôleur et son propre législateur en interne, il vérifie son action et définit ses règles de fonctionnement; en revanche il ne peut pas être législateur ni contrôleur en ce qui concerne son action externe, son action sur la société.
La réalité effective peut converger avec nos attentes, ou ne pas le faire. Je suis comme vous, j'espère voir cette pandémie appartenir rapidement au passé, mais suis raisonnable et n'escompte pas que mes désirs et la réalité effective convergent rapidement. De ce fait, l'hypothèse la plus vraisemblable est: une troisième vague début janvier. Enfin non, pas proprement une troisième vague. Il y a peu, environ quatre semaines ce 27 décembre 2020, mon gouvernement fit une hypothèse assez peu vraisemblable, ou peut-être non, peut-être n'a-t-il pas fait cette hypothèse, mais du moins a produit un discours basé sur cette hypothèse, la fin de la “deuxième vague” incessamment sous peu, genre, vers noël. La foi c'est bien mais ça n'a qu'un effet très modéré sur la réalité effective: début décembre toute personne raisonnable pouvait anticiper une persistance du contexte pour au moins deux, plus probablement trois ou quatre mois. Pour mémoire, alentour du 25 novembre 2020 l'exécutif mit la fin du confinement sous condition, je ne sais plus trop, moins de 5.000 contaminations attestées par jour. D'évidence, ça ne pouvait advenir à court terme, et ça n'advint pas, au contraire le niveau de tests positifs s'est, depuis, maintenu ou a augmenté. En toute honnêteté, je suis presque certain que notre exécutif le savait, d'ailleurs cette page nous le dit implicitement:
«15 décembre : Fin du confinement et mise en place d’un couvre-feu de 20h00 à 6h00 [...].
20 janvier : Nouvelles ouvertures si les conditions sanitaires le permettent».
Dès le 24 novembre, l'exécutif anticipait que le “confinement” n'aurait pas réellement cessé au 20 janvier 2021. D'ailleurs, le 15 décembre cette “feuille de route” du 24 novembre fut assez écornée puisque l'hypothèse de passage d'un confinement à un couvre-feu fut abandonnée pour arriver, sans le dire mais en le faisant, à une continuation du “confinement” – au moins jusqu'au 20 janvier 2021... D'où, le propos d'Olivier Véran, «L'instauration d'un troisième confinement n'est pas exclue», ne correspond pas à la réalité observable: il ne s'agira pas d'un “troisième confinement” mais de la simple poursuite du “deuxième confinement”, puisque la “fin du confinement“ supposée advenir le 15 décembre 2020 n'eut pas lieu.
C'est simple: tant qu'on acceptera de croire qu'une institution n'ayant en vue que le court terme ou au mieux le court moyen terme, et qui ne doit pas avoir de pouvoir décisionnaire ni de contrôle de sa propre action, dirige et contrôle, on ne résoudra pas nos problèmes. Étant fondamentalement démocrate ça m'attriste mais si mes concitoyens préfèrent en majorité une autre option libre à eux. Ça m'attriste mais pas tant que ça, quand on est dans l'optique d'agir pour l'intérêt général plutôt que pour les intérêts particuliers on sait qu'on a raison. La preuve? Le gouvernement actuel s'est clairement déclaré en faveur de l'initiative individuelle et de la liberté d'entreprendre, et en faveur de la croissance, et pourtant il ne cesse, depuis plus d'un an, de limiter les libertés privées et publiques, et depuis près d'un an d'agir contre la croissance. Ce qui m'amène à un de mes préceptes: quand les choses doivent changer elles changent. Possible que ce gouvernement croie réellement être favorable à l'initiative individuelle, à la liberté d'entreprendre et à la croissance, mais je constate qu'au moins depuis mars 2020 il va contre cela. Parce que la réalité est plus forte que la croyance...



